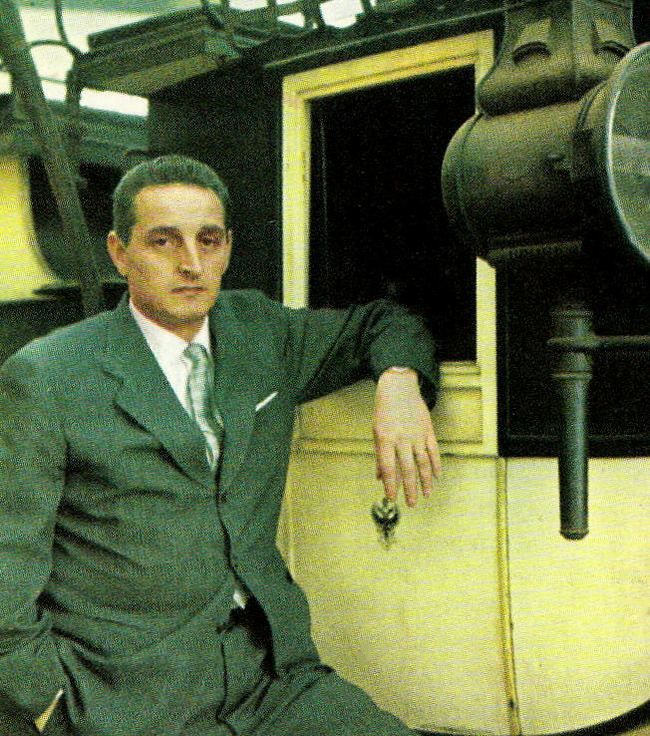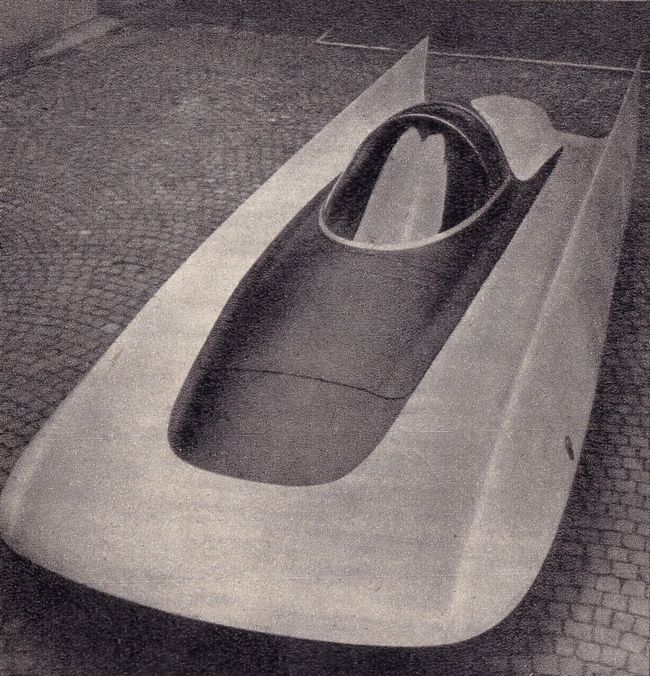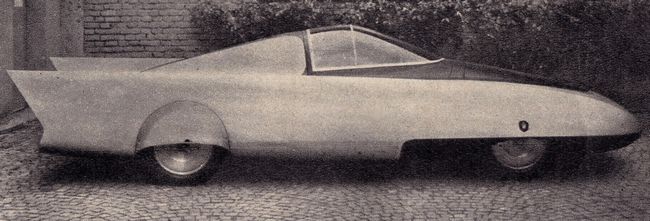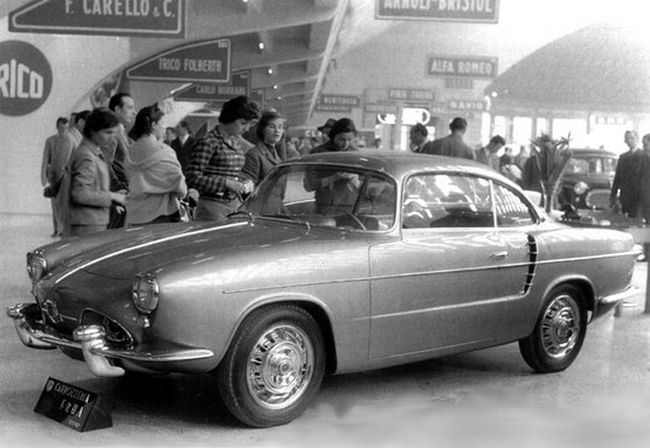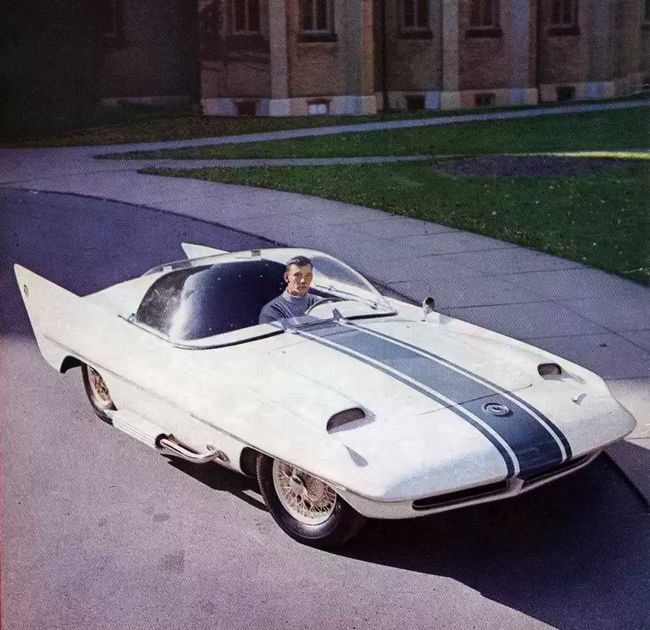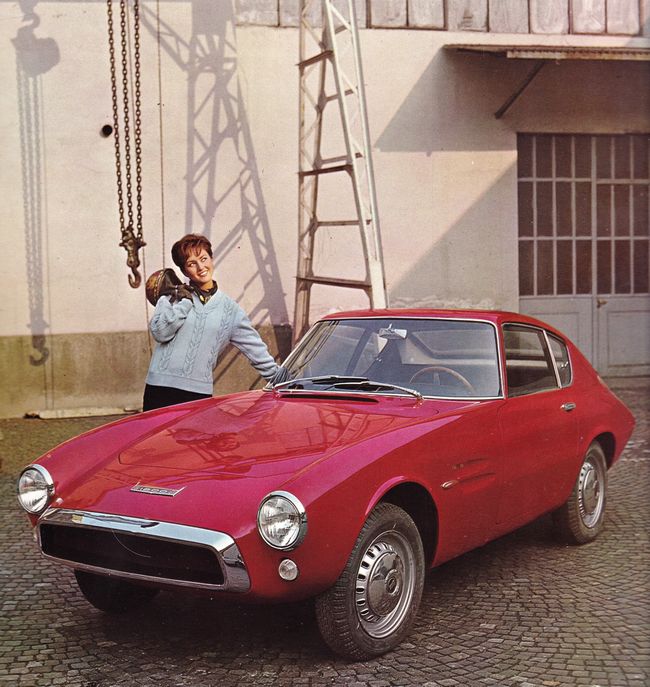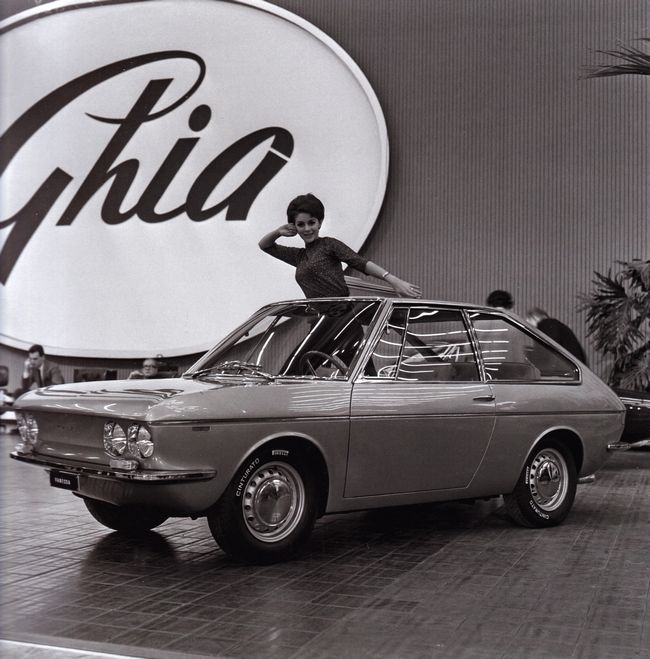|
Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. Fondé en 1915 à Turin par Giacinto Ghia, racheté par Ford en 1973 et abandonné en 2001, Ghia est l’un des plus anciens carrossiers automobiles italiens. Si l’activité de Ghia a été très liée à celle de Chrysler entre 1951 et 1965, elle a aussi concerné des constructeurs européens et japonais. Nous abordons ici cette activité internationale du carrossier, qui a été une véritable pépinière de talents à partir des années 1930. Ce dossier s'articule sur trois chapitres : les dirigeants, les stylistes et designers, les voitures produites. Cette dernière partie bien qu'étoffée n'a pas l'ambition d'être exhaustive. Le présent dossier ne s'intéresse qu'aux modèles étudiés et/ou assemblés par Ghia jusqu'en 1973, à l'exception de toutes les voitures produites en collaboration avec Chrysler, étudiées par ailleurs. Les dirigeants Giacinto Ghia, 1915-1944 Giacinto Ghia naît le 18 septembre 1887 à Turin. Fils d'un employé municipal, à la mort de son père, le jeune Giacinto doit pourvoir aux besoins de la famille. Il rentre en usine à 13 ans, et devient l'un de ces innombrables enfants ouvriers qui font tourner l'industrie locale. Par hasard, un carrossier le recrute. Il est amené à fabriquer des carrosses à une époque où l'industrie automobile est encore balbutiante. Dans la rue, il observe les premiers engins sans chevaux, qui le fascinent. En 1910, Ghia est recruté chez un vrai constructeur automobile, dénommé Rapid, la marque créée par Giovanni Battista Ceirano, un pionnier de l’automobile italienne. Le jeune Giacinto est adroit de ses mains et volontaire. Il sait se faire apprécier, et gagne vite du galon. D'apprenti, il passe mécanicien spécialisé, puis mécanicien d'essai, un poste alors prestigieux et enviable. En 1914, Giacinto Ghia rentre chez Diatto comme pilote d'essai. En 1905, les frères Pietro et Vittorio Diatto se sont lancés dans l'automobile à Turin, en s'associant avec le français Adolphe Clément, sous le nom de Diatto Clément. Diatto se dote de moyens industriels très perfectionnés. L'entreprise compte à ses débuts près de 500 salariés. En 1909, Adolphe Clément cède sa participation aux frères Diatto. En 1910 débute l'exportation vers différents pays européens, la Russie, l'Amérique et l'Australie. A la fin des années 1910, Diatto est devenu le troisième plus important constructeur italien. Giacinto Ghia contrôle les châssis des nouvelles voitures. Lors d'un essai en compagnie d'un client maladroit, il est projeté sur la route, et s'en sort avec deux jambes fracturées. Après deux mois d'hospitalisation, il est contraint d'envisager une réorientation professionnelle. L'alternative est simple, soit il reprend un poste d'ouvrier, soit il lance lui-même son affaire. En 1915, Ghia ouvre un petit atelier de carrosserie où il commence par travailler en collaboration avec Diatto, avant d'habiller d'autres châssis. A cette époque, les carrosseries sont encore construites à la manière des calèches. Ce n'est guère très difficile. La main d'oeuvre qualifiée est abondante, et il n'est pas nécessaire de procéder à de lourds investissements. Quelques outils de menuisier suffisent.
Giacinto Ghia naît à Turin en 1887. Très jeune, il travaille chez les premiers constructeurs automobiles, où, au fil des ans, il acquiert une belle expérience technique. Il franchit les échelons, et on le retrouve en 1914 pilote essayeur chez Diatto. Victime d’un accident, sa vie professionnelle est bouleversée. Il décide d’ouvrir une carrosserie artisanale. C'est la guerre. Le modeste atelier réalise ses premières carrosseries sur des châssis Diatto, Scat et Itala. Copyright En 1919, Giacinto Ghia s'associe avec un certain Gariglio, dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que son nom est apparemment courant parmi les bouchers turinois ... Les deux hommes fondent l’entreprise Ghia & Gariglio à Turin. Gariglio semble jouer le rôle du bailleur de fonds. L'activité est suffisamment rentable pour envisager un agrandissement. L'automobile n'est plus exclusivement un objet pour jeunes gens fortunés. Sa conception devient plus sérieuse. La pratique de la course automobile se développe. Giacinto Ghia a désormais les moyens de s'offrir une Diatto, et de courir la Targa Florio en 1919 et 1921. A cette époque, sur la même épreuve, un autre jeune pilote ambitieux fait parler de lui, il s'appelle Enzo Ferrari. En 1919, Giacinto Ghia rate sa chance de gloire sportive. Pour éviter un enfant imprudent qui traverse la rue, il fait un écart et écrase sa voiture contre un mur. Il est contraint à l'abandon. Il s'en sort plus honorablement en 1921, en terminant la course en seizième position. En 1921, la carrosserie Ghia & Gariglio connaît un accroissement de ses activités avec un gros contrat pour la construction de carrosseries pour le nouveau dérivé sportif de la Fiat 501.
Fiat 501 S Ghia, 1924. Fiat apporte une autre dimension à Ghia en lui confiant à partir de 1921 l'habillage de châssis. La réussite de Ghia devient étroitement liée aux choix de Fiat. Copyright Le partenariat entre Ghia et Gariglio bat de l'aile à partir de 1922. Gariglio, qui veut accroître ses revenus, prend une participation chez le fabricant de lunettes de course Meyrowitz, utilisées par tous les as de l'aviation et les champions de courses cyclistes, motocyclistes et automobiles. En 1923, Giacinto Ghia se retrouve un moment seul, avant de s'associer avec Actis. Ainsi voit le jour la Carrozzeria Ghia & Actis. Le marque Ghia est suffisamment forte pour que ces changements soient indolores, les financiers ne se mêlant pas du quotidien. La petite usine emploie une trentaine de personnes, et fabrique deux à trois carrosseries par mois. Le principal assistant de Giacinto Ghia est son beau-frère, Giorgio Alberti. Les deux hommes sont très différents. Il se dit que Giacinto Ghia accepte cette présence, car il s'agit du mari de sa petite soeur, née après la mort de leur père, qu'il a toujours voulu protéger. L'expansion du marché automobile dans les années 1920 est source d'opportunités. Ghia cesse la production de châssis, et se spécialise dans les carrosseries. Ses clients sont à la fois de riches particuliers, mais aussi de grands constructeurs. Outre Diatto, Ghia travaille pour Scat, Fiat, Lancia et Spa. Ghia est par ailleurs sollicité par ses confrères en manque de capacité.
Itala 61 Spyder Ghia, 1927. Ghia fait la différence avec nombre de ses confrères, car il possède l'intuition, le bon goût et le sens de l'équilibre d'un grand maître carrossier. Copyright En 1926, Giacinto Ghia devient le seul maître à bord. La raison sociale change une troisième fois. Le carrossier s'intéresse de plus en plus aux voitures sportives, et ses travaux dans cette voie sont de plus en plus appréciés. Un nouveau challenge s'impose aux carrossiers. Il s'agit de proposer des carrosseries plus souples. En effet, le réseau routier n'évolue que lentement, alors que la puissance des automobiles progresse, ce qui met à rude épreuve les caisses traditionnelles trop rigides. Le système Weymann notamment répond à ces nouvelles contraintes, mais ce n'est pas le seul. Ghia apporte sa propre solution.
L'une des voitures de sport italiennes les plus connues au début des années 1930 est la Fiat 508 S, alias Balilla Sport. Cet exemplaire carrossé par Ghia date de 1934. Copyright Au milieu des années 1930, la Carrozzeria Ghia atteint sa pleine maturité. Sa réputation de maison sérieuse et fiable n'est plus à faire. Le carrossier fait preuve d'audace, tout en respectant certaines traditions. Cela plaît à la bourgeoisie italienne, qui aime de temps en temps se montrer moins conservatrice qu'elle n'en a l'air. Giacinto Ghia a atteint une position sociale enviable qui lui permet de vivre confortablement. L'homme a parfaitement su s'adapter à sa clientèle particulièrement raffinée, et souvent mieux que ses confrères aux mêmes origines modestes. En 1930, un nouveau rival arrive sur le marché des carrosseries haut de gamme. Le jeune Pinin Farina vient de quitter les Stabilimenti Farina pour s'installer à son compte. Comme Giacinto Ghia, Pinin Farina veut faire preuve de modernité. L'un et l'autre travaillent avec un certain Mario Felice Boano, entrepreneur indépendant, qui jouera bientôt un rôle majeur chez Ghia. Une profonde amitié va rapprocher Giacinto Ghia et Mario Felice Boano. Ghia apprécie la qualité des réalisations de Boano, tandis que ce dernier a de l'estime pour la capacité de travail de Ghia, même s'il constate que ce n'est pas un excellent administrateur. En 1935, Ghia produit environ huit voitures par mois. Même si le père de Giacinto Ghia n'est qu'un employé de mairie, et que sa mère est analphabète, ses parents n'en possèdent pas moins certains talents artistiques. Le père joue de la trompette, et son épouse a un goût inné pour le beau et l'élégance. Les soeurs de Giacinto qui se sont lancées avec succès dans la mode vestimentaire semblent avoir hérité de ces talents. Même la femme de Giacinto Ghia est dans le métier, puisqu'elle dirige un grand atelier de couture à Brescia. Le couple n'a pas d'enfants, et vit pratiquement séparé, Giacinto à Turin en ne se privant pas des mondanités, et son épouse à Brescia. Giacinto est un Monsieur, un homme élégant et courtois.
Alfa Romeo 6C 2300 Cabriolet, 1937, par Ghia. A cette époque, Ghia habille environ huit voitures par mois. Copyright Le 10 juin 1940, l'Italie entre en guerre. Giacinto Ghia tente de ne pas se laisser entraîner dans la machine fasciste. Toutes les activités liées au luxe sont mises en veille. Les ateliers sont affectés à la production de fournitures militaires et d'ambulances. Ghia fabrique aussi des bicyclettes, en y mettant un peu plus de style que ses concurrents. Il est très chic de pédaler sur une Ghia ! Giacinto Ghia laisse la direction de l'entreprise à son beau-frère Giorgio Alberti. Les ateliers tournent au ralenti. Il rejoint sa mère et son épouse qui vient de fermer sa maison de couture. Giacinto Ghia, qui n'a jamais cessé de travailler, retrouve paradoxalement un peu de sérénité. Avec sa concentration d'usines automobiles, Turin est une cible naturelle pour les bombardements alliés. Malheureusement, les ateliers Ghia sont atteints en 1943. Touché moralement au plus profond de lui-même, Giacinto Ghia décède le 21 février 1944 à seulement 56 ans, d'une angine de poitrine. Quelques mois plus tard, sa mère et son épouse décèdent à leur tour. Ces trois disparitions vont compliquer la succession. Mario Felice Boano, 1946-1954 Les descendants ne souhaitent pas reprendre en main l'entreprise familiale. Ils ne veulent pas non plus confier cette charge à Giorgio Alberti. Giacinto Ghia semblait du même avis, puisque avant son décès, il avait désigné son éventuel successeur, en la personne de Mario Felice Boano. Quand il est contacté par la famille Ghia, Mario Felice Boano hésite. On lui demande de quitter une affaire qui fonctionne plutôt bien, pour se lancer dans une nouvelle aventure dont il ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants, et ce dans une période de redémarrage économique où tout fait défaut. Chez Ghia, il faut pratiquement repartir de zéro. Mais après moult discussions et demandes de garanties, Boano accepte finalement de relever le défi. Il lui en faudra de l'énergie et de l'ambition. Accessoirement, le sort de Giorgio Alberti n'est pas encore tranché. Celui-ci n'a aucune envie de céder sa participation dans l'affaire Ghia. Alberti et Boano relancent l'activité de carrosserie en 1946. Le marché de l'automobile s'est éteint avec la guerre, et il n'y a quasiment plus de châssis à habiller. Lancia est aux abonnés absents, tandis que Fiat se fait tirer l'oreille pour livrer quelques châssis de Fiat 1500. Alfa Romeo préfère travailler avec ses voisins milanais Touring et Castagna, sans pour autant totalement abandonner Ghia, à qui il livre quelques châssis de 6C2500.
Mario Felice Boano. En 1947, Mario Felice Boano finit par convaincre Giorgio Alberti de lui céder ses parts dans Ghia. Il est désormais le seul maître à bord. Copyright Mario Felice Boano va faire des miracles. Comme il ne reste plus rien de l'ancienne usine, il considère à juste titre qu'une reconstruction sur l'emplacement des débuts prendrait trop de temps, et laisserait Ghia dans une situation désavantageuse, alors qu'il s'agit au contraire de tirer le meilleur parti de l'inévitable redémarrage d'après-guerre. Il transfère donc l'activité sur un nouveau site, via Tommaso Grossi. Celui-ci présente l'avantage d'être relié au réseau ferroviaire, ce qui permettra d'exporter plus facilement les productions. Ghia vise en effet de plus en plus les marchés étrangers. D'ailleurs, le carrossier tente d'y nouer des liens d'affaires. Bien que succédant à Giacinto Ghia, Mario Felice Boano déclare son intention de conserver la raison d'être de Ghia, c'est-à-dire produire des voitures de haute qualité en nombre réduit. La concurrence est plus rude que jamais entre les différentes carrozzeria. Ghia retrouve peu à peu ses lettres de noblesse. Il vise à cette époque une manifestation majeure, le concours d'élégance de Monte-Carlo de 1947. Ghia va y conforter sa renommée en exposant au prix de gros efforts cinq voitures, et en remportant trois prix. Les deux plus proches collaborateurs de Mario Felice Boano sont son fils Gian Paolo, et Luigi Sibille, un de ses anciens collaborateurs. Ils ont en charge la partie technique, jusqu'à la réalisation des voitures.
Chez Ghia, la clémence du temps permet la finition en plein air de cette Alfa Romeo. Les dimensions des voitures après habillage sont généralement amplifiées. Mais une étude poussée des formes et du montage permet une réduction du poids et une amélioration de la performance par rapport au modèle de série. Copyright En 1954, à la suite d’un différend entre Mario Felice Boano et Luigi Segre, son ingénieur en charge de la partie commerciale depuis 1949, actionnaire de Ghia, le premier décide de se séparer du second. Contre toute attente, Luigi Segre, appuyé par quelques banquiers bien placés, rachète les parts de Boano. Celui-ci est contraint à la démission, et part fonder sa propre affaire. Segre prend la direction de Ghia. Il va trouver les moyens de réaliser ses ambitions, notamment grâce à un accord majeur avec Chrysler, contrairement à Mario Felice Boano qui a plus souvent joué la prudence. Quatre ans après avoir créé leur propre studio, Mario Felice Boano et son fils Gian Paolo concluent un accord avec Fiat. Ils seront à l'origine de la création du Centro Stile Fiat. Luigi Segre, 1954-1963 Nous sommes en 1948. Un ami de Mario Felice Boano, Vittorino Viotti, carrossier lui aussi, vient de recruter un jeune homme très prometteur, un ingénieur en charge de la partie commerciale de son affaire, Luigi Segre, né en 1919. Viotti, qui peine à assurer seul la charge élevée de ce salaire, propose de partager les services de Segre avec Boano. En peu de temps, la nouvelle recrue démontre son efficacité. Segre visite l'ensemble des distributeurs italiens de Ghia et motive les troupes. Les commandes affluent. Plutôt que de continuer à le payer à la commission, Boano lui propose de prendre part au capital de Ghia, ce qu'il accepte.
Luigi Segre commence à travailler dans l'entreprise de construction de son père, mais sa carrière et ses études sont interrompues par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Il s'oppose à l'occupation de Naples par les troupes allemandes. A l'arrivée des alliés, il se met à la disposition du commandement américain, et devient agent de liaison entre l'Office of Strategic Services (le fameux OSS) et les partisans. Il commence alors à maîtriser l'anglais et à se familiariser avec la façon de penser américaine, ce qui lui sera fort utile pour mener à bien les discussions avec Chrysler. Copyright Il devient ainsi associé de l'affaire à hauteur d'un tiers du capital. L'accord entre Mario Felice Boano et Luigi Segre stipule que le paiement des parts du capital se fera plus tard, quand il aura de quoi payer. Segre parvient à vendre les prestations de la carrosserie à des tarifs plus élevés qu'auparavant, mettant en avant la renommée de Ghia. C'est lui qui est à l'origine de la longue coopération qui va unir Ghia et Chrysler. Lors de l'un de ses voyages en Amérique en février 1963, Segre se plaint de fatigue, et se rend à l'hôpital Henry Ford de Détroit pour un contrôle. Les médecins lui annoncent que non seulement il souffre de problèmes à la vésicule biliaire, mais qu'en plus il est impératif de lui retirer son appendice dans les meilleurs délais. Cela n'arrête pas Segre qui poursuit son voyage d'affaires. De retour à Turin, il prend rendez-vous dans le principal hôpital de la ville, où travaille l'un de ses amis, qui va se charger de l'opération. Il décède le 26 février 1963 suite à une erreur médicale. Pour Ghia et pour toute la carrosserie italienne, c'est une perte considérable. L'essentiel des contrats en cours reposent sur les relations de Segre. Sa disparition aura des conséquences sur le devenir de l'entreprise. C'est l'époque où toutes les carrozzeria les plus importantes, qu'il s'agisse notamment de Pininfarina, Bertone ou Touring, sont en train de passer du statut d'entreprise artisanale à celui d'entreprise industrielle. Hélas, avec la disparition de Luigi Segre, il n'y a plus personne chez Ghia pour mener à bien ce type de projet très ambitieux.
Luigi Segre. L'homme est réputé colérique et changeant, aussi impatient que n'importe quel homme ambitieux. " Quand il est en colère, il crie si fort que l'on peut l'entendre dans toute l'usine", se souvient Filippo Sapino. Copyright Giacomo Gaspardo Moro, l'assistant personnel de Luigi Segre, décrivait son patron comme étant un homme dynamique et visionnaire, un grand voyageur. Il a été le premier turinois à faire des affaires aux Etats-Unis. Grâce au coupé Karmann Ghia produit avant tout pour le marché américain, Ghia a longtemps été plus connu outre-Atlantique que Pinin Farina. Giacomo Gaspardo Moro, 1963-1967 A la mort de Segre, en l'absence d'héritier capable d'assurer la responsabilité directe de l'entreprise, Luisa Berto, la veuve de Luigi Segre, en confie la direction à Giacomo Gaspardo Moro, présent chez Ghia depuis 1960. Toutefois, l'absence d'un leader charismatique comme Luigi Segre, auquel les équipes peuvent s'identifier, se ressent. Giacomo Gaspardo Moro s'efforce de ralentir la fuite des clients et des meilleurs éléments de l'entreprise. La Présidence de la société est assurée temporairement par M. Gallieni de Alassio, un parent éloigné de Segre, banquier de profession. Celui-ci se met en quête d'un investisseur pour poursuivre le développement de l'affaire. Un homme manifeste son intérêt, Rafael Leónidas Trujillo Martínez (1929-1969), connu sous le nom de Ramfis Trujillo, fils de l'ancien dictateur dominicain assassiné en mai 1961. Les Trujillo ont toujours manifesté un vif intérêt pour les voitures à hautes performances. Le père a été l'un des premiers acheteurs d'une Pegaso Z-102 à la flamboyante carrosserie Touring. La famille, propriétaire d'une Chrysler Ghia Crown Imperial, connaît évidemment l'extraordinaire savoir faire de Ghia. Ramfis Trujillo possède un important patrimoine en Suisse. Il place son argent dans différentes activités, comme des écuries de chevaux de course, ou dans des objets d'art. Des discussions s'engagent entre la famille de Luigi Segre et les représentants de Trujillo, qui craignent de laisser la gestion de Ghia entre les seules mains de Giacomo Gaspardo Moro. Celui-ci leur apparaît comme manquant d'expérience. Ils souhaitent que la présidence de Ghia soit assurée par une personnalité reconnue du monde de l'automobile. La famille Segre, encore propriétaire d'une part minoritaire au capital, a la charge de ce recrutement. Giacomo Gaspardo Moro se voit déléguer cette recherche. Il pense la trouver en la personne de Gino Rovere (1897-1965), un ancien pilote automobile, dirigeant au milieu des années 1930 de la Scuderia Subalpina créée par Maserati pour rivaliser avec la Scuderia Ferrari, travaillant désormais pour Ford en Italie, et ami personnel d'Henry Ford. Il est président de l'UNRAE, l'association des importateurs italiens de voitures étrangères. L'homme dispose évidemment d'un épais carnet d'adresses, autant en Europe qu'aux Etats-Unis. Dans un premier temps, Rovere décline l'offre qui lui est faite, avant de se raviser. Il s'entretient avec les membres de la famille Trujillo, avec lesquels il définit une nouvelle stratégie pour Ghia. Puis il rencontre les personnes qui comptent chez le carrossier. Ses compétences et son savoir être séduisent d'emblée. Mais sa présidence est de courte durée, puisqu'il décède en juillet 1964. Giacomo Gaspardo Moro se remet à la recherche de l'homme providentiel, mais sans résultat. Il convainc la famille Trujillo de ne pas laisser tomber Ghia. Un homme d'affaires milanais, le professeur Marcantinio, est nommé Président. Giacomo Gaspardo Moro conserve son poste de directeur général, et Maître Piquet est le représentant des Trujillo. L'arrivée de capitaux apporte un peu de sérénité chez Ghia. Mais dans les faits, cette participation financière de Rafael Leónidas Trujillo Martínez s'associe plus à une distraction, qu'à une réelle volonté de faire de Ghia un fleuron de la carrosserie italienne. Trujillo ne visite l'entreprise qu'une fois par an, et cela ne lui prend pas plus d'une heure. Giacomo Gaspardo Moro gère donc le quotidien. La survie de l'entreprise repose sur ses épaules. Sa principale mission est de trouver des clients pour faire tourner l'affaire, sans même pouvoir compter sur les nombreuses relations de Trujillo. Il trouve en la personne de Mario Capitani l'homme de confiance qui prend en charge la direction commerciale. Les disparitions successives de Luigi Segre et de Gino Rovere touchent profondément l'entreprise, et la charge de travail est au plus bas en ces années 1963 et 1964. Plusieurs contrats arrivent à leur terme, en particulier avec Chrysler. Jusqu'à une date récente, chaque fois que les Japonais ont sollicité les services de Ghia, le carrossier a décliné les appels d'offres. L'industrie automobile nippone est encore balbutiante, et la présence des constructeurs japonais en Europe tout à fait confidentielle. Chez Ghia, on craint de se faire copier. C'est en effet la réputation qui colle aux Japonais. La méfiance est donc de rigueur. En 1964, Ghia finit par succomber aux flatteries de l'Orient, et accepte de travailler pour Isuzu. Giacomo Gaspardo Moro a un certain flair pour dénicher des talents. Et il vient d'en trouver un qui va remettre pour un temps Ghia sur les rails, un certain Giorgetto Giugiaro ... qui jusqu'à cette date oeuvrait pour Bertone. Alejandro de Tomaso Bien qu'il soit né à Buenos Aires en 1928, Alejandro De Tomaso n'est qu'à une génération de ses origines italiennes. Son père, représentant parlementaire en Argentine, meurt alors qu'il n'a que cinq ans. Sa mère est issue d'une famille espagnole appartenant à l'aristocratie. A l'âge de vingt ans, le jeune Alejandro dirige le domaine familial. Mais il est bien déterminé à établir sa propre carrière. Il devient conducteur de camion, puis éditeur de journaux. En 1950, il commence à courir sur une ancienne Bugatti dans la région de Buenos Aires. Déçu par le gouvernement Perón, il quitte l'Argentine en 1955, pour s'installer au bénéfice d'une réputation naissante comme pilote automobile en Italie. C'est chez Maserati qu'Alejandro De Tomaso rencontre Isabelle Haskell, avec laquelle il fait équipe en compétition avant de l'épouser. En 1957, De Tomaso devient pilote pour Osca, dirigé par les frères Maserati. Il accumule les victoires. Chez Osca, on ne veut pas entendre parler du moteur arrière. De Tomaso fonde donc sa propre affaire en 1958 afin de construire une voiture de sport de ce type, avec un moteur ... Osca. Mais celle-ci n'est pas engagée en course pour des raisons légales. Fin 1959, De Tomaso participe à sa seule course de Formule 1, mais il est contraint à l'abandon. La même année, il fonde De Tomaso Automobili à Modène, où il assemble des voitures de course. Bien déterminé à produire un modèle pour la route, il conçoit en 1963 un châssis en tôle d'acier supportant un moteur de Ford Cortina. Mario Fissore dessine et fabrique dans ses ateliers les premiers exemplaires de la Vallelunga. Mais les relations entre Fissore et De Tomaso se tendent. Depuis la mort de Luigi Segre, les liens entre Ghia et De Tomaso sont au contraire plus étroits. De Tomaso négocie alors auprès de Giacomo Gaspardo Moro la poursuite de la production de la Vallelunga dans les ateliers Ghia. Les deux entrepreneurs y trouvent leur compte. Ghia a besoin d'activité.
Alejandro De Tomaso, pilote argentin de renom, fonde en 1963 la marque automobile qui porte son nom. Devenu entrepreneur, il a l’ambition de produire des voitures de Grand Tourisme, rivales des Ferrari, Maserati ou Lamborghini. Ce marché lucratif est en pleine expansion dans les années 1960. Copyright Le caractère tempétueux de De Tomaso et la manière qu'il a de trouver sans cesse des idées nouvelles fascinent les gens de chez Ghia. Le carrossier essaye vaille que vaille de survivre, alors il n'est pas trop regardant envers cette personnalité atypique. Petit à petit, De Tomaso devient le meilleur client de Ghia. Alejandro De Tomaso, qui observe la situation chez Ghia, comprend que Trujillo se lasse de sa danseuse. Il aimerait bien lui racheter l'affaire, dont il pressent l'énorme potentiel. Pour parvenir à ses fins, il obtient le soutien financier de la firme américain Rowan Industries, où ses deux beaux-frères occupent d'importantes fonctions. En mai 1967, Rowan Industries rachète les actions de Trujillo, et celles qui sont encore la propriété des héritiers de Segre. Si Trujillo n'est pas trop difficile à convaincre, Giacomo Gaspardo Moro pose ses conditions. S'il reconnaît la capacité de De Tomaso à proposer des idées nouvelles, à innover, il ne lui attribue aucun talent de gestionnaire, et souhaite conserver cette responsabilité. De Tomaso ignore totalement la clause exigée par Moro, et prend directement la direction de Ghia. La forte personnalité de De Tomaso ne cadre pas avec celle plus discrète de Moro. Ce dernier préfère démissionner. Son homme de confiance, Mario Capitani, le suit dans cette démarche, avec moins de discrétion. De Tomaso engage une purge chez Ghia. Ceux qui restent coopèrent pour conserver leur emploi. Le lancement de la De Tomaso Pantera étudiée par le designer Tom Tjaarda nécessite de gros investissements. En décembre 1969, De Tomaso rachète via Ghia la Carrozzeria Vignale. Alfredo Vignale en construisant une nouvelle usine a vu trop grand. Il ne parvient pas à rentabiliser son affaire. Vignale est exsangue. Le chef d'entreprise qui vit mal cette cession décède peu de temps après dans un accident automobile. La De Tomaso Pantera après maintes péripéties est enfin commercialisée aux Etats-Unis. Entre-temps, les deux beaux-frères de De Tomaso sont eux aussi décédés dans un accident d'avion. Rowan Industries se montre désormais moins complaisant envers Ghia, et prend ses distances. Ghia a besoin de capitaux. Trujillo, Moro, De Tomaso ... un quatrième homme entre dans la danse. Son nom : Lee Iacocca, président de Ford de 1970 à 1978. Ford va prendre chez Ghia le rôle du grand frère protecteur, à l'image de Chrysler au début des années 1950. En effet, le 3 août 1970, Ford annonce sa prise de participation dans Ghia, par l'achat d'actions à Rowan Industries. Commence alors une période tumultueuse. Les échanges fusent entre Turin et Détroit. Lee Iacocca et De Tomaso sollicitent sans cesse Tom Tjaarda. En hommes de marketing, ils savent exactement ce qu'ils veulent, et les demandes sont précises. Heureusement pour lui, le designer bénéficie d'une réelle liberté d'action. Apparaissent d'abord la De Tomaso Zonda, puis la Deauville. Avec celle-ci, De Tomaso espère se positionner face à la prestigieuse berline à succès du moment, la Jaguar XJ. Elle lui emprunte d'ailleurs certains traits de style. La Longchamp pour sa part est un grand coupé 2 + 2 qui vise le marché américain.
Ingénieur de formation, Lee Iacocca commence sa carrière chez Ford en 1946. Il y reste jusqu'en 1978. Il intègre les services commerciaux avant de gravir les échelons hiérarchiques jusqu'à devenir président en 1970. Après son éviction de la compagnie en 1978, il est nommé président de Chrysler. Le groupe est au bord de la faillite. Il sera l'homme providentiel. Copyright Ford a la ferme intention de confier à Ghia le développement de certains projets. Le premier d'entre eux est une Ford Granada personnalisée, mais celle-ci ne convainc pas grand monde. De Tomaso se lasse de la situation. Avec Ford comme interlocuteur, il a du fil à retordre. Les Américains n'ont aucune intention de le laisser agir à sa guise. De Tomaso voit se profiler une opportunité, le rachat de Maserati à Citroën. Parallèlement, pour la future Ford Fiesta, le projet commandé à Ghia et piloté par Tom Tjaarda est retenu. Lee Iacocca n'a aucun mal à convaincre Ford de lui racheter toutes les actions de Ghia et de Vignale. En décembre 1972, Alejandro De Tomaso cède son fauteuil de président de Ghia à un homme de Ford, John Head. Le 3 janvier 1973, Ford acquiert l'intégralité des actions de De Tomaso Inc, la holding de Ghia, Vignale et De Tomaso. Une nouvelle époque s'ouvre pour Ghia. Les stylistes et designers Mario Revelli de Beaumont (avant-guerre) A la fin des années 1920 émerge le nom de Mario Revelli de Beaumont. Le jeune comte est un concepteur doué. Il contribue à la naissance d'un nouveau métier, celui de styliste automobile. Il est en tout cas l'un des premiers à l'exercer à son compte. C'est un ami des Farina, tant Giovanni que son frère cadet Pinin, mais aussi de Vittorio Viotti et de Giacinto Ghia. Ses relations avec l'aristocratie italienne sont un atout. Mieux que quiconque, il sait interpréter ses désirs, en dessinant des voitures à la fois prestigieuses et discrètes. Ghia expose sur les salons les différentes réalisations du styliste, des voitures produites sur commande et à l'unité.
Mario Revelli de Beaumont. Copyright L'influence de Revelli de Beaumont devient majeure sur les études de Ghia en matière d'aérodynamisme, une science dont la mode se développe dans les années 1930, largement inspirée des recherches dans l'aéronautique. Les formes aérodynamiques entrent dans la vie quotidienne. Revelli de Beaumont est un peu à l'Italie ce que Raymond Loewy est à l'Amérique, ou Paul Jaray aux pays de l'Est. De nombreux constructeurs et carrossiers font appel au styliste. Il conçoit le petit spider Fiat Balilla Coppa d'Oro, aux lignes simples et élégantes.
Au début des années 30, Ghia fabrique avec succès les premières Balilla Coppa d'Oro, avant que Fiat ne reprenne le design en interne, et les produise lui-même après de minimes retouches. Copyright Revelli de Beaumont dessine de somptueuses berlines sur base Fiat, Lancia et Alfa Romeo. Au domaine aéronautique, il emprunte des formes, des motifs, des matériaux et des procédés de fabrication. Tout l'enjeu est d'adapter l'aspect des automobiles aux performances en hausse. Alors il n'hésite pas à profiler les garde-boue à la manière des ailes d'avion, et à raboter les parties arrière. De manière définitive, avec Revelli de Beaumont, l'automobile s'affranchit de son lointain héritage hippomobile. Il reste à déterminer un juste équilibre entre habitabilité et abaissement des formes, car les châssis des grandes marques sont encore hauts. Après-guerre, Revelli de Beaumont ne reprendra pas sa collaboration avec Ghia. Gian Paolo Boano, jusqu'en 1955 Gian Paolo Boano, né en 1930, est le fils unique de Mario Felice Boano. Dès son plus jeune âge, il se découvre une vraie passion pour l'automobile. Il semble avoir les qualités requises pour succéder un jour à son père. Curieusement, celui-ci ne l'encourage pas à poursuivre ses études. Au contraire, il est pressé de le voir rejoindre Ghia, ce qu'il fait à l'âge de 17 ans. Uberto Capalbi, ancien de chez Farina, le prend sous son aile, et lui apprend le dessin. Son père Mario Felice Boano est de la vieille école. Il compense son manque de compétence en matière de dessin par un coup d'oeil exceptionnel. Il sait mieux que quiconque grâce à des indications pertinentes obtenir d'un ouvrier modeleur le résultat escompté. Et il a de grandes ambitions pour son fils, et souhaite qu'il devienne meilleur que lui.
Mario Felice Bonao et son fils Gian Paolo Boano avec la B. Junior 2. Copyright Le jeune Gian Paolo est au sein de la carrosserie un véritable touche-à-tout. Il peut dessiner des accessoires, comme accompagner son père chez un fournisseur, ou trouver l'artisan qui saura répondre aux besoins de Ghia. C'est pour lui une école d'apprentissage exceptionnelle. Il apporte un vent de fraîcheur et commence à prendre des responsabilités dans l'étude des projets. Il recherche la modernité. Gian Paolo quittera Ghia quelque temps après son père, pour le rejoindre. Giovanni Savonuzzi, 1953-1957 Giovanni Savonuzzi fait ses débuts chez Fiat, dans la branche aéronautique d'abord, puis dans celle de l'automobile, auprès notamment de Dante Giacosa. C'est ce dernier qui en 1945 le met en contact avec Piero Dusio, le père des Cisitalia. On doit ainsi à Savonuzzi la Cisitalia D46, et les Cisitalia aérodynamiques. Il a sur ces dernières mis à profit son expérience aéronautique. En 1948, il s'installe à son compte. Outre ses compétences techniques, Giovanni Savonuzzi développe un certain talent pour dessiner des carrosseries à la fois belles et impressionnantes.
Giovanni Savonuzzi chez Ghia. Il est par ailleurs professeur à l'Ecole Polytechnique de Turin. Copyright Ami intime de Luigi Segre, il commence à collaborer avec Ghia avant le départ des Boano père et fils. Libre de tout engagement, Giovanni Savonuzzi se laisse convaincre en 1953, sans trop de difficulté, de se mettre au service exclusif de Ghia en tant que salarié. Il est nommé directeur technique. C'est plus qu'un styliste. Ghia bénéficie d'une compétence qui lui a souvent fait défaut.
Au premier plan, de gauche à droite, Giovanni Savonuzzi, Virgil Exner et Luigi Segre au Salon de Turin 1954. Copyright Sa présence chez Ghia est vite remarquée. Le carrossier propose des formes inédites, qui font progresser la carrosserie italienne, et qui permettent de dynamiser la relation avec Chrysler, par des propositions nouvelles. Les idées arrivent non plus exclusivement d'Amérique, mais traversent aussi l'Atlantique depuis l'Italie. Savonuzzi instaure chez Ghia une organisation plus structurée, et des méthodes de travail clairement définies. Il a un certain talent pour repérer les compétences, et en tirer le meilleur profit. C'est un manager, qui va composer une équipe plus solide que jamais, capable de répondre aux demandes les plus complexes, en utilisant les techniques les plus récentes. Au sein du bureau d'études, il est épaulé par Sergio Coggiola, et à partir de 1956 par Sergio Sartorelli. Parmi les jeunes recrues, Sovonuzzi repère aussi la qualité du travail de Bruno Sacco, expert dans la présentation de projets à l'aérographe, une technique alors récente.
Luigi Segre et Giovanni Savonuzzi, 1955. Copyright Les compétences de Giovanni Savonuzzi et sa sensibilité artistique sont si appréciées chez Chrysler que le constructeur américain l'invite à ne plus travailler que pour eux. Le projet dont il a la charge n'est ni plus ni moins que l'étude de la voiture du futur, équipée d'une turbine. Il quitte donc Ghia en 1957 pour s'installer aux Etats-Unis. Luigi Segre perd un homme important dans son dispositif, comme quand il a perdu Mario Felice Boano en 1954.
Giovanni Savonuzzi au centre en tenue claire, devant une Chrysler Turbine. Copyright Sergio Sartorelli naît en 1928 à Alessandria, en Italie. Sa passion pour tout ce qui bouge et qui prend appui sur quatre roues le conduit à dessiner divers engins sur ses cahiers, d'abord à l'école, puis à la faculté, pendant ses cours d'ingénierie. C'est à cette époque qu'il travaille occasionnellement comme modéliste pour la carrosserie Boano, fondée par Mario Felice Boano durant son intermède Ghia/Fiat. Quand il cherche un emploi à plein temps, Boano, qui est sur le point de créer le Centro Stile Fiat, ne lui répond pas. Pinin Farina décline son offre de service. Au final, c'est chez Ghia qu'il est recruté par Luigi Segre. Il y fait ses débuts en avril 1956, et très vite s'engage avec Tom Tjaarda sur des dossiers importants.
Salon de Turin 1957. Tout à gauche, on reconnaît Tom Tjaarda, suivi par Sergio Coggiola et Sergio Sartorelli. Au centre, en tenue foncée, Luigi Segre. Si vous identifiez d'autres personnes : marioboano@gmail.com. Copyright Après le départ de Pietro Frua puis de Tom Tjaarda, Sergio Sartorelli prend la responsabilité du design chez Ghia. Il a en charge le projet du cabriolet Innocenti 950. Il dessine également plusieurs autres voitures, souvent uniques, comme une Maserati 5000 GT (1961), le break Fiat 1300/1500 (1961) ainsi que des déclinaisons du coupé Fiat 2300 S, notamment un break de chasse et un cabriolet (1962). Hélas, Fiat ne manifeste aucun intérêt pour ces deux propositions. La Ghia 1500 GT a plus de succès, avec 846 exemplaires vendus entre 1963 et 1967. Inspirée par le dessin de la 1500 GT, la Ghia G.230/S ne connaît pas le même destin. En février 1963, Luigi Segre décède subitement à l'âge de 44 ans. Sergio Sartorelli retrouve son indépendance, tout en continuant de travailler pour le carrossier en tant que consultant. Ainsi, il adresse régulièrement des esquisses et des dessins à Sergio Coggiola et Filippo Sapino, qui sont désormais à la tête du style chez Ghia. En 1968, Sergio Sartorelli prend en charge les études prospectives chez Fiat. En 1984, il fonde son propre studio, avant de cesser toute activité professionnelle en 1988. Virgil Exner Junior, jusqu'en 1961 Virgil Exner Junior, le fils du responsable du style chez Chrysler, a terminé ses études en beaux-arts. Après avoir fait son service militaire en Allemagne, il est recruté chez Ghia. On s'en doute, c'est un peu le protégé de Luigi Segre, qui entretient d'excellentes relations avec son père. Quand Tom Tjaarda quitte Ghia en 1960 , il laisse le champ libre au jeune homme. Tout le monde pense que le poste de Tjaarda va naturellement lui revenir. Il n'en est rien. En effet, la mort de Luigi Segre prive Virgil Exner Junior de son plus fort soutien. Son père vient de quitter Chrysler pour ouvrir un cabinet indépendant. Exner Junior a tout intérêt à le suivre, plutôt que de végéter chez Ghia. C'est ce qu'il fait en 1961. Durant son court passage à Turin, il a tout de même eu le temps de laisser son empreinte sur quelques réalisations. En 1967, il rentre chez Ford. Sergio Coggiola, né en 1928, est recruté chez Ghia au début des années 1950 en tant que ... magasinier. Il arrive de chez Frua où il a exercé une fonction similaire. Quand le différend éclate entre Luigi Segre et Mario Felice Boano en 1954, Coggiola se range dans le camp de Segre, " vainqueur " de la querelle. Après le départ de Boano, Coggiola est promu au bureau technique, où il démontre toute sa valeur. Savonuzzi lui permet de parfaire ses compétences. Puis il se met au service de Sartorelli, qui lui accorde toute sa confiance. Coggiola devient un excellent technicien de la carrosserie, et la coopération entre les deux hommes est fructueuse. Deux structures travaillent en parallèle chez Ghia. Mais si elles sont indépendantes, rien ne les empêche de se concerter. Un groupe d'hommes est placé sous la direction de Coggiola. Il se concentre sur les commandes de Chrysler. Dans la relation avec Chrysler, Coggiola est le coordinateur entre les demandes en provenance des Etats-Unis et leur concrétisation chez Ghia. Il traduit notamment en dessins techniques les esquisses et maquettes qui lui parviennent. En matière de style, il n'y a pas grand-chose à faire. L'essentiel arrive d'Amérique. Mais c'est une excellente école. L'autre groupe, placé sous la direction de Sergio Sartorelli, s'occupe des commandes des grands constructeurs européens, comme Renault ou Volkswagen. Il réalise aussi les prototypes qui sont exposés lors des salons européens, en particulier celui de Turin, d'une importance majeure pour Ghia. Quand Sartorelli quitte Ghia, Coggiola estime avoir toute la légitimité nécessaire pour lui succéder. Mais à sa plus grande déception, il doit partager cette responsabilité avec Filippo Sapino. Il décide donc de quitter Ghia, pour fonder sa propre affaire. Il décède en 1989. Tom Tjaarda, 1958-1960 Tom Tjaarda est le fils du designer américain d'origine hollandaise Johan " jan " Tjaarda van Sterkenberg, plus connu sous le nom de John Tjaarda. Il naît le 23 juillet 1934 à Détroit. Il étudie de 1953 à 1958 l'architecture à l'université du Michigan. L'un de ses professeurs en dessin industriel, Aarre Lahti, valide la pertinence de son projet. Il souhaite réaliser un modèle à l'échelle 1/10ème d'une voiture sportive. Aarre Lahti a l'année précédente rendu visite aux Italiens Pinin Farina et Ghia. Chez Ghia, Luigi Segre lui a fait part de son désir d'accueillir l'un de ses étudiants motivé par le style automobile. C'est ainsi que Tom Tjaarda est introduit chez Ghia, où il est embauché en août 1958. Luigi Segre est convaincu que l'arrivée d'un styliste américain peut être de nature à resserrer les liens déjà étroits avec Chrysler.
Tom Tjaarda, concepteur automobile, a passé presque toute sa carrière, s'étalant sur cinq décennies, en Italie. Il a vécu la grande époque du style italien, dans les années 1960 et 1970. Copyright Le jeune homme fait son apprentissage auprès de Sergio Coggiola. Par sa personnalité, Luigi Segre impressionne Tjaarda. Partager son existence professionnelle avec une telle personnalité n'est pas de tout repos. Autant il peut par moment être attentif, généreux, autant il peut quelques instants plus tard devenir d'une dureté inouïe. Tom Tjaarda qui n'en peut plus quitte Ghia. Le jeune designer ne peine pas à retrouver du travail. Il contacte Pinin Farina qui l'embauche aussitôt. Pietro Frua, 1957-1959 Savonuzzi n'est plus là. Il manque à Ghia. Il était en effet capable de superviser tout le processus de conception et de production, avec tantôt sa casquette d'ingénieur, tantôt sa casquette de styliste. Ghia, ce n'est plus la petite carrozzeria des débuts. Chacun a un rôle déterminé, clairement précisé dans un organigramme. Luigi Segre ne trouve pas en interne le candidat idéal pour remplacer Savonuzzi. Il signe alors un accord de coopération avec Pietro Frua, qui met en liquidation la société qu’il a créée dix ans plus tôt, et qui devient le nouveau responsable du style de Ghia. De l'entreprise de Pietro Frua, il ne reste juridiquement que la marque.
Pietro Frua (1955) cumule les fonctions de directeur, projeteur, contremaître. Sa bonhomie vient à bout de toutes les difficultés. Copyright Pour le compte de Renault, Pietro Frua lance l'étude de la Floride. La proposition de Ghia séduit les décideurs de la Régie. Ils envisagent même de confier l'assemblage d'une petite série au carrossier. Pour Luigi Segre, il est hors de question de laisser passer cette opportunité. Il se souvient encore des contrats perdus avec Lancia et Alfa Romeo faute de capacité de production, et qui ont profité à Pinin Farina et Bertone, tandis que Ghia faisait du sur place. Segre, en faisant appel à Pietro Frua, peut vendre ses services sous le nom de ce dernier, sans attirer le courroux de Fiat, qui pourrait voir d'un mauvais oeil cette intrusion en territoire italien du principal constructeur français. Pour la première fois depuis dix ans, Pietro Frua est absent du Salon de Turin 1958. Dans les annuaires professionnels, la marque Frua est désormais domiciliée à l'adresse de Ghia. Les deux parties y trouvent leur compte. Pietro Frua est débarrassé des contraintes liées à la gestion quotidienne d'une entreprise, et peu entièrement se consacrer à son métier de styliste. Luigi Segre s'offre les services d'un designer reconnu, un homme d'envergure capable d'intégrer toutes les contraintes liées à la création d'une automobile.
Pietro Frua. Copyright Les affaires de Ghia sont florissantes. Le contrat avec Chrysler est rémunérateur. Travailler avec Renault est une vitrine par le carrossier de Turin. D'autres grands constructeurs frappent à la porte : Volkswagen, Porsche, Volvo, Austin ... Luigi Segre exige de ses collaborateurs le secret professionnel absolu. Il le doit à ses clients. Rien de doit filtrer au sujet des études en cours. La règle est la même pour tout le monde, y compris Pietro Frua. Celui-ci, autrefois libre et indépendant, souffre de travailler avec ces contraintes. Un différend voit le jour entre Luigi Segre et Pietro Frua. Il porte sur la paternité du dessin de la Renault Floride. L'affaire sera portée en justice. Souhaitant retrouver sa liberté, Frua se détache de Ghia. Il ouvre en 1959 un bureau d'étude indépendant, Studio Technico Pietro Frua. Filippo Sapino naît en 1940. Il suit une formation à l'Ecole Polytechnique de Turin. En 1960, il rentre chez Ghia en tant que simple dessinateur, assistant de Sergio Sartorellli et de Sergio Coggiola, avec qui il apprend les rudiments du métier. Il travaille sur différents projets, notamment la Ghia 1500 GT et la Karmann Ghia Type 34. Il signe le dessin du coupé Renault 8 " goutte d'eau ", et celui de l'AC Cobra modernisée. A mesure que le temps passe, la voie s'éclaircit dans la hiérarchie des designers. Après le départ de Savonuzzi, Tjaarda, Sartorelli et Coggiola, Sapino reste seul en place, jusqu'à l'arrivée de Giorgetto Giugiaro en 1965. Mais celui-ci ne tarde pas à faire de l'ombre à Sapino, qui comprend que l'intégration d'un tel talent ne peut que nuire à ses ambitions. Il évoque avec sincérité son embarras à Giacomo Gaspardo Moro, qui n'hésite pas à le recommander à Sergio Pininfarina, qu'il rejoint en 1967. Sapino reviendra chez Ghia en 1973.
Filippo Sapino. Copyright Giorgetto Giugiaro, 1965-1968 Giorgetto Giugiaro vient d'un petit village du Piémont, où son grand-père et son père étaient fresquistes de maisons aristocratiques et d'églises. Le paternel qui restaure des églises l'inscrit dans une école technique à Turin, où il est censé préparer l'Académie des beaux-arts. Mais son plaisir est de dessiner des voitures. Son professeur de dessin s'en aperçoit, et au lieu de le flanquer à la porte, il lui explique qu'il est le cousin de Dante Giacosa, le directeur des études de Fiat. A 17 ans, Giugiaro est engagé chez le géant turinois. C'est un dessinateur parmi d'autres. Trois ans plus tard, remarqué pour ses remarquables aptitudes, Nuccio Bertone l'engage comme chef styliste, et lui confie la responsabilité totale du design. Mais ce chef styliste est un général sans troupe. L'atelier de dessin, c'est lui, et lui seul. En 1965, Giacomo Gaspardo Moro apprend par un journaliste turinois que le jeune Giorgetto Giugiaro a l'intention de quitter Bertone. Ghia, en mal de talent, a absolument besoin de recruter une signature comme celle de Giugiaro, même si à cette époque il est encore relativement peu connu, sauf dans les milieux professionnels. Le dossier est sensible. Bertone s'inquiète de voir partir ce jeune homme aux compétences exceptionnelles. Moro reste en retrait, et ne prend aucune initiative. C'est une question d'honnêteté et de respect vis à vis de son confrère. Les amis de Moro insistent. S'il ne fait pas le premier pas, Moro va très vite se faire doubler par un concurrent. En définitive, c'est Giugiaro qui prend les devants, et contacte Moro en lui disant " On m'a dit que vous vouliez me voir ... ". Le soir même, les deux hommes se rencontrent. Les prétentions de Giugiaro sont si modestes que Moro lui propose directement le double. Dès le lendemain, par correction, Moro informe Nuccio Bertone, qui prend assez mal la chose ... Pendant quelque temps, les relations vont demeurer assez tendues entre les deux hommes.
Giorgetto Giugiaro. Copyright Giugiaro arrive chez Ghia en décembre 1965. Quitter Bertone a été difficile, car il s'y sentait à son aise. En six ans, il a donné le jour à 25 projets. Il a acquis une solide maîtrise quant à la conception des volumes, des surfaces et des lignes ... Son coup de crayon est remarquable. Il sait concilier les exigences techniques qui déterminent la faisabilité d'un projet avec des dessins conformes aux règles d'homologation imposées par différents pays. Chez Ghia, il ne connaît personne, et il doit tout recommencer à zéro. A 27 ans, ce n'est pas simple de se faire respecter par les plus anciens. Il travaille d'abord sur les deux projets qui seront présentés au public dans trois mois au Salon de Genève. Le designer n'intervient qu'à la marge sur la 450 SS, en modifiant quelques détails, comme la calandre ou les projecteurs, sans altérer la forme initiale. L'Isuzu 117 Coupé est par contre la première vraie étude que Giugiaro aborde dans sa nouvelle fonction de directeur du style. Ghia présente quatre nouveautés au Salon de Turin 1966 : Maserati Ghibli, De Tomaso Mangusta, De Tomaso Pampero, et Fiat Venessa. Avec la Ghibli, Moro espère surtout donner naissance à un couple Maserati/Ghia, à l'image de celui que forme avec bonheur Ferrari et Pininfarina. La Mangusta est conçue en réaction à l'échec de la Cobra de 1964 imaginée par Sapino. La Pampero est une version découverte de la Vallelunga. La Vanessa, une voiture conçue pour les femmes, peut apparaître avec le recul du temps comme une maladresse en matière de concept. Giugiaro et Moro entretiennent d'excellentes relations. Quand le premier demande au second s'il peut assister à la conférence de presse du Salon de Turin, la réponse est évidemment positive. Giugiaro ne veut pas se fondre dans une équipe et rester dans l'anonymat, même si les initiés savent reconnaître au premier coup d'oeil son style. C'est pourtant ce qui se passe d'une manière générale chez Pininfarina par exemple, où l'image du carrossier doit primer sur celle des designers qui oeuvrent dans l'ombre. Lors de ce Salon, la presse et le public assistent à la naissance d'une étoile à la réputation bientôt internationale. Le jeune homme est en train de prendre la direction du firmament du design automobile. On parle même de lui en dehors du secteur automobile. Giugiaro s'engage auprès de Moro pour trois ans. Ghia change en 1967 de propriétaire et de gestion, avec l'arrivée à la tête de l'affaire d' Alejandro De Tomaso, qui impose ses idées, même sur le style. Le jeune designer ne supporte pas cette situation, et démissionne la même année que Moro et Capitani. Il n'est certes plus salarié, mais reste consultant. De Tomaso a en effet besoin de lui, pour mener à leur terme les projets en cours. Deux voitures sont en cours de développement. Il y a d'abord le projet de remplacement du taxi américain Checker, puis plus glamour, l'étude de la Maserati Sumun. Tom Tjaarda, 1968-1977 Les arrivées et les départs de personnalités du design automobile se succèdent chez Ghia dans les années 60. La confusion bat son plein. Ce n'est pas terminé. Tom Tjaarda revient chez Ghia en 1968. Il avait quitté l'entreprise dans les belles années du contrat avec Chrysler. A cette époque, de jeunes talents étaient attirés par le prestige de la célèbre griffe automobile. A son retour, il trouve un bureau de style quasiment désert. Sous son impulsion naissent en 1969 trois nouveaux prototypes, la Lancia Fulvia Competizione, la Lancia Marica et la Serenissima. Puis il se lance dans l'étude de la De Tomaso Pantera de 1970. Tom Tjaarda dessine également la berline De Tomaso Deauville et le coupé De Tomaso Longchamp. Ces trois modèles de grand tourisme sont équipés d’un moteur V8 Ford. Les voitures produites (concept cars, modèles uniques, série) 1946/49 Au sortir de la guerre, Ghia habille volontiers des châssis avec des carrosseries au style flamboyant, c'est-à-dire franchement tape à l'oeil, à la manière de ce qui se fait en France depuis la fin des années 1930. D'ailleurs, nombre de châssis proviennent de chez Talbot, Delage ou Delahaye. A défaut d'être fonctionnelles, ces automobiles plaisent à une certaine clientèle, restreinte certes, mais qui considère qu'une automobile doit être le reflet du statut social de son propriétaire. Il s'agit encore d'épater la galerie. Leur usage est évidemment limité aux grandes occasions, les sorties au restaurant, la promenade dominicale ... L'époque est aux concours d'élégance, où ces voitures remportent un succès certain. En France, Saoutchik ou Figoni excellent dans ce genre.
Sur des châssis de taille moyenne, comme celui de cette Fiat 1500, la carrosserie submerge quelque peu le châssis qui la porte. Copyright
La calandre agressive, les grands cadres de phare et les roues cachées caractérisent cette Fiat 1500 de 1946 à la ligne flamboyante, proposée par Mario Felice Boano et Giorgio Alberti, d'après une idée d'Uberto Capalbi. Copyright Un styliste reste rarement plus de quelques années chez un carrossier. A cette époque, c'est un usage qui permet de faire circuler les idées, et à ces professionnels de s'enrichir de nouvelles expériences. Dans ce contexte, Mario Felice Boano sait s'entourer. Il se fait aider par d'anciens collègues de la période Farina, notamment Fedele Bianco. Celui-ci reprend le rôle de Revelli de Beaumont, qui n'exerce plus après la guerre pour Ghia. Uberto Capalbi, ex Farina, apporte sa pierre à l'édifice. Il serait à l'origine des carénages métalliques amovibles sur les roues, déjà vus sur certaines automobiles de luxe françaises de la fin des années 1930. Cet accessoire, s'il apporte un bénéfice esthétique, oblige le styliste à élargir les flancs afin de permettre un braquage convenable.
Alfa Romeo 6C 2500 Sport Cabriolet, 1948. C'est en 1939 qu'Alfa Romeo présente la série 6C 2500. Ce haut de gamme se distingue par sa sophistication technique. Trois châssis sont proposés, de plus long au plus court : Tourisme, Sport et Super Sport. Le premier est le plus souvent habillé en conduite intérieure ou en limousine, le second en berline, le troisième en coupé ou cabriolet. Copyright
Alfa Romeo 6C 2500 Sport Cabriolet, 1948. Cette Alfa Romeo 6C 2500 Sport Cabriolet est d'un style qui reste ancré dans les années 1930. La voiture est présentée par le Prince Dado Ruspoli au Concours d'élégance de Florence en juin 1949. CopyrightLe style automobile est en pleine mutation, surtout en Italie, pays précurseur. Deux voies s'affrontent, d'une part la carrosserie traditionnelle, qui reste attachée aux excès des années 1930 (c'est le choix des carrossiers français), d’autre part un style nouveau qui s'esquisse en Italie depuis l'apparition en 1947 du coupé Cisitalia 202 de Pinin Farina. Ce style nouveau marie la carrosserie ponton à une certaine finesse de ligne. Il est à l'origine de l'école turinoise qui va s'imposer en ringardisant le style traditionnel. Ghia se situe au carrefour de ces deux tendances. La sensibilité de Mario Felice Boano lui permet d'intégrer les différents courants pour les traduire sur de nouveaux modèles, produits à l'unité ou en petite quantité.
Delahaye 135 Cabriolet 1949. Mario Boano semble attiré par le carénage intégral des carrosseries, qui procure aux automobiles un effet visuel de fluidité et de vitesse. Copyright
Delahaye 135 Cabriolet 1949. Ce cabriolet 135 carrossé par Ghia est exposé au Salon de Genève 1948. Le châssis français affiche aux yeux de la plupart des carrossiers les dimensions idéales pour être habillé avec élégance. Copyright
Delahaye 135 Coupé, 1949. Ghia dévoile sa propre interprétation de la Delahaye 135. Cette silhouette sera dupliquée sur des châssis de différentes marques françaises et italiennes. Copyright 1948 La Lancia Aprilia fait ses débuts au Salon de Londres, puis à celui de Paris, à l'automne 1936. Sa fabrication est lancée au printemps 1937. Les essais de l'Aprilia publiés dans la presse d'époque sont extrêmement élogieux. Les journalistes vantent sa maniabilité, sa tenue de route, ses freins, la nervosité de son moteur et son confort. La production reprend après la guerre, puis s'arrête le 22 octobre 1949 pour faire place nette à l'Aurelia. A quelques exceptions près, comme ce spider de 1948, les Aprilia à carrosserie spéciale ne font pas oublier la berline d'usine plutôt réussie.
Ce sobre spider Gran Sport de Ghia est produit à deux ou trois exemplaires en 1948. Il apparaît comme l'une des plus réussies de toutes les Aprilia à carrosserie spéciale. Copyright 1949/50 Mario Felice Boano introduit en 1949 les modèles Gioiello (pour bijou en français), habillés dans le style nouveau, qui tourne le dos à toutes les fioritures du passé. Les formes sont simples, essentielles. Mario Felice Boano fait le choix de s'adresser à une clientèle plus jeune, tournée vers l'avenir, plus ouverte à la nouveauté, celle qui saura par sa fidélité assurer la pérennité de Ghia. Les châssis sont moins onéreux, car empruntés aux Fiat 1100 et Lancia Aprilia.
Alfa Romeo 6C 2500. Ce coupé sportif adopte une calandre " coupe-frites ". Cette particularité sera considérée après coup comme une erreur, car les réalisations des prochaines années reprendront la calandre traditionnelle. Telle qu’elle se présente, on pourrait presque prendre cette Alfa Romeo pour une Ferrari. Copyright
Fiat 1100. Sirca de Milan est l'un des distributeurs Ghia les plus actifs. Il présente cette voiture en tant que Sirca-Ghia. Pour autant, aucun contrat particulier ne lie les deux maisons. Copyright Ghia propose sur une idée originale de Giovanni Michelotti, qui travaille pour le carrossier en tant que styliste indépendant, la nouvelle ligne dite Supergioiello. Ce faisant, Ghia tourne définitivement le dos au style flamboyant.
Cette Lancia Aprilia Supergioiello dessinée par Michelotti est présentée par Ghia au Concours d'Élégance de la Villa d'Este en 1949. Quelques exemplaires auraient été assemblés. Ce dessin a également été utilisé sur un châssis de Fiat 1500. Copyright
Fiat 1500 Supergioiello. En 1949, cet exemplaire est exposé au Salon de Genève et aux Concours d'Elégance de Rome et de la Villa d'Este en 1949. Une carrosserie similaire est utilisée sur un châssis Lancia Aprilia. Copyright
Alfa Romeo 6C 2500 SS Coupé Supergioiello. Ghia adapte la carrosserie Supergioiello sur des châssis totalement différents quant à la taille et à la sophistication, depuis la Fiat 1100 jusqu'à l'Alfa Romeo 6C 2500 SS. Copyright
La Fiat 1400 Supergioiello de Ghia est présentée au Salon de l'auto de Turin 1950. Son style va inspirer celui de la Lancia Aurelia B20 dévoilée un an plus tard. Copyright 1950 Mario Revelli de Beaumont cesse de travailler pour Ghia lorsque éclate la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut cependant pas s'étonner de voir encore en 1950 des carrosseries portant son empreinte. L'auteur de leur dessin est Fedele Bianco, ami et ancien collègue de Mario Felice Boano. Fedele Bianco a eu l'occasion de côtoyer Mario Revelli de Beaumont. Mieux que quiconque, il a su comprendre sa manière de travailler, et se l'approprier.
Alfa Romeo 6C 2500. Fedele Bianco propose en 1950 à Mario Felice Boano cette carrosserie inspirée du style Pinin Farina de la fin des années 1930. Copyright 1950 L'époque est favorable à la carrosserie italienne. Son style innovant s'impose partout dans le monde. Le Salon de Turin est une fête, où l'on peut admirer sur tous les stands ce qui se fait de mieux. Mario Felice Boano participe à sa manière à cette révolution. Il expérimente de nouvelles idées.
Alfa Romeo 6C 2500. Cette variation de style qui touche à la calandre, avec l'abandon de la grille traditionnelle et l'implantation des phares sous des globes presque carrés fera long feu. Copyright 1950 L'étude du projet Lancia A-10 débute à l'automne 1944. Cela devait être une grosse berline sur un empattement de 2,90 mètres, dotée d'un V8 de 2 litres, avec des suspensions inédites avant à double bras longitudinaux. Il semble qu'un prototype ait roulé, avant que le projet ne soit abandonné. Cependant, vers 1947, Gianni Lancia souhaite récupérer certains de ses éléments pour un projet personnel, qui a prend la forme d'une voiture à moteur arrière sur un châssis tubulaire, avec une boîte de vitesses à présélecteur. Ce prototype est dessiné chez Ghia. A l'avant, il y a trois places de front, et la volant est au centre. Des grilles d'aération extractibles devant les passages de roues arrière suggèrent d'éventuels problèmes de surchauffe. Gianni Lancia n'a pas été jusqu'à apposer l'écusson de sa marque sur cette auto. Ce modèle nous livre la clef du code qui sera désormais adopté par Lancia pour tous ses modèles : A pour les grosses voitures, B pour les voitures moyennes, C pour les petites voitures, et D pour les voitures de course.
Lancia A-10 par Ghia. Ghia dessine et assemble pour Lancia cette berlinette deux portes sur le châssis expérimental à moteur arrière de la A-10, voiture qui n'a jamais été produite en série. Les proportions sont particulièrement ingrates. Copyright 1950/1952 Une nouvelle marque italienne de voitures de sport apparaît en 1947, Ferrari, du nom de son fondateur Enzo Ferrari (1898-1988). Son principal objectif est de surpasser Alfa Romeo. Cet objectif trouve sa source dans un différend qui a opposé Enzo Ferrari à la direction d’Alfa Romeo avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. En 1948 à Maranello, à côté des 166 S et 166 M destinées à la compétition, on réalise la version Inter, pour le tourisme rapide, en utilisant un moteur moins poussé. L'idée de produire une voiture pour une clientèle non exclusivement sportive est dictée par la nécessité de satisfaire les nombreuses demandes qui émanent du monde artistique et des grandes fortunes de la planète. La production est orientée vers un nombre très limité de châssis. Les Ferrari ne peuvent pas manquer au palmarès de Ghia, qui travaille depuis toujours avec les plus grandes marques italiennes. Touring est le plus réactif, avec des modèles très sportifs. Le binôme formé par Michelotti et Vignale offre des carrosseries plus sages. Mario Felice Boano veut proposer de bonnes voitures, bien exécutées, au dessin sobre. Mais Michelotti s'avérera plus talentueux, avec des carrosseries plus inspirées. Une seule 166 Inter sera habillée par Ghia.
En 1950, Ghia dévoile son interprétation de la Ferrari 166 Inter. Ce modèle unique est doté d’une carrosserie ponton, avec un long capot abritant le V12 de 1 995 cm3 (90 ch) et un arrière court style fastback. Il fait fonction de pré-série pour les carrosseries aménagées ensuite sur le châssis de la 195 Inter. Copyright La Ferrari 195 Inter apparue en 1950 est la version Grand Tourisme de la 195 Sport. Ce modèle à la carrière brève est produit à 25 exemplaires, habillés par Vignale, Touring, Ghia Aigle et Ghia. Le châssis est identique à celui de la 166 Inter. L'augmentation de la cylindrée de 1 995 cm3 à 2 341 cm3, soit 195 cm3 par cylindre, est obtenue par augmentation de l'alésage. Le dessin est identique à celui de la 166 Inter. Dix 195 Inter sont habillées par Ghia, avec de minimes variations de détails d'une voiture à l'autre.
Ferrari 195 Inter. Ghia réalise à la demande de Ferrari une série de dix exemplaires de cette berlinette, d'après un dessin de Mario Felice Boano. Copyright Poursuivant une politique d'augmentation de la cylindrée et des puissances des Ferrari de route, la 212 Inter prend le relais de la 195 Inter. Elle est la résultante de deux champs d'expérience assez différents, d'une part celui des 166 Inter et 195 Inter, d'autre part celui de la 212 Export de compétition. Une nouvelle augmentation de l'alésage permet d'obtenir un V12 de 2 562 cm3, soit 212 cm3 par cylindre. 78 voitures sont habillées par Farina, Vignale, Touring, Pininfarina, Ghia Aigle et Ghia. Ghia propose un coupé fastback qui n'est pas sans rappeler les carrosseries des 166 Inter et 195 Inter. La calandre est toutefois revue. Elle adopte une forme ovale plus classique. Les glaces de custode présentent un contour allongé. Ce dessin aurait été appliqué à huit voitures, avec toujours des évolutions de détail d'un exemplaire à l'autre.
Ferrari 212 Inter. Ce coupé fastback a été produit en huit exemplaires chez Ghia. Copyright Les années 1951 et 1952 sont marquées chez Ghia par la réalisation d'autres 212 Inter, notamment un coupé 2 + 2 produit en quelques exemplaires, puis quelques autres modèles uniques. Avec ce modèle, Pinin Farina débute une collaboration de près d'un demi siècle avec Ferrari, concurrençant directement Ghia qui ne saura pas résister.
Différentes réalisations Ghia sur base Ferrari 212 Inter. Copyright La première Ferrari 340 America est exposée sur le stand Touring du Salon de Genève 1951. Le V12 de 4 102 cm3 développe 220 ch. Quelques mois plus tard, Ghia expose au Salon de Paris un lourd coupé 2 + 2, qui aurait été acheté par David Brown, l'éminent propriétaire d'Aston Martin Lagonda, et principal concurrent de Ferrari.
Ferrari 340 America par Ghia, dans le même esprit que la 212 Inter 2 + 2. Copyright Ghia produit par ailleurs une série de quatre ou cinq coupés identifiables à un habitacle fastback ramassé sur l'arrière, qui dégage un capot interminable. Sur un total de 22 exemplaires de la 340 America, il n'y aurait eu que huit voitures à vocation routière.
Cette carrosserie deux places fastback a habillé au moins trois 340 America. L'une d'elles a même terminé la Carrera Panamericana 1952 en cinquième position. Copyright 1951 La présentation de la Lancia Aurelia au Salon de Turin 1950 permet au constructeur de tourner la page de la guerre. C'est avec la Fiat 1400 la première voiture italienne entièrement conçue à l'issue du conflit. Les carrossiers vont évidemment s'y intéresser. Ghia lance une multitude de carrosseries deux et quatre portes, en berline, coach et coupé.
Le nouveau modèle de Lancia constitue une base appréciée par tous les carrossiers italiens, et en particulier par Ghia. Copyright 1951 Mario Mario Felice Boano est chargé par la direction de Lancia de dessiner un coupé de grand tourisme à partir de la berline Aurelia commercialisée depuis mai 1950, héritière de la berline Aprilia (1937-1949). La berline Aurelia B10 se distingue par une ligne aérodynamique un peu potelée, et ses quatre portes s’ouvrant en armoire, selon la tradition Lancia. Le moteur V6 offre une cylindrée de 1 754 cm3, un peu plus importante que celle de l’Aprilia et ses 1 486 cm3. Le coupé deux portes Aurelia dessiné par Mario Felice Boano affiche un style ponton d’une certaine élégance, avec un long capot et une partie arrière en pente douce. Il est présenté au Salon de Turin 1951. A première vue, il s'agit pour le public d'une carrosserie spéciale parmi d'autres. A y regarder de plus près, on remarque que l'usine a doté le modèle d'une désignation particulière : B20 GT, et qu'il est construit sur un empattement plus court que celui de la berline.
Le coupé Lancia Aurelia B20 GT dévoilé en 1951 transpose la silhouette des Ferrari dessinées par Ghia sur une voiture à l'empattement plus long. L’ensemble est net et épuré. Copyright
Le coupé Lancia Aurelia B20 GT dessinée par Mario Felice Boano arrive un an après la berline B10, et constitue l'une des attractions du Salon de Turin 1951. Copyright
Cette Lancia Aurelia B20 GT peut être considérée comme un véritable chef d’œuvre au moment de son lancement. Les 98 premières voitures sont produites par Viotti pour Ghia. Copyright L'Aurelia B20 GT est intégrée au catalogue officiel Lancia. Sa carrosserie est composée d'éléments façonnés à la main et soudés sur la plate-forme fournie par l'usine. Ce procédé de fabrication est ni simple, ni économique. C'est d'ailleurs la dernière fois que Pinin Farina l'utilise pour un modèle de série. La B20 GT mesure 4,37 mètres de long et 1,36 mètre de haut. C'est le carrossier Viotti qui fabrique les 98 premiers exemplaires. Le succès commercial est au rendez-vous, mais Ghia et Viotti qui manquent de capacité sont incapables de répondre à la demande. Le contrat est repris par Pinin Farina qui va apporter au fil des années des modifications mineures, pour en faire l'archétype du coupé de grand tourisme. 3 871 coupés B20 GT sont fabriqués entre 1951 et 1958 sur un total de 18 419 Aurelia.
Pinin Farina qui va assurer l'essentiel de la production n'apposera jamais son écusson sur la carrosserie. Cela ressemble à une forme de respect pour le travail de Ghia. 1951/1952 Le public découvre au Salon de Turin 1951 un projet de berline deux portes pour le Britannique Armstrong Siddeley, qui en dépit de ses dimensions supérieures, reprend certains thèmes exploités sur les Ferrari habillées par Ghia. La voiture est réalisée en deux versions qui ne diffèrent que par des détails.
Le coupé Armstrong Siddeley Whitley carrossé par Ghia en 1951 s'apparente à un croisement entre l'esthétique nouvelle italienne et le traditionalisme britannique. C'est la version dotée des phares additionnels qui est dévoilée au Salon de Turin 1951. Copyright Ghia reprend en 1952 ce dessin pour l'appliquer à une Riley.
Dans le même esprit que l'Armstrong Siddeley, Ghia présente au Salon de Turin de 1952 ce coach Riley. Copyright 1952 En 1952, Gian Paolo Boano se lance dans l'élaboration de sa première carrosserie. Son père baptise non sans un certain orgueil ce prototype du nom de B. Junior. D'inspiration américaine, ce coupé trois places, présenté au Salon de Turin dans une livrée noir-vert, est réalisé sur une base de Fiat 1900. La même année, la B. Junior est exposée à Paris, avec une calandre modifiée et une nouvelle teinte gris et amarante. Par ailleurs, Gian Paolo Boano présentera à Turin en 1953 la B. Junior 2, sur un châssis de Lancia Aurelia.
Les deux chefs-d'œuvres de jeunesse de Gian Paolo Boano, la B. Junior et la B. Junior 2. Copyright 1952 On retient de cette Lancia Aurelia B55 la présence d'un pare-brise panoramique, peu courant en 1952. Ceux-ci ne se généraliseront qu'à partir de 1955, en particulier aux Etats-Unis. La lunette arrière adopte le même principe, toujours en une seule pièce.
Ce prototype sur châssis B55 ne constitue pas une réussite esthétique. On remarque son pare-brise et sa lunette arrière panoramiques, ainsi que la disposition des doubles phares regroupés verticalement. Copyright 1952/53 La Fiat 1400 est révélée au Salon de Genève, en mars 1950. Elle est alors disponible en berline, cabriolet et châssis nu. Comme pour toutes les voitures italiennes de série, nombreuses sont les adaptations faites autour de ce modèle. La quasi-totalité des carrossiers italiens s'y intéresse, d'Allemano à Zagato, en passant bien évidemment par Ghia, avec différentes déclinaisons.
Berline et Cabriolet Fiat 1400, 1953/53. Copyright 1953 Ghia présente au Salon de Paris cette nouvelle approche de la Porsche 356, intéressante sans être exaltante. On imagine aisément qu'il est difficile de remplacer celle qui est en train de devenir un classique. On devine déjà certains traits de style qui seront repris sur la VW Karmann Ghia.
Ghia Porsche Spyder. L'avant de ce prototype présente un ovale solide aux bords chromés, avec trois barres transversales. Sa valeur esthétique et discutable. Copyright 1953 Le coupé Alfa Romeo 1900 C dévoilé en 1953 semble résulter de différents courants. Il est impossible d'attribuer ce dessin à un styliste en particulier. Quelle est la part des Boano père et fils, quelle a été l'influence de Michelotti ? Le traitement du pavillon est dans la lignée des précédentes créations de Ghia. Par contre le dessin de la partie avant, c'est-à-dire la grille de radiateur et les prises d'air qui l'encerclent, est original, même s'il semble puiser son inspiration auprès des réalisations de Virgil Exner, sur base Chrysler.
Alfa Romeo 1900 C coupé. Deux prises d'air de chaque côté du radiateur accueillent des phares ronds et une simple lame qui brise le vide ambiant. Copyright 1953 En 1953, Cisitalia est une marque récente qui s’est surtout fait connaître par son coupé type 202 dévoilé en 1947, oeuvre de Pinin Farina, qui a révolutionné le design automobile. Au Salon de Genève en mars 1953, Ghia présente le coupé Cisitalia 505 DF, inspiré des coupés que le carrossier turinois réalise pour Chrysler. La silhouette est d'un style très classique à trois volumes. Les lettres DF signifient Derivata Fiat. En effet, ce modèle, qui sera produit à une dizaine d’exemplaires, est basé sur la berline Fiat 1900 (1952-1959), dont il emprunte le quatre cylindres de 1 901 cm3 à arbre à cames en tête. Indiscutablement, cette Cisitalia n'a pas laissé la même trace dans l’histoire automobile que la 202 de 1947.
Présentée par Ghia en 1953, la Cisitalia 505 DF se veut d’un classicisme absolu. Copyright 1953 L'un des amis de Giovanni Savonuzzi, Virginio Conrero, préparateur automobile réputé, lui demande en 1953 de l'aider à concevoir une voiture destinée à l'un de ses clients, de nationalité suisse, désireux de participer aux Mille Miglia de 1953. Savonuzzi et Conrero ont déjà travaillé ensemble chez Fiat Avio et Cisitalia. Cette association donne naissance à une voiture totalement originale, à châssis tubulaire, qui emprunte certains éléments mécaniques aux Fiat 1400 et Lancia Aurelia. Le moteur est celui de l'Alfa Romeo 1900, retravaillé par Abarth, et mis au point par Conrero. Ayant affaire à une auto insuffisamment performante par rapport à la concurrence, le pilote abandonne après seulement quatre heures de course. Par contre, le public découvre une carrosserie qui va faire date.
Alfa Romeo 1900 Conrero/Abarth/Ghia. Cette voiture est réalisée pour un client suisse de Virginio Conrero, en quête d'une voiture pour participer aux Mille Miglia. Copyright 1953
L'Automobile, juin 1953, numéro 86. Une belle couverture, mais aucune information au sujet de l'Autobleu en pages intérieures. Copyright Autobleu est un accessoiriste automobile français installé à Paris, dans le 17eme arrondissement. L'entreprise est dirigée depuis 1950 par Messieurs Mestivier et Lepeytre. Spécialisé dans les tubulures d'admission permettant d'augmenter la puissance des moteurs, Autobleu est bien décidé à devenir un véritable constructeur automobile. L'idée de départ est de proposer à partir d'un modèle populaire un coupé élégant, aux lignes légères, dont l'assemblage et la finition ne doivent souffrir d'aucune critique. Les deux associés s'adressent en 1952 à Ghia. Le coach Autobleu étudié à Turin semble s'inspirer des Ferrari dessinées par Ghia entre 1950 et 1952, dans des proportions plus modestes évidemment. Le premier prototype réalisé sur une base de 4 CV aiguise l'appétit de la Régie. Le 747 cm3 est porté de 21 ch à 25 ch.
Michèle Morgan, l'une des premières clientes, pose à côté d'un coach Autobleu, dans une teinte camaïeu bleu-vert coordonnée aux yeux de l'actrice. Luis Mariano et Eddie Constantine tomberont aussi sous le charme de cette automobile. Copyright Autobleu se voit proposer par Renault la diffusion de ce magnifique coach dans son réseau de concessionnaires. Deux voitures doivent être prêtes pour le Salon de 1953, que Figoni de Boulogne-sur-Seine doit assembler. Elles sont terminées à temps. La mise en production soulève de nombreuses difficultés, malgré le soutien " moral " de la Régie. Figoni est incapable de suivre le rythme. Autobleu s'adresse alors à Pourtout, de Rueil-Malmaison. Mais cette fois, c'est la finition qui laisse à désirer. Finalement, en 1956, Autobleu se tourne vers Chapron, à la réputation parfaitement établie, qui va assurer la production. 81 exemplaires verront le jour.
Luis Mariano et Eddie Constantine tomberont aussi sous le charme de cette automobile, représentative d'une nouvelle forme de luxe à la française. Copyright On remarque la grande lunette arrière panoramique qui n’a plus rien à voir avec la petite vitre de la 4 CV d’origine, la technique permettant désormais de réaliser de tels vitrages arrondis et de grande surface en une seule pièce. Chapron fait vite preuve d'indépendance en modifiant la face avant de la voiture. Les deux avertisseurs sonores Sanor jugés disgracieux sont enlevés. Le carrossier de Levallois présente au Salon de Paris 1956 un cabriolet de sa conception. Le dernier coach est livré en 1958.
Autobleu coupé. Basé sur une Renault 4CV, ce coupé reprend sous des dimensions réduites des thèmes déjà exploités par Ghia, comme le dessin de la ligne de caisse et les hanches marquées. S’y ajoute une lunette panoramique du plus bel effet. Copyright 1953 De 1953 à 1965, Renault fait appel aux services de Ghia. Le style italien est alors à son apogée, et le constructeur français pourrait y trouver des idées pour rajeunir son offre. Ghia porte un oeil nouveau sur les modèles existants de la Régie, propose des extensions de gamme avec de nouveaux types de carrosserie, ou réalise des prototypes. Dans le cadre de cette relation, Ghia présente au Salon de Paris 1953 un cabriolet dérivé de la berline Renault Frégate, de facture très classique, qui inspirera d'ailleurs le futur cabriolet Volkswagen Karmann Ghia de 1957. Il s'agit d'une proposition très ambitieuse, susceptible de constituer un beau porte-drapeau pour la Régie. Baptisé Frégate Ondine, un nom qui sera repris par Renault sur une version luxueuse de la Dauphine, ce cabriolet Ghia s’écoule à quatre exemplaires seulement, en raison notamment d'un prix deux fois supérieur à celui de la berline de série.
Renault Frégate Cabriolet Ghia. En 1953, l'Ondine est garée dans un hall de l'usine de Billancourt. La découpe très caractéristique de l'aile arrière est appliquée par le carrossier sur de nombreux prototypes de marques diverses, notamment Chrysler, et bientôt VW Karmann Ghia. Malgré un dessin agréable, ce modèle n'est pas retenu pour la série. Copyright Les carrossiers français Chapron et Letourneur et Marchand proposent à la même époque leur propre interprétation du cabriolet Frégate, avec plus de succès. Chapron délaissera rapidement la Frégate pour se tourner vers la nouvelle Citroën DS 19 dont il imaginera la version cabriolet, un modèle au succès incontestable.
La sellerie passepoilée est particulièrement luxueuse. Ghia propose des bagages spécialement conçus pour la voiture. Si ce n'est la poignée de maintien fixée sur le couvercle de la boîte à gants, le tableau de bord est identique à celui de la berline. Copyright 1953 On devine l'influence de Virgil Exner dans cette suggestion de Ghia destinée à succéder à la berline Frégate. Selon une mode en provenance des Etats-Unis, ce prototype adopte une carrosserie quatre portes avec hardtop, c'est-à-dire sans pilier central, et affiche une imposante calandre qui ne dénoterait pas sur une " grosse américaine ".
Renault Frégate, 1953. Les courants d'idées entre Ghia et Chrysler fonctionnent dans les deux sens. Les autres marques en profitent. Copyright 1953 En 1953, Mario Felice Boano dessine la Fiat Abarth 103 GT sur base Fiat 1100. La silhouette est volontiers futuriste, avec une ligne de caisse bien marquée et un avant directement inspiré du domaine aéronautique. Cette silhouette annonce celle des prochaines Dodge Firearrow, Simca Abarth et Simca Sport du même Ghia. De ces quatre voitures, seule la Dodge débouchera sur une commercialisation à petite échelle, sous la marque Dual Ghia. Simca préférera poursuivre sa collaboration avec Facel Métallon, pour donner naissance aux coupés Simca Sport à moteur Aronde des années 1953 à 1962, des modèles d’une grande élégance, mais bien plus classiques que la proposition de Ghia.
La Fiat Abarth 103 GT d'inspiration aéronautique. Copyright 1954 Après avoir été recruté comme directeur technique de Ghia, Giovanni Savonuzzi décide de réinterpréter le thème de la voiture commandée par Conrero, mais sur un châssis de Fiat 8V. Cette voiture de sport lancée par Fiat en 1952 sera produite à 114 exemplaires en deux ans, avec sa carrosserie usine ou habillée par des carrossiers, en l'occurrence Siata, Vignale, Bertone, Pininfarina, Zagato et Ghia. Elle est dotée d’un V8 de 1 996 cm3 qui lui permet de dépasser les 200 km/h, une performance jusqu'alors inconnue sur une Fiat. Le géant italien peine à vendre cette voiture qui ne correspond pas à son image de constructeur de voiture populaire. Le prototype de Savonuzzi marque les esprits au Salon de Turin 1954, ainsi qu'à celui de Genève début 1955. Ainsi, neuf Fiat 8V " Supersonic " sont commandées.
Les lignes sobres et harmonieuses de cette Fiat 8V Ghia font écho à une présentation aussi luxueuse qu'impeccable . Copyright
Chez Fiat, on est enthousiaste à la vue de la 8V Supersonic. C'est une véritable sculpture en mouvement. Copyright Le style des Supersonic se caractérise par une silhouette étirée, allongée et abaissée, ce qui donne une réelle impression de vitesse, même à l’arrêt. Les formes sont vraiment spectaculaires. Elles anticipent d’une certaine manière celles de la Jaguar Type E lancée neuf ans plus tard. La ligne de caisse est bien marquée. Les feux arrière sont en forme de tuyères, un effet de style qui sera repris sur d'autres prototypes Ghia. Le succès de la Supersonic auprès du public est tel qu'elle va inspirer Virgil Exner. Ainsi, la De Soto Explorer II exposée à Bruxelles, Turin et Paris en 1955, lui doit beaucoup.
Fiat 8V Supersonic. Copyright Parallèlement à la Fiat 8V, le style Supersonic est décliné sur des châssis Jaguar et Aston Martin, sans retouche significative. Trois XK 120 sont ainsi habillées en 1954. Deux de ces trois voitures sont vendues à un certain Malpelli, un riche industriel en bonneterie et lingerie féminine de Lyon. Des différences de détail permettent de les distinguer (peinture bicolore, prise d'air sur le capot, dessin de la calandre ...). Pour éviter les sarcasmes qu'aurait pu attirer l'immatriculation commençant par 69 à l'élégante jeune femme présentant la voiture à l'un des nombreux concours d'élégance de l'époque, le propriétaire a pris le soin de retourner le 9 de la plaque pour le transformer en un 6. Ainsi, 66 BJ 75 et 69 BJ 75 ne sont en fait qu'une seule et même voiture.
Jaguar XK 120 Supersonic. Ghia met en pratique sur cette base britannique son nouveau style " Supersonic " vaguement inspiré des fuselages d’avions à réaction. Ce style aérien démode d’un coup le modèle Jaguar d’origine. Copyright Harry Schell, pilote américain expatrié vivant à Paris, connu pour ses exploits sur Talbot, Maserati et Gordini, est aussi réputé pour sa collection de voitures exceptionnelles. A cette époque, faire appel à un carrossier extérieur est une pratique courante pour une clientèle aisée, mais peu nombreux sont ceux à s'intéresser aux châssis Aston Martin. Harry Schell tente l'expérience. Son choix se porte sur une Aston Martin DB4 Mk II, dotée d'un 2 922 cm3 de 145 ch. Sur cette base plus longue que celle de la Fiat 8V, le dessin de Savonuzzi s'intègre parfaitement. A la différence des autres Supersonic, l'Aston Martin est habillée d'une robe en résine et fibre de verre, une solution alors d'avant-garde. Le pare-chocs avant est réalisé d'une seule pièce qui épouse parfaitement le bas de la calandre. La voiture est exposée au Salon de Turin en avril 1956. Harry Shell est bien présent quand elle est dévoilée, Aston Martin souhaitant bénéficier de la notoriété du jeune pilote. Celui-ci la revend dès 1957. Elle va alors connaître plusieurs propriétaires successifs : un collectionneur, un héritier, un pilote ... Pendant quinze ans, elle restera abandonnée sur le parking d'une station-service désaffectée. En 1974, un amateur éclairé la sauve d'un lent dépérissement.
Aston Martin DB4 Mk II Supersonic. Cette voiture commandée par le pilote automobile franco-américain Harry Schell est habillée d'une carrosserie en fibre de verre. Copyright 1954 La ligne étirée de la Cadillac Série 62 présentée au Salon de Paris 1953 se caractérise par un long capot moteur abritant un V8 Cadillac de 5,4 litres, qui se termine par une calandre verticale " à l’ancienne ", flanquée de quatre phares ronds, en avance de quatre à cinq ans sur la réglementation américaine, par une décoration latérale inédite (qui inspirera les Oldsmobile 1958) et surtout par une immense lunette arrière panoramique en deux parties, celle-ci démarrant pratiquement au niveau des portes, procurant aux passagers une luminosité exceptionnelle. Les feux arrière reprennent le motif en tuyères. Ce modèle, très éloigné des lourdeurs des Cadillac contemporaines, est produit à deux exemplaires.
La Cadillac Série 62 Ghia a des relents du style Supersonic, retravaillé à la manière américaine. L’ensemble est déroutant pour le commun des mortels, en raison d’un aspect baroque revendiqué. Source : https://www.streetmusclemag.com 1954 Le lancement en 1952 de l'étude d'une berline de grande diffusion est un coup de poker pour Alfa Romeo qui y engage toutes ses forces et ses ressources. Il en va de la survie de la firme. Pour financer ce projet, il faut de l'argent frais. Le constructeur lance un emprunt public, sous forme " d'obligations à lots ". Ce qu'il y a à gagner : un exemplaire de la fameuse voiture à l'étude. L'emprunt remporte le succès escompté, mais l'industrialisation de celle qui ne s'appelle pas encore Giulietta prend du retard, notamment sur la partie carrosserie. Les heureux gagnants s'impatientent.
L'Alfa Romeo Giulietta Sprint représente l'archétype de la voiture de sport italienne des années 1950 avec un dessin très réussi et une mécanique envoûtante. Copyright Il vient alors une idée aux dirigeants d'Alfa. Il s'agit de fabriquer une petite série de coupés réalisée sur la base mécanique en cours d'étude, et d'en confier la réalisation à un carrossier. Les premières voitures seront attribuées aux gagnants du tirage au sort, et les autres vendues à quelques amateurs trop heureux de se déplacer dans une auto sortant de l'ordinaire. Deux carrossiers sont consultés pour l'opération, Ghia et Bertone. Nous sommes en septembre 1953. L'objectif est d'exposer le coupé au Salon de Turin qui débute le 21 avril 1954. Mario Felice Boano, le représentant de Ghia, et Nuccio Bertone le dirigeant de l'entreprise éponyme, sont invités chez Alfa Romeo. On leur présente le mulet d'usine, un coupé, et on leur demande de retravailler le sujet, en " faisant mieux ". Après quelques mois de développement, le projet de Ghia ne manque pas d'atout. Mais il paraît bien faible face à celui de Bertone. Franco Scaglione semble avoir mieux compris les qualités du prototype initial. Sa proposition pour la Giulietta est parfaite par sa simplicité, sa pureté, son économie de moyens et son allure juvénile qui lui sied à merveille.
Le coupé Giulietta Sprint sera au final produit à 24 084 exemplaires, plus 3 058 exemplaires en version Veloce . Copyright Bertone a gagné, mais il ne peut pas exploiter sa victoire. Ses moyens industriels sont à cet instant insuffisants. Il négocie un accord avec Ghia. Il s'engage à livrer quatre coques nues par jour à ce dernier, qui se chargera de les équiper. Le châssis de la première voiture, celle qui doit être exposée à Turin, arrive chez Ghia trois semaines avant l'ouverture du Salon. C'est l'époque où Mario Felice Boano quitte Ghia. Boano a la mainmise sur la fabrication. Segre est le commerçant. Il est totalement pris au dépourvu sur le projet Giulietta. Alfa Romeo obtient à l'issue d'une discussion agitée avec Segre que le prototype en cours de réalisation soit rapatrié chez Bertone. Celui-ci termine la voiture à temps pour Turin. Le coupé Giulietta Sprint n'a pas raté son entrée. Cette commande va propulser Bertone au rang des carrossiers industriels. Ghia commence insidieusement à se faire distancer.
Ghia a aussi mené cette étude pour une version plus sportive du coupé Giulietta, sans aucune suite industrielle. Copyright 1954 Dans le prolongement de la Fiat Abarth 103 GT du Salon de Turin 1953, Ghia conçoit un coupé Simca Abarth, quasiment identique, qu'il présente au Salon de Paris 1954.
Le coupé Simca Abarth présenté au Salon de Paris en octobre 1954 reprend une ligne déjà vue sur les Fiat Abarth 103 GT et Dodge Firearrow de 1953. Le volant est à gauche, ce qui permet de la différencier de la Fiat Abarth. Copyright 1954 Présenté au Salon de Paris 1954, le cabriolet Simca Sport réalisé par Ghia reprend les thèmes développé sur le coupé. Sans doute plus original que les versions Facel Métallon, ce modèle ne sera pas retenu pour la série par le patron de Simca, Henri T. Pigozzi.
Simca expose ce prototype de voiture de sport avec un moteur de 2 litres et une carrosserie créée par Ghia. Il ne dépasse pas le stade du modèle unique. Copyright
Le cabriolet Simca Sport est présentée au Salon de Paris 1954 par Miss Auto-Ecole 1954, en compagnie de Martiens publicitaires ! Copyright 1954
Cette automobile répond à la commande d'une société parisienne, la SAPCAR. Elle n'a jamais été exposée lors d'un salon automobile. La presse spécialisée est aussi demeurée discrète à son sujet, et en dehors de la promotion liée au concours d'élégance d'Enghien en 1955, elle est quasiment passée sous silence. Copyright Cette Panhard Dyna est carrossée par Ghia en 1954. Peu d'éléments permettent d'identifier ce modèle unique. On note toutefois le phare central qui rappelle celui de la berline Dyna Z, dévoilée à la presse au cours de l'été 1953, avant d'être exposée au Salon de Paris de la même année. Hormis ce clin d'oeil, ce coupé n'a rien à voir avec la Dyna de série toute en rondeurs. Le dessin de Ghia est bien plus moderne.
Panhard Dyna SAPCAR à Enghien en juin 1955. Sur la longue promenade posée devant le miroir du lac, un bataillon de jolies femmes fait défiler les plus belles voitures du monde. L'acteur Hubert Noël est au volant. Copyright 1954 Ce coupé MG Ghia participe au même concours d'élégance d'Enghien que la Panhard. Il affiche l'immatriculation temporaire 1153 WW0 (1152 WWO de la Dyna). Comme la Panhard, il répond à la commande d'une société parisienne, la SAPCAR.
Jacqueline Pierreux pose sur le capot d'une MG TF Everest au concours d'élégance d'Enghien en 1955. Copyright 1954 Après s’être intéressé à l’Alfa Romeo 6C 2500 SS dont la production s'est arrêtée en 1951, le carrossier Ghia reporte ses travaux sur la nouvelle 1900 à moteur quatre cylindres à deux arbres à cames, lancée en 1950. Diverses carrosseries sont proposées, mais le modèle le plus réussi est certainement ce coupé de 1954 dessiné par Giovanni Savonuzzi, vaguement inspiré des Supersonic.
L'une des attractions du Salon de Paris 1954 est ce coupé Alfa Romeo 1900 Super Sprint de Ghia. Le principe des feux avant " suspendus " dans l'orbite vide sera repris sur la Chrysler Turbine. Copyright Les montants fins offrent une grande luminosité dans l’habitacle. Ce style aérien, qui trahit la formation aéronautique de Savonuzzi, anticipe en partie celui des futures Renault Floride et Caravelle, en particulier pour ce qui est du décrochement latéral arrière. Les phares sont suspendus dans des " tuyères " que l'on reverra sur la Chrysler Turbine en 1963. Le pare-chocs avant qui remonte sous les phares sera utilisé tel quel sur la Karmann Ghia de 1961. Le pare-brise panoramique cède à la mode de l'époque. Il semble qu’une douzaine d’exemplaires de la 1900 Super Sprint aient été produits par Ghia.
Alfa Romeo 1900 Super Sprint. Pour la première fois apparaît le fameux décrochement latéral que l’on verra ensuite sur de nombreux concept-cars Ghia. Il brise la monotonie d’une carrosserie ponton et ajoute du nerf à l'ensemble. Copyright
L'Automobile, février 1955, numéro 106. Copyright 1955 La Ferrari 375 America de 4,5 litres, présentée au Salon de Paris 1953 sous la forme d'un coupé 2 + 2, répond à la demande du marché américain pour les fortes cylindrées. Cette base va donner lieu à une douzaine de créations exclusives. Toutes ne seront pas à destination de l'Amérique. Ghia présente au Salon de Turin 1955 cet élégant coupé deux tons. La vitre latérale unique et l'épaisse calandre chromée alourdissent l'ensemble. La voiture a été commandée par Robert C. Wilke, un riche entrepreneur du Milwaukee. Grand amateur de Ferrari, il en a commandé six en moins de dix ans.
Ferrari 375 MM. Présentée par Ghia en 1954, la Ferrari 375 MM reprend l’idée du décrochement latéral qui sert ici de prétexte au bicolorisme. Copyright 1955 Pour atteindre 200 km/h, Ghia a carrossé en soucoupe volante un moteur Guzzi 350 cm3, le même que celui de la moto Championne du Monde 1955. Extrêmement plate et large à l'avant, cette " automobile " se termine par deux ailerons. Un cockpit en plexiglas recouvre le poste de pilotage situé au centre de la voiture. L'ensemble accuse un poids de 800 kg. Ce racer a été conçu pour s'attaquer à des records.
Guzzi " soucoupe volante ", 1955. Copyright 1955 Karmann produit sa première carrosserie automobile en 1902. Assez vite, l'entreprise acquiert une excellente réputation, et est sollicitée par de nombreux constructeurs. Karmann travaille ainsi jusqu'à la Seconde Guerre mondiale pour Opel, Minerva, Adler, Hanomag, Ford ... Au début du conflit, Karmann emploie 800 salariés et produit jusqu'à 65 carrosseries par jour. En 1945, l'usine subit les bombardements alliés. Dès 1946, Wilhelm Karmann s'intéresse à la Volkswagen, bien conscient du potentiel de développement de cette voiture appelée à une large diffusion. Il obtient des dirigeants de Wolfsburg l'aide nécessaire à la construction de deux prototypes de cabriolet. Pour Volkswagen, ce genre de carrosserie peut constituer un excellent produit d'appel sur les marchés étrangers. La production en série du cabriolet Volkswagen débute en août 1949 chez Karmann. En septembre 1952, Wilhelm Karmann Junior remplace son père à la tête de l'entreprise. Celui-ci vient de mourir à l'âge de 82 ans.
Karmann Ghia 1200. Le modèle définitif est présenté officiellement en juillet 1955. Il reprend globalement la silhouette de la Chrysler d’Elegance avec notamment le dessin si particulier des ailes arrière, et du motif latéral en bas de caisse. L’ensemble harmonieux et élégant affiche des lignes arrondies très féminines. Copyright La rencontre entre Wilhelm Karmann et Luigi Segre a lieu lors d'un salon automobile, des manifestations qu'ils fréquentent tout deux assidûment. Les deux hommes entretiendront dès lors des relations amicales. Cela tombe bien, Mario Felice Boano a quelques idées pour habiller de manière élégante la Volkswagen. Cela fait des années qu'il tente en vain d'obtenir un châssis du constructeur. Après avoir essuyé un refus net, il avait abandonné cette idée. Un autre détail rapproche Karmann et Segre : France Motors, l'importateur parisien de Volkswagen, est aussi le distributeur pour l'Europe des modèles exclusifs créés par Ghia sur base Chrysler. Les deux hommes savent que pour que Volkswagen prenne en considération une proposition, ils doivent présenter un prototype fonctionnel, et pas seulement des dessins. Luigi Segre se fait livrer par France Motors une Coccinelle de série, contournant ainsi les refus essuyés jusqu'alors par Boano. La naissance du prototype est personnellement supervisée par Segre, assisté par Boano fils. Tout le mérite du projet revient à ces deux hommes. La presse ne manque pas de faire remarquer que cette Volkswagen ressemble au prototype Chrysler d'Elegance. Et de fait, on ne peut que constater la transposition de certaines trouvailles stylistiques sur la VW.
Karmann Ghia 1200. Les idées traversent l'Océan Atlantique dans les deux sens. Virgil Exner, auteur de la Chrysler d'Elegance, se serait exclamé alors qu'on lui faisait remarquer la ressemblance de la Volkswagen avec la Chrysler : " Parbleu, non ! Elle ne lui ressemble pas ! C'est carrément la même ". Une belle preuve de son esprit d'ouverture. Copyright Wilhelm Karmann est totalement séduit par le travail de Ghia. Il n'a alors plus qu'une seule idée en tête : convaincre les dirigeants de Volkswagen de la viabilité économique de ce projet. Il le présente au responsable commercial du géant allemand, M. Feuereisen, qui tombe aussi sous le charme. En novembre 1953, la décision est prise par les dirigeants de Volkswagen. Karmann va se charger de la production du coach, et Volkswagen va en assurer la diffusion sous l'étiquette Karmann Ghia.
Karmann Ghia 1200. Les concours d'élégance font de la résistance jusqu'au début des années 1960, avant un grand passage à vide. Le plus célèbre à cette époque est celui organisé autour du lac d'Enghien. Les carrosseries uniques d'avant-guerre ont cédé leur place à des modèles le plus souvent strictement de série. Copyright Le coupé Karmann Ghia est présenté le 14 juillet 1955 à la presse et aux principaux distributeurs Volkswagen en Allemagne. Sa première apparition officielle dans un salon automobile a lieu à Francfort quelques semaines plus tard. Le succès est immédiat, malgré un prix de vente représentant quasiment le double de celui d'une Coccinelle ordinaire. Les soldats américains basés en Allemagne ramènent au pays le coupé VW, et le font connaître à leurs compatriotes qui le commandent en masse. En peu de temps, le marché US devient la première destination pour cette drôle de voiture européenne.
Karmann Ghia 1200. Le coupé Karmann Ghia Type 14 connaît un gros succès aux Etats-Unis, pays dans lequel la Coccinelle elle-même se vend très bien. Copyright Le coupé Karmann Ghia appelle une suite. Fidèle à sa politique commerciale, Ghia soumet à Karmann plusieurs propositions de restyling ou d'évolution. Les premiers dessins sont signé Sergio Sartorelli. D'autres suivent, réalisés par Tom Tjaarda et Filippo Sapino. Sans suites concrètes. La Karmann Ghia est finalement maintenue en production jusqu'en 1974, lorsqu'elle cède sa place à la Volkswagen Scirocco. A l'issue d'une carrière particulièrement longue, elle a été produite à 445 300 exemplaires, dont 364 401 coupés et 80 899 cabriolets. 1955 Exposée au Salon de Paris de 1955, cette Jaguar XK 140 est carrossée par Ghia. Propriété de Monsieur Altweg, elle participe en août 1956 à un concours d'élégance organisé à Cannes. La voiture porte le numéro de châssis 810 827. Ses formes s'inspirent de celles de l'Alfa Romeo 1900 Super Sprint de 1954 du même Ghia, à l'exception des phares non suspendus et du pare-brise qui n'est pas panoramique.
Jaguar XK 140 par Ghia. Un avant goût de Renault Floride ! Copyright 1955 Ghia expose au Salon de Turin 1955 un coupé Lancia Aurelia B55 plutôt sobre. Il suit la mode du pare-brise enveloppant. Les lignes sont épurées, avec des flancs lisses, dans l'esprit de la Facel Vega contemporaine. Deux évents sont positionnés de chaque côté de la calandre. Les phares sont superposés. La teinte deux tons allège le profil. Cette voiture est réapparue en 2009 dans une bourse de collectionneurs à Imola.
Cette Aurelia B55 carrossée par Ghia est une belle preuve de la vitalité créatrice italienne du début des années 1950.. Copyright 1955 Les carrossiers italiens ne se privent pas dans les années 1950 d'emprunter quelques effets de style aux productions américaines. L'inverse est aussi vérifiable. L'union des noms Cisitalia et Mercury peut surprendre, tant l'une respire la finesse italienne et l'autre la grandiloquence américaine. Pourtant cette Cisitalia Mercury, probablement dessinée par Giovanni Savonuzzi, affiche un profil très latin, et à contrario une agressive calandre dentée, que ne renierait pas une Buick.
Cisitalia Mercury. Copyright 1955 Ghia adopte en 1955 des idées directement issues de l'astronautique. La Gilda Streamline X Coupé, présentée au Salon de Turin 1955, arbore ainsi un style futuriste sans aspérités, qui évoque un avion à réaction, voire une soucoupe volante. C'est l'une des voitures les plus marquantes de cette manifestation. Son moteur peut comme sur un avion être doté d’une turbine à gaz, une technique que reprendra le concept car Chrysler Turboflite en 1961, et la petite série de Chrysler Turbine en 1963. Le dessin de l’engin équipé de phares escamotables et de spectaculaires ailerons pointus est signé Giovanni Savonuzzi, qui a voulu créer la voiture la plus aérodynamique possible.
Ghia Streamline X. En 1955, Ghia présente au Salon de Turin le prototype futuriste Gilda Streamline X Coupé, un engin qui semble venir d’une autre planète. Son style " soucoupe volante " va inspirer celui de la Chrysler Dart de 1956. Son nom fait référence au film Gilda de 1946, dont les vedettes sont Rita Hayworth et Glenn Ford. Copyright Savonuzzi a profité de son expérience chez Fiat Avio. Il s'est aussi appuyé sur des tests réalisés à l'aide d'une maquette au 1/5 dans la soufflerie de l'Ecole Polytechnique de Turin. En tant qu'enseignant universitaire, il a eu libre accès à ces installations. Ce type d'équipement est encore rare dans les années 50. Sur la Gilda Streamline X Coupé, la présence d'imposantes ailes arrière offre non seulement un intérêt aérodynamique, mais elle s'inscrit aussi dans un nouveau courant de mode typiquement américain. Ce concept car peut atteindre 225 km/h.
Ghia Gilda Streamline X Coupé. Son aérodynamique est le résultat de tests réalisés dans la soufflerie de l’Ecole Polytechnique de Turin, à laquelle Savonuzzi, en tant que professeur universitaire, peut accéder selon ses besoins. Copyright 1955 Présentée au Salon de Paris en octobre 1955, et reprenant certains effets de style du concept car Gilda Streamline X Coupé, la Ferrari 410 Super America de Ghia est un modèle unique commandé par Robert C. Wilke, déjà propriétaire de la 375 MM de 1954 du même Ghia. Elle présente une silhouette singulière, avec son long capot se terminant par une calandre en forme de gueule de requin, des roues à demi recouvertes, un pare-brise panoramique et d’immenses ailerons. Un élément chromé parcourt horizontalement toute la carrosserie. Giovanni Savonuzzi a dessiné quelque chose de différent et de spectaculaire pour une Ferrari, quitte à faire crier au scandale les puristes.
Savonuzzi s'est inspiré de la ligne générale de la Gilda, tout en concevant un avant plus décoratif, avec la disposition particulière des phares, des pare-chocs, de la grille et des ailes. Toute la voiture est ceinturée d'une moulure anti-chocs en acier chromé. Copyright
La Ferrari 410 Super America présentée par Ghia en 1955 devient la plus extravagante des Ferrari jamais produites, mêlant les tendances stylistiques des voitures américaines à celles des voitures européennes. Copyright 1955 La Lincoln Futura n’est pas à proprement parler un concept car d’origine Ghia, puisque cette automobile a été dessinée chez Ford, mais elle a effectivement été assemblée à Turin. L’engin est comme son nom l'indique on ne peut plus futuriste, avec une verrière double en plastique dérivée des avions de chasse, et des phares enveloppés dans de curieux ailerons avant, contre le vent, qui répondent aux larges ailerons arrière. On se situe plus dans le monde de la bande dessinée et de la science-fiction que dans la vraie vie des automobilistes.
L’année 1955 est marquée par la présentation du concept car Lincoln Futura dessiné aux Etats-Unis, mais assemblé chez Ghia. Quelques détails de la carrosserie seront repris sur la Chrysler Turbine de 1963. Copyright La voiture est présentée non pas sur un salon automobile comme c'est l'usage, mais lors d'une réception à Central Park à New York en avril 1955. L'engin a roulé à travers les rues de la ville, provoquant l'interrogation des autres automobilistes. Il n'a fallu que peu d'imagination pour la transformer en 1966 en Batmobile.
La Lincoln Futura est un vrai laboratoire roulant muni de tous les dispositifs automatiques imaginables. Ce véhicule au style ébouriffant servira de base à la fameuse Batmobile de la série télévisée " Batman " une dizaine d’années plus tard. Copyright 1956 La limousine Mercedes 300 est âgée de cinq ans, et elle apparaît déjà démodée lorsqu'on la compare aux berlines américaines du milieu des années 50, ou à la Mercedes " ponton " lancée en 1953. En effet, comme la limousine BMW 501/502, la 300 " Adenauer " souffre d’une ligne héritée des années 40, avec ses formes rondouillardes, ses ailes apparentes et ses petites vitres. Ghia présente donc en 1956 son interprétation de la limousine de prestige de Stuttgart, qui diffère sur de nombreux points du modèle original.
Mercedes 300. En 1956, Ghia travaille sur la limousine Mercedes 300 en modernisant sa silhouette. Mais ce style américano-britannique demeure peu apprécié par la direction du constructeur allemand, qui prépare lui-même un restyling profond de son modèle de prestige pour 1957. Copyright D’abord, la carrosserie est de type ponton, avec des traits plus rectilignes. La troisième vitre latérale est supprimée, et la lunette arrière, désormais de forme panoramique, est plus vaste. De discrets ailerons apparaissent, et le coffre est carré. Enfin, la peinture deux tons met en évidence une moulure latérale en forme de flèche. Mercedes refusera de produire cette version Ghia, mais le restyling de la 300 en novembre 1957 retiendra l’idée de la lunette panoramique et du coffre de forme carrée. Quant aux ailerons, il faudra attendre 1959 pour qu’ils apparaissent à Stuttgart sur la berline Mercedes W111. La véritable remplaçante de la Mercedes 300 sera lancée en 1963, il s'agit de la 600 dessinée par Paul Bracq. 1956 En travaillant de manière régulière pour Chrysler, Ghia attire l'attention des autres constructeurs américains. En 1956, au Salon de Chicago, le carrossier turinois expose trois prototypes. Le premier est la Chrysler Plainsman, le second la Packard Predictor, le troisième la Ford Mercury XM Turnpique Cruiser. Packard est en bien mauvaise posture à la fin de la décennie. Le constructeur décide de taper fort en construisant une voiture originale, pour bien montrer à d'éventuels investisseurs la confiance qu'il a en son avenir. La Predictor surprend plus qu'elle ne séduit. Elle accumule en effet toutes les bizarreries de style de l'époque, comme une calandre en col de cheval qui fera un flop sur l'Edsel, une lunette arrière inclinée vers l'avant et escamotable, des extrémités supérieures de portières constituées de lamelles rétractables, des ailerons arrière mortellement pointus et des phares doubles cachés derrière des couvercles rabattables. Hélas, l'opération de sauvetage de la marque ne fonctionnera pas.
Le calendrier est aussi serré que les cordons de la bourse de Packard. La Predictor est construite chez Ghia en 90 jours pour être présentée au Salon de Chicago en 1956. Copyright
La Packard Predictor positionnée sur un plateau tournant au sein du studio de design de la marque. Copyright 1956 Le désir de donner libre cours à leur imagination la plus débridée s'empare de tous les constructeurs américains à la fin des années 1950. On voit apparaître sur les routes des créations vraiment excessives. La Mercury Turnpike Cruiser est bien placée dans l'échelle des délires. Ghia a assuré l'assemblage du prototype à Turin. Les idées dévoilées sur cette voiture apparaissent sur d'autres modèles d'autres marques au compte-goutte. Mais au lieu d'égrainer les nouveautés, Mercury les dévoile toutes d'un seul coup. C'est sans doute trop rapide pour le public. La voiture est présentée en 1956 sur le Salon de Ford, l'équivalent du Motorama de la GM à une échelle moindre. Puis elle traverse les Etats-Unis, d'un salon à un autre, sur un semi-remorque vitré.
Des milliers de curieux ont pu se prononcer sur l'esthétique de la Mercury XM-Turnpike Cruiser, aussi révolutionnaire que discutable, lorsqu'à bord d'un semi-remorque spécial, elle a traversé les Etats-Unis d'est en ouest. Copyright 1956 Les premiers contacts entre Renault et Ghia se sont révélés intéressants, à défaut de déboucher sur une quelconque production en série. C'est donc tout naturellement que Ghia est de nouveau sollicité en 1955 pour moderniser le dessin de la Frégate, de manière plus classique. La Régie a toutes les raisons de s'inquiéter. Son haut de gamme fait pâle figure face à la révolutionnaire Citroën DS. Un premier prototype est fabriqué en février 1956. Les arrondis laissent leur place à des formes plus contemporaines, mais l'étude reste sans suite, tant elle génère peu d'enthousiasme.
Sans être foncièrement laid, ce prototype reste très banal de forme. Il ne retient pas l'attention des décideurs de Renault. Copyright 1957 Sans se décourager, Ghia propose en 1957 cette nouvelle interprétation de la Frégate. Elle cède à la mode du pare-brise et de la lunette arrière panoramiques, ainsi qu'à celle des ailerons arrière. Les clignotants sont en bout d'aile, et la calandre englobe les phares. Encore une fois, l'ensemble n'apparaît pas très séduisant.
Cette nouvelle proposition de 1957 puise son inspiration de l'autre côté de l'Atlantique. Des feux arrière en pointe, une lunette arrière amplement panoramique et une importante surface vitrée caractérisent cette voiture. Copyright 1957 La Frégate Limousine est assemblée en un seul exemplaire en 1957 par Ghia, à la demande de Renault, pour les besoins de l'Elysée. Il s'agit pour la Régie de tenter de retrouver une place de prestige dans les cortèges officiels, dominés par Citroën, et de redorer l'image de la Frégate. La voiture gagne près de 60 centimètres en longueur. Le pavillon est rehaussé et les portes arrière sont droites. Deux strapontins peuvent accueillir l'interprète, la secrétaire et/ou l'aide de camp. La présence d'une séparation chauffeur impose une banquette avant très droite et très avancée vers le volant. La carrière de cette Frégate sera particulièrement brève, sans susciter d'autres commandes. Elle disparaît des cortèges à l'arrivée du Général De Gaulle à la présidence de la République, qui lui préfère la Citroën DS. Cette limousine a tout de même eu l'honneur de véhiculer Nikita Khroutchev et le général Eisenhower.
Ce modèle unique intègre le parc des voitures officielles de l'Elysée. Charles De Gaulle est peu sensible à cette proposition de la Régie, qui tentera pourtant encore une fois sa chance quelques années plus tard avec une Rambler réaménagée, sans plus de succès. Copyright 1957 En 1951, la FSO (Fabryka Somochodow Osobomych) Warszawa est la première voiture produite par la firme polonaise FSO. Identique à la GAZ Pobieda, c'est une grosse berline aux formes rondouillardes. A l'origine, FSO n'est qu'une usine de montage, puisque toutes les pièces viennent de chez GAZ à Gorki. A partir de 1956, la Warszawa est produite entièrement en Pologne. FSO confie en 1957 à Ghia la mission de moderniser cette voiture. Les Polonais manquent en effet de compétence. Deux châssis prennent la direction de Turin, avec des informations sur le futur moteur, et une indication claire de ce qui peut librement être modifié : empattement, forme du radiateur, vitrage ... Certains acteurs locaux manifestent leur mécontentement de voir ce travail de conception partir sous d'autres cieux. Les deux prototypes Ghia sont livrés en Pologne en 1959. Il s'agit d'une berline et d'un break, proches dans l'aspect des Fiat 1800, Peugeot 404 et Morris Oxford contemporaines.
Ces deux prototypes Warszawa de 1959 répondent à une commande de FSO, mais malgré le réalisme de ces propositions, aucune suite industrielle n'est donnée. Le style évoque celui des réalisations contemporaines de Pinin Farina pour Fiat, Peugeot ou Morris. Copyright Aucune suite n'est donnée à ces prototypes. Pourtant, FSO ne désarme pas, et Ghia poursuit ses travaux. C'est ainsi que les Italiens formulent une nouvelle proposition en 1963. Le prototype porte le code 210. Les lignes sont certes toujours conventionnelles, mais remises aux goûts du jour. Après quelques essais menés de 1964 à 1966, ce projet 210 est abandonné au profit de la Fiat 125P, qui est construite localement à partir de 1967.
Le prototype Warsawa 210 étudiée au début des années 1960 chez Ghia restera de nouveau sans suite, Fiat ayant réussi à imposer sa 125. Copyright 1957 Cette proposition de Sergio Sartorelli pour un break Fiat 1100 est présentée au Salon de Turin 1957. A mi-chemin entre les notions de berline et de break, ce véhicule préfigure la petite Austin A40 dessinée par les équipes de Pinin Farina, disponible à partir de septembre 1958.
Sergio Sartorelli a imaginé pour Ghia ce break Fiat 1100 quatre places présenté au Salon de Turin 1957, dans le même esprit que l'Austin A40 de Pininfarina, et qui reprend certaines idées vues sur le concept Plymouth Plainsman de 1956. Copyright 1957 La face avant de ce coupé Fiat 1100 TV se caractérise par ses deux gros feux globuleux encerclant une calandre en retrait. Cette voiture est dotée d’une lunette arrière inversée, anticipant le style des Ford Anglia (1959), Ford Consul 315 (1961) et Citroën Ami 6 (1961). Certaines voitures américaines reprendront cette idée, comme les Lincoln et Mercury. Un cabriolet est présenté dans la foulée, mais cette version, qui perd évidemment sa lunette, apparaît plus banale.
Le pavillon tronqué de cette Fiat 1100 TV permet d'augmenter l'espace intérieur et la visibilité. Cette carrosserie offre un excellent coefficient de pénétration dans l'air. Copyright
Salon de Turin 1957. Au premier plan le coupé et le cabriolet 1100 TV de Ghia, au second plan le break Fiat 1100 du même Ghia. Copyright 1957 Au Salon de Turin 1957, Ghia expose le prototype d'une voiture de plage sur la base de la nouvelle Fiat 500, baptisé Jolly. Il semble que cela soit Luigi Segre en personne qui ait eu l'idée de ce concept, en observant les grosses voitures utilisées pour faire les navettes sur les îles de Capri et d'Ischia, en Italie. Cette première Jolly va ouvrir la voie à d'autres réalisations du même type, sur base Fiat 500 et 600. Plusieurs d'entre elles seront exportées vers les Etats-Unis, et utilisées comme ... voitures de golf.
Fiat 500 Jolly. Les sièges sont en rotin et la barre chromée qui borde la carrosserie sert à la fois de décoration et de renforcement. Copyright On a vu les Fiat Ghia Jolly aux mains de vedettes d'Hollywood comme Yul Brynner, et de diverses célébrités, dont le PDG de Fiat, Giovanni Agnelli, ou le Président Lyndon Baines Johnson. Ces voitures de plage anticipent la mode des voitures de loisirs, comme la Mini Moke (1964) ou la Citroën Méhari (1968).
Les voitures de plage sont devenues un thème à la mode chez les carrossiers italiens. Ghia propose sur une base de Fiat 500 cet amusant véhicule baptisé Jolly. Copyright 1958 Avec l'arrivée de Pierre Dreyfus à la présidence de Renault en 1955, la Régie entend développer sa présence aux Etats-Unis. La 4 CV, puis surtout la Dauphine commercialisée en mars 1956, vont y connaître un joli succès. Les " dealers " américains de la Régie aimeraient toutefois proposer à leur clientèle une automobile d'allure plus jeune et plus sportive. Celle-ci pourrait aussi séduire une clientèle féminine. L'après-guerre a été difficile pour Renault qui semble désormais bien sorti d'affaire, avec une offre étendue à trois modèles majeurs de tourisme, la 4 CV, la Dauphine et la Frégate. Proposer un modèle moins austère, cela serait pour la Régie l'occasion de renouer avec ses coupés et cabriolets des années 1930. Il se trouve que cette demande ne surprend pas Fernand Picard, directeur des études, qui a déjà anticipé l'action en sollicitant Luigi Segre chez Ghia. Il lui a commandé quelques études prospectives sur base Dauphine.
Bien avant de travailler pour Ghia, et alors qu'il était à son compte, Pietro Frua a conçu en 1956 ce projet de Dauphine Sport, qui préfigurait déjà par certains détails la Renault Floride de 1958. Copyright Luigi Segre, en contrat avec Volkswagen pour le coupé Karmann Ghia, semble avoir oublié un détail non négligeable. En vertu d'une clause d'exclusivité, il lui est interdit de proposer un service identique à un constructeur concurrent. Mais un accord avec la Régie Renault ne peut décemment pas se refuser. Discrètement, Segre confie au styliste Pietro Frua, dont le talent est unanimement reconnu dans la profession, le développement de cette automobile au sein de la filiale suisse Ghia Aigle. Frua s'exécute, et fait livrer dans le plus grand secret deux prototypes à la Régie. C'est à ce moment-là que va naître " l'affaire ". Renault, satisfait du travail, règle sans sourciller la facture établie par Ghia. Mais celui-ci tarde à verser à son prestataire Pietro Frua le montant qui lui est dû. Agacé par la nonchalance de son donneur d'ordre, Frua décide d'exposer son projet au Salon de Genève 1958. C'est ainsi que les visiteurs découvrent sur le stand Ghia Aigle un cabriolet dénommé Dauphine GT, un patronyme qui laisse bien deviner l'origine Renault du prototype.
Le prototype Dauphine exposé en mars 1958 par Frua au Salon de Genève est quasiment identique à la Renault Floride qui sortira quelques mois plus tard. La Régie ne va toutefois par retenir les répétiteurs de clignotants sur les flancs, ni les entourages chromés des phares, ni les épais butoirs de pare-chocs. Copyright On peut s'en douter, cette voiture aurait dû rester secrète. Il s'agit effectivement du prototype de la Renault Floride qui doit être présentée officiellement dans les prochains mois. On comprend l'agacement de Pierre Dreyfus et de Fernand Picard lorsqu'ils découvrent, en même temps que le public, leur prochaine voiture sur le stand d'un carrossier indépendant. Les discussions à Genève sont animées entre Pierre Dreyfus, Luigi Segre et Pietro Frua. Elles seront suivies par un imbroglio juridique entre les trois parties. Il s'agit désormais pour la Régie Renault, mise devant le fait accompli, de s'activer. En octobre, elle présente officiellement la Floride au Salon de Paris, sous la forme d'un cabriolet transformable en coupé par l'adjonction d'un hard-top élégamment dessiné.
Le succès des Volkswagen Karmann Ghia aux Etats-Unis à partir de 1955 a incité Renault à concevoir un coupé et un cabriolet sur la base de la berline Dauphine lancée en 1956. La Renault Floride, initiée chez Ghia Aigle par Pietro Frua, est officiellement présentée au Grand Palais en 1958, dans un environnement soigné qui la valorise. Copyright Ghia Aigle En 1948, Pierre-Paul Filippi, un riche industriel avec qui Boano entretient des relations, propose à Ghia d'ouvrir une filiale en Suisse, à Aigle, où il possède des terrains. Filippi fournira les capitaux, tandis que Boano devra prendre en charge la direction technique de l'affaire. La partie administrative sera assurée par un homme de confiance de Filippi. La société ainsi créée est détenue à 50/50 par Filippi et Boano. Outre les services de Boano jusqu'en 1951, Ghia Aigle fait ensuite appel à deux designers de renom, d'une part Giovanni Michelotti (de 1951 à 1957), d'autre part Pietro Frua (de 1957 à 1960). La difficulté majeure pour Boano est de trouver une main d'oeuvre qualifiée. Autant ce n'est pas un sujet majeur en Italie, autant c'est un problème en Suisse. Des Italiens viennent donc travailler à Aigle. A la fin, les carrosseries sont directement produites en Italie, expédiées en Suisse, où s'opère le montage. Ce flux est trop complexe pour être rentable. Boano se lasse de la situation, et jette l'éponge en 1953. Ghia Aigle prend son indépendance vis à vis de Ghia Turin. A partir de 1960, l’entreprise se concentre sur la rénovation de voitures anciennes. Elle survivra sous cette forme jusqu’en 1988. 1958 Une affaire tout aussi complexe porte sur l'engagement de Ghia et de Pietro Frua dans la conception du coupé Volvo P1800. Les tenants et aboutissants concernant l'établissement des plans et des prototypes sont assez flous, certaines informations étant parfois contradictoires selon les sources consultées. Nous allons retenir la version de Björn-Eric Lindh, auteur de différents ouvrages sur les marques Volvo et Saab.
Volvo P1800. Photographie de janvier 1958, prise par Gunnar Engellau, du premier prototype réalisé par Frua. L'histoire de la gestation de ce prototype diffère selon les historiens consultés, les protagonistes de l'époque interviewés ayant quelques difficultés à accorder leur point de vue. Copyright C'est en 1957 que débute l'étude de ce nouveau coupé Volvo, qui doit faire oublier l’échec cuisant de la P1900 vendue à 68 exemplaires seulement en 1956 et 1957. La direction de Volvo souhaite que la nouvelle venue adopte un style latin susceptible de séduire la clientèle féminine. Volvo demande à Ghia de soumettre ses propositions. L'entreprise animée par Luigi Segre décline la demande, car il a en développement un projet similaire pour un concurrent. Volvo se serait alors adressé à Pietro Frua, encore indépendant. Parallèlement, Helmer Petterson est consultant pour Volvo. Son fils Pelle travaille en tant qu'apprenti chez Ghia. Petterson senior pense qu'il pourrait s'agir là d'une opportunité pour que son fils puisse se faire la main sur un nouveau projet. Helmer et Pelle Petterson sont dans le cadre de leurs activités professionnelles en liaison avec à la fois les équipes de Ghia et avec Pietro Frua. Pelle Peterson aurait alors soumis un certain nombre de croquis à Luigi Segre ... avant que celui-ci ne renonce au projet.
Pour le constructeur de Göteborg, Ghia a créé un coupé classique, la P1800, qui devra une partie de sa notoriété à sa présence dans la série britannique Le Saint. Copyright Entre Frua et Helmer Petterson, un choix s'impose. Gunnar Engellau, le PDG de Volvo depuis 1956, choisit le projet d'Helmer Petterson. Engellau va se montrer particulièrement agacé en apprenant qu'il s'agit en fait du travail de Pelle Petterson, présent à ce moment-là chez Ghia. Le projet poursuit néanmoins son cheminement. Frua est chargé de produire les prototypes en collaboration avec Pelle Petterson. Le premier d'entre eux est achevé fin 1957. Début 1958, Gunnar Engellau fait le déplacement en Italie pour découvrir la voiture. Il est satisfait. La photo officielle de la future Volvo P1800 est dévoilée en mai 1959. Elle entre en production en septembre 1960 chez Jensen en Grande-Bretagne. 1958 A la fin des années 50, le bureau d'études Renault, animé par Yves Georges, sous la direction technique de Fernand Picard, développe une série de prototypes dont le poste de conduite est avancé et le moteur placé à l'arrière, afin d'optimiser l'accessibilité, l'habitabilité et la visibilité. La réalisation des prototypes est partiellement sous-traitée auprès de Ghia, ou Sergio Coggiola assure la liaison avec la Régie. En réalité, les voitures sont généralement confiées à un carrossier local auquel Ghia sous-traite lui-même l'assemblage ...
Renault Prototype 600, 1958. Le problème de la circulation dans les villes devient préoccupant, d'où l’idée d’une voiture à l’architecture inversée pour optimiser la taille de l'habitacle. Copyright Un premier prototype réalisé en mai 1958, la 600, est étudié par Renault avant d'être assemblé en Italie. L'idée de construire un taxi d'un type nouveau n'est pas étrangère à son existence. Quelques aménagements spécifiques sont adaptés à cet usage. Ainsi, la direction est placée en position centrale, tandis qu'à l'arrière, deux banquettes sont installées en vis à vis.
Le prototype 600 sera longtemps gardé secret, et présenté pour la première fois au côté d'un prototype de la 900 dans le cadre d'une exposition fin 1972, début 1973, au Pub Renault des Champs-élysées sous le titre " Ces Renault que vous n'avez jamais vues...". La Régie a présenté à cette occasion dix prototypes refusés et abandonnés, tous repeints en blanc pour la circonstance. Copyright La même année 1958, chez Renault, on commence à réfléchir à la voiture qui pourrait succéder à la Frégate, un modèle mal aimé et en fin de carrière. Fernand Picard n'est pas fermé à une formule originale. Il a l'idée de reprendre l'architecture imaginée pour la 600. Le moteur choisi est un V8 réalisé par l'assemblage de deux 4 cylindres de Dauphine. La cylindrée totale est de 1,7 litre et la puissance de 80 ch. Amédée Gordini participe à sa mise au point, différentes implantations sont étudiées. Ce programme se heurte à la réticence du public, comme le révèlent des sondages confidentiels. Le principal frein est la position du conducteur et de son passager en porte-à-faux avant, qui procure un sentiment d'insécurité. L'esthétique rebute aussi. Même chez Renault, les sceptiques sont nombreux. La 900 est trop en avance sur son époque.
Renault 900. Le premier prototype réalisé par Ghia adopte un V8 de 1,7 litre et 80 ch en porte-à-faux arrière, obtenu par accouplement de deux moteurs de Dauphine. Copyright
Sur ce second prototype de la Renault 900, les ouïes d'aération du V8 sont bien visibles sur les flancs (Photo Bernard Asset). 1958 Parallèlement à la conception de la 900, on réfléchit chez Renault à une autre forme d'automobile plus conventionnelle, toujours pour remplacer la Frégate. Le travail porte surtout sur une recherche de style adaptée à la propulsion. Ghia est de nouveau sollicité. La proposition des Italiens retient l'attention de la direction de Renault. On peut y déceler quelques traits de style de la Plymouth Valiant. Cette parenté n'est pas surprenante quand on sait les liens qui unissent à cette époque Ghia et Chrysler. L'étude reste sans suite, à l'exception du motif central de calandre et de l'idée de la carrosserie à deux volumes, qui seront repris sur la Renault 16 de 1965.
Le dessin de cette berline Renault a été réalisé chez Ghia, qui a aussi assuré la fabrication de la maquette. On explore à la Régie différents solutions pour remplacer la Frégate. Copyright Une dernière fois Ghia est sollicité. L'ambition du projet 114 est toujours de remplacer la Frégate. Mais cette fois, les équipes sont plus motivées que jamais. De nombreuses maquettes et prototypes sont réalisés. Philippe Charbonneaux est appelé à la rescousse. Chez Renault, c'est Michel Beligond qui est à la manœuvre. La 114 qui est motorisée par un six cylindres de 2,2 litres est une propulsion, qui ne reprend aucun élément de la Frégate. Le prototype est assemblé par Ghia. Pierre Dreyfus, quand il découvre le prix de revient réel au cas où la voiture entrerait en production, préfère renoncer. Celui-ci dépasse de près de 25 % les premières estimations. Le moteur, amputé de deux cylindres, est conservé pour le projet 115, qui va donner naissance à la Renault 16, avec le succès que l'on sait.
Un ultime prototype pour remplacer la Frégate est imaginé en 1959. Aurait-il pu relancer la carrière de la grande berline Renault en la dotant d'une carrosserie signée Ghia ? Copyright 1959 Renault renonce au principe du poste de conduite avancé, mais pas Ghia, qui présente la Selene au Salon de Turin 1959. Son nom est celui de la déesse grecque de la lune. L'architecture de la Selene dessinée par Tom Tjaarda permet de repenser complètement l'ambiance intérieure, et de développer d'intéressants rapports entre habitabilité et encombrement. Le jeune designer réalise ce travail à partir des travaux préliminaires de Sergio Sartorelli. Les nombreuses innovations sont couvertes par des brevets internationaux.
Présentée par Ghia en 1959, la Selene reprend un thème déjà exploité sur le prototype Renault 900 contemporain, conçu en collaboration avec le carrossier turinois. Copyright
La Ghia Selene possède une allure particulière avec un capot avant court et un immense porte-à-faux avant, et une partie arrière très longue qui abrite le moteur. Différencier l'avant de l'arrière n'est pas de prime abord une évidence. Copyright La renommée de la Selene est planétaire. Segre reçoit un jour un courrier de l'Université de Moscou indiquant qu'elle mène des études pour la conception d'un taxi, et que la Selene est exactement le type de véhicule que ses universitaires étudient. La Selene est prêtée aux Russes une fois sa carrière européenne achevée. Quelques années plus tard, Tom Tjaarda reçoit un courrier de Moscou et quelques photos d'un taxi moscovite dont la source d'inspiration est effectivement évidente. Par contre la réalisation est désastreuse. 1959 La thèse de fin d'étude d'Exner Junior porte sur une voiture de sport sur base Simca Aronde, dénommée Talbot Star Six. Le choix de Simca s'explique par la récente prise de participation de Chrysler dans le capital du constructeur de Poissy. On retrouve sur cette voiture à la carrosserie en fibre de verre certaines idées exploitées par Virgil Exner senior, comme les pots d'échappement extérieurs et les imposants ailerons pointus. Ce concept car est exposé au Salon de Paris 1959.
La Simca Special dessinée par Virgil Exner Junior arbore un style futuriste que ne renierait pas son père Virgil. Copyright
Remarqué aux Etats-Unis par un responsable de Simca, le projet de fin d'études de Virgil Exner Junior est récupéré pour le Salon de Paris 1959, où il est présenté en compagnie des dernières Talbot, marque totalement moribonde. Copyright 1960 La Renault 4 est présentée à la presse au mois de juillet 1961. Le public peut en prendre le volant à partir du 4 octobre, en se rendant au Salon de Paris. Ghia a étudié à la même époque une version plus luxueuse de la petite berline de la Régie. L'immatriculation 1185 LT 75 a été attribuée en novembre 1961.
Ghia est sollicité avant même la commercialisation de la Renault 4 afin d'en décliner une version plus huppée. Copyright Le coupé Fiat 2100 S est exposé sur le stand Ghia du Salon de Turin 1960, avec le moteur de la berline Fiat 2100, un modèle lancé en 1959. La silhouette élancée dessinée par Sergio Sartorelli et Virgil Exner Junior se caractérise par le dessin particulier des vitres latérales et de la lunette arrière. On le retrouvera sur la Dual Ghia L6.4 de 1961. Le coupé Fiat 2100 S n'est pas commercialisé en l'état. Pour la série, Fiat l'équipe du 2,3 litres de la récente berline Fiat 2300. Curieusement, il n'adopte pas des doubles phares comme sur la berline, alors que ceux-ci permettent de différencier les berlines Fiat 2300 des berlines Fiat 2100.
Présenté en novembre 1960 au Salon de Turin, le coupé Fiat 2100 S entre en production un an plus tard, sous l’appellation 2300 S, avec le moteur de la berline Fiat 2300. Copyright La production de la 2300 S est assurée non pas chez Fiat ou Ghia, mais chez OSI (Officina Stampaggi Industriali), une entreprise fondée en 1960 par Luigi Segre et Arrigo Olivetti, héritier de la fabrique de machines à écrire du même nom, et patron de Fergat, sous-traitant pour l’industrie automobile. L'installation industrielle d'OSI permet de fabriquer à plus grande échelle un modèle qui n'aurait jamais eu sa place dans les ateliers de Ghia. Le succès commercial est mitigé. Fiat souffre en effet d'une image de constructeur de voitures populaires. La clientèle qui en a les moyens pense plus naturellement à Lancia ou Alfa Romeo. Par ailleurs, certains concessionnaires Fiat peu habitués à vendre du haut de gamme sont désorientés.
Le style original de la Fiat 2100 S est en partie dû à Virgil Exner Junior. Il sera partiellement repris sur la Dual Ghia L6.4 de 1961. Copyright 1960 Une seconde Selene est développée pour de Salon de Turin 1960, dite Selene Seconda. Tom Tjaarda n'est pas impliqué cette fois. Il s'agit d'une création de Virgil Exner Junior. Ce véhicule long de 4,88 mètres, haut de 1,88 mètre, à la silhouette toujours aussi atypique, reprend les thèmes de la première génération, mais avec un nouveau regard, plus moderne. L'intérieur est traité différemment. La référence aéronautique est omniprésente, et le vocabulaire stylistique n'échappe pas au répertoire des vaisseaux spatiaux.
Dévoilée en 1960, la Ghia Selene Seconda présente une esthétique plus agréable que la première génération de 1959, mais son style trop radical la cantonne obligatoirement dans le rôle de voiture d'ingénieur. Sa carrosserie est laquée en blanc nacré. Copyright La Selene Seconda n’est en réalité qu’une maquette non motorisée. Son constructeur se contente de suggérer qu'elle pourrait recevoir des moteurs ayant une cylindrée oscillant entre 1 litre et 2,5 litres. Le pilote est assis dans la proue en porte-à-faux, en avant de l'essieu, et les passagers lui tournent le dos en regardant fuir la route. Ce prototype est accompagné du slogan " Déjà prête pour les années 1970 ". Pinin Farina expose sur ce même salon son concept car XPF 1000, concurrente dans l'esprit de la Selene Seconda. 1960 Tom Tjaarda est l'auteur du dessin de l'IXG Dragster présentée au Salon de Turin 1960, une voiture équipée d'un 948 cm3 d'Austin Healey Sprite. IXG signifie International eXperimental Ghia. Une autre source indique qu'il s'agit de Innocenti & Ghia. Quoi qu'il en soit, c'est Luigi Segre, séduit par les courses de dragsters qu'il a découvert aux Etats-Unis, qui est à l'origine de cette automobile. Le profil a été dessiné pour obtenir un maître couple aussi faible que possible, sans vraiment se soucier d'habitabilité ou de tenue de route. Tjaarda s'est un peu laissé emporter par le dessin aux contours magnifiques, à tel point que lorsque la voiture a été terminée, y glisser le moteur a nécessité quelques contorsions.
Autre genre de radicalité, le concept-car Ghia XG Dragster dévoilé en 1960, qui est censé être une voiture de record et qui se conduit couchée ! Copyright Le pilote prend place en position allongée sous une bulle en arrière de l'essieu arrière, ce qui a permis de contenir la hauteur à moins d'un mètre. L'IXG a été conçue pour s'attaquer à des records mondiaux de vitesse pour les voitures de moins d'un litre de cylindrée. Son autre ambition est de faire parler d'Innocenti qui s'apprête à commercialiser la 950 Spider. 1961 Curieusement, chez Ghia, on a attendu 1961 pour s'intéresser à la 4 CV, qui vit cette année-là ses dernières heures avant son remplacement par la Renault 4. Une cinquantaine d'exemplaires sont ainsi transformés à destination du marché ... américain. Par son caractère ludique affirmé, la 4 CV Jolly préfigure la Renault 4 Plein Air lancée en 1968. Il ne sera alors plus question d'une automobile produite sur mesure, mais d'une petite série.
Avec la Jolly, Ghia ne s'est pas limité à la production italienne, mais il a aussi oeuvré en 1961 sur la base de la Renault 4CV. Copyright L'Innocenti 950 Spider est la première étude de style sur laquelle Tom Tjaarda travaille lors de son arrivée chez Ghia. Son projet est proposé à Ferdinando Innocenti au printemps 1959. Séduit, l'industriel donne immédiatement son feu vert pour poursuivre cette étude. La version définitive est présentée au Salon de Turin en novembre 1960. La simplicité des lignes, le capot très plat et la calandre présentent des formes déjà connues, et leur habile combinaison donne naissance à une jolie voiture de sport économique. Elle emprunte son package technique à l'Austin Healey Sprite, la fameuse frogeye.
Présenté en 1961, le cabriolet Innocenti 950 ressemble aux cabriolets Fiat de cette époque, dans un format réduit. Tom Tjaarda pour Ghia n’a pas fait preuve d’une grande originalité, mais l'ensemble demeure élégant. Copyright 1961 Si elle s'intéresse aux prototypes de roadsters sportifs, de voitures de record, de voitures de plage, de voitures à usage urbain, la carrosserie Ghia n'en oublie pas moins les questions du quotidien. Ainsi, elle expose au Salon de Turin 1961, sous le nom de Ziba, un petit pick-up sur le châssis de la Fiat 500 Giardiniera. Ce type de véhicule pourrait trouver sa clientèle dans les petites exploitations agricole, voire outremer.
La Fiat 500 Ziba de Ghia basée sur la Fiat 500 Giardiniera est initiée par Sergio Sartorelli. Ce petit utilitaire est équipé d'un 499,5 cm3 de 17,5 ch. Copyright 1961 Au Salon de Francfort 1961, Volkswagen lance la 1500 Type 3, disponible en version coach et break Variant. Alors que la Type 3 n'est encore qu'en phase de développement, Ghia propose à Karmann, selon le même principe qu'avec la 1200 type 14, d'en dériver un coupé. Celui-ci est dessiné sous l'autorité de Sergio Sartorelli, assisté de Tom Tjaarda. Les deux designers se sont partagé le travail, au premier la face avant, au second la partie arrière. Wilhelm Karmann est intéressé par la proposition de Ghia. La voiture définitive est exposée sur le même Salon de Francfort 1961, et produite à partir de mars 1962. Elle est intégrée à la gamme VW, parallèlement au coupé 1200 dont la production se poursuit.
Comme ils l'on déjà fait pour la Coccinelle, Ghia et Karmann se sont associés pour créer et produire un coupé établi sur la plateforme de la Volkswagen 1500. Copyright Cette voiture fera l'objet de nombreuses propositions de restyling, attribuées à Sergio Sartorelli et à Filippo Sapino. Mais aucune ne dépassera le stade du projet. La Type 34 est à la fois plus chère et généralement jugée moins élégante que la Type 14. Et effectivement, elle ne connaît pas le même succès. Seulement 42 505 exemplaires sont assemblés chez Karmann entre 1962 et 1969.
La Karmann Ghia 1500 Type 34, plus haut de gamme que la Type 14, présente une robe plus moderne, avec des angles plus marqués. Il s'en vendra près de dix fois moins que la Type 14. Copyright 1961 Conscient que son avenir réside dans la production de plus grandes séries, Maserati décide de ne proposer la 5000 GT qu'à des clients exclusifs, chaque exemplaire étant construit de manière unique. 34 Maserati 5000 GT sont ainsi assemblées entre 1959 et 1965. Au total, huit carrossiers se sont intéressés à ce très haut de gamme. Ghia n'a habillé que le seul coupé présenté ici, commandé en 1961 par l'industriel italien Ferdinando Innocenti. Au moment où Innocenti passe sa commande, Maserati a déjà construit huit voitures (habillées par six carrossiers différents !) et a également affiné les spécifications mécaniques de la 5000 GT.
Présentée en 1961, la Maserati 5000 GT réalisée par Ghia est destinée à Ferdinando Innocenti. Sur les 34 Maserati 5000 GT produites, une seule a été carrossée par Ghia. Copyright Innocenti a fondé son entreprise avant-guerre, et a fait fortune dans la fabrication et la vente de supports d'échafaudage. Après la guerre, comme beaucoup d'autres, il comprend la nécessité de motoriser la population italienne, et fabrique des scooters sous la marque Lambretta. Puis la diversification passe par la production en Italie de voitures BMC sous licence. Au départ, celles-ci ne sont que des répliques de modèles britanniques. Mais Innocenti construit bientôt ses propres modèles sur base technique BMC, comme la 950 Spider conçue par Ghia. Il n'est donc pas surprenant qu'Innocenti ait également chargé Ghia de concevoir parallèlement sa 5000 GT personnelle. Sergio Sartorelli, responsable de la conception des prototypes chez Ghia, s'est lui-même chargé du projet.
La voiture a été entièrement dessinée par Sergio Sartorelli. L'habitacle regroupe un mélange habile d'éléments traditionnels et d'innovations souvent inspirées des créations des stylistes de Chrysler. Copyright 1961 Ghia conserve, malgré les aléas constatés lors du lancement de la Floride, toute la confiance de la Régie. Au début des années 1960, le carrossier est sollicité justement pour rajeunir cette Floride. Il ressort de cette nouvelle consultation un coupé et un cabriolet appelés Texas, dont les lignes bien plus anguleuses semblent ne pas reprendre le moindre embouti de la Floride, même si l'esprit de famille est conservé. Cette évolution aurait de nouveau nécessité de lourds investissements, peu en phase avec le volume des ventes somme toute mesuré de la voiture. Renault préfère procéder à un sérieux lifting, qui permet de maintenir au programme jusqu'en 1968 celle qui est désormais devenue la Caravelle.
Renault Floride 1958, Renault Texas Coupé 1961, Renault Caravelle 1962. La Renault Texas présentée en février 1961 constitue une tentative de rajeunissement des lignes de la Floride. Elle garde un pavillon très incliné, au contraire de la Caravelle qui propose de pair une habitabilité nettement améliorée. Copyright
Renault Texas Cabriolet 1961. Les flancs sont épurés, tandis que la face avant est inutilement compliquée. Les ailerons sont moins marqués que sur la Floride, et supportent des feux en forme de Boomerang. Copyright 1962 Sergio Sartorelli et Filippo Sapino présentent au Salon de Turin 1962 la Fiat Club 2300 S, une version " break de chasse " de la Fiat 2300 S. Détail original : la porte arrière peut être maintenue levée à l'horizontale, ce qui permet d'augmenter la surface de charge de la galerie de toit. Aucune suite commerciale n'est donnée à ce projet, ce qui n'empêchera pas le carrossier italien de tenter de nouveau sa chance auprès d'un autre grand constructeur. Ainsi, au Salon de Turin 1964, le même thème stylistique sera exploité sur une base de Ford Falcon.
Au Salon de Turin 1962, Ghia présente un élégant break de chasse réalisé sur la base du coupé Fiat 2300 S. A regret, Fiat ne retient pas ce projet, alors que ce type de carrosserie va se développer en Europe dans les années 1960, notamment chez Volvo et Reliant, avant d'intéresser Lancia. Copyright 1962 Sur ce même Salon, on découvre un cabriolet Fiat 2300 S à quatre places dont la ligne fluide s'adapte parfaitement au dessin de la capote.
Outre le coupé et le break Club, Ghia propose ce cabriolet Fiat 2300 S aux lignes simples et peut-être trop paisibles pour séduire. Copyright 1962 Ghia expose sous sa propre marque le coupé 1500 GT au Salon de Turin 1962. Comme chez la plupart des carrossiers transalpins à cette époque, la 1500 GT est basée sur une mécanique Fiat, en l'occurrence celle de la berline 1500. De cette façon, l'entretien et le service peuvent être réalisés à moindres frais dans le réseau du géant italien, et ceci à travers le monde entier. Une étude très poussée en soufflerie à l'Ecole Polytechnique de Turin a permis d'obtenir des performances satisfaisantes en partant d'une mécanique simple. Le dessin du châssis est particulièrement original. En effet, le moteur est reculé au maximum, ce qui a permis au styliste de proposer une ligne très fuyante. Ghia a collaboré sur ce projet avec GIL.CO, un atelier spécialisé dans la conception de châssis tubulaires, animé par l'ingénieur GILberto COlombo.
Dévoilé en 1962, le coupé Fiat 1500 GT de Ghia reprend à petite échelle la silhouette de la toute récente Jaguar Type E (1961). 846 exemplaires trouveront preneur entre 1963 et 1967. Les 75 ch du 1 481 cm3 propulsent l'auto jusqu'à 150 km/h. Copyright Après un long capot moteur, on découvre un pare-brise vertical et un habitacle haut. Les pare-chocs sont intégrés à la calandre. Ils ont la forme d'une bouche rectangulaire dotée de lèvres chromées, à la manière de la Plymouth XNR de Virgil Exner, dont Sartorelli s'est inspiré. La poupe s'étire en une pente douce, brutalement interrompue par un pan coupé. Deux évents aérodynamiques habillent les ailes avant. Cette auto marginale va peiner à s'imposer, face à des concurrentes installées de longue date, à l'image de marque mieux établie. Sa production est suspendue en 1967 après le rachat de Ghia par De Tomaso. 1963 Quand Ghia comprend que le projet de la Fiat 2300 Club est sans issue, le carrossier décide de proposer le même concept sur un châssis de Ford Falcon. Le prototype est présenté au Salon de Turin 1964. Les lignes de cette voiture qui allient loisirs et sport manquent de fantaisie, et chez Ford, on a choisi de l'ignorer.
Ford Falcon Clan. Une nouvelle tentative pas très heureuse de fusion entre un break et un coupé. Copyright 1963 Vu l'intérêt suscité par la 1500 GT, chez Ghia, on a songé à équiper la Fiat 2300 S du châssis GIL.CO. Ce modèle pourrait ainsi poursuivre sa carrière avec des dessous plus performants, mais aussi une nouvelle robe. C'est ainsi qu'apparaît la G.230/S au Salon de Turin 1963. On dirait une grosse Ghia 1500 GT ! La mécanique Fiat 2300 est positionnée sur un châssis tubulaire. Le modèle ne s’appelle pas 2300 pour éviter toute confusion avec le coupé Fiat. Mais Fiat n'exprime aucun intérêt pour ce prototype.
La Ghia G.230/S apparaît au Salon de Turin 1963. En arrière-plan, on reconnaît une Chrysler Turbine, programme auquel a collaboré Ghia pour la carrosserie. Copyright
La Ghia G.230/S s’inspire à la fois de la Fiat 1500 GT présentée l’année précédente et de l’Iso Grifo due à Bertone. La custode se prolonge par deux petites vitres latérales bombées augmentant la visibilité arrière. Un hayon facilite le chargement des bagages. Copyright 1964 Alejandro De Tomaso a l’ambition de produire des modèles de Grand Tourisme, capables de rivaliser avec les Ferrari, Maserati ou Lamborghini. Ce marché lucratif, malgré son étroitesse, est en pleine expansion. La première De Tomaso de ce type est la Vallelunga. De Tomaso s'adresse à Ghia par hasard. Il cherche une entreprise capable de construire en petite série sa voiture. Dans un premier temps, la Vallelunga devait être produite par Fissore, mais les relations entre le carrossier et De Tomaso se sont envenimées.
Au Salon de Turin 1964, le carrossier Fissore expose le prototype de la Vallelunga. Puis Ghia annonce qu'il va prendre en charge la production. Sur la version de Ghia, ce n'est plus toute la partie arrière couvrant le moteur qui bascule, mais seulement la lunette. Copyright Dans l'esprit, il s’agit plus d'une voiture pour circuit que d'une concurrente sérieuse pour les GT déjà existantes. La production chez Ghia tarde à démarrer. La mort de Luigi Segre bouscule le fonctionnement de l'entreprise. Autre difficulté, la technique de la fibre de verre retenue pour la carrosserie est insuffisamment maîtrisée.
La Vallelunga 1500 entre en production limitée chez Ghia. Elle est animée par un moteur central Ford de 1 499 cm3, de 105 ch (à ses débuts) ou de 135 ch. Son poids n'est que de 550 kg. 59 voitures seront produites à partir de 1967. Copyright 1964 Lorsque la Renault 8 apparaît, elle fait naître bien des convoitises de l'autre côté des Alpes. Chez Ghia, on s'empresse d'acquérir un châssis de R8 Gordini pour démontrer son savoir-faire. L'idée de proposer un modèle plus sportif sur la base de la petite berline à moteur arrière revient à Ghia, et non à Renault. Ce coupé aux lignes fluides imaginé par Filippo Sapino semble s'inspirer de la Talbot carrossée en 1938 par Figoni & Falashi, dite " goutte d'eau ", voire de certaines Bugatti des années 1930. Sapino affirmera pourtant qu'à l'époque où il a dessiné cette voiture, il ne connaissait pas ces références ! Il est le premier surpris des réactions du public. La présence d'un coupé R8 au catalogue aurait permis de mettre en peu de piment dans un catalogue Renault pour le reste assez terne. Las, devant cette réalisation, la Régie oppose un refus ferme et définitif.
Le mannequin en bois qui a servi à la construction du coupé Renault 8. On devine le futur capot en V (façon Labourdette Vutotal sur base 4 CV), et l'emplacement des vitres latérales en forme de goutte d'eau. Copyright Après être restée dans les réserves de Ghia, l'auto a été vendue. Son nouveau propriétaire l'a délaissée, et c'est dans une casse automobile que Filippo Sapino a lui-même récupéré bien des années plus tard cette oeuvre de jeunesse, averti à temps par l'une de ses relations. Cette réalisation signe la fin d'une fructueuse collaboration d'une douzaine d'années entre Ghia et Renault. Sur le plan industriel, un seul modèle a vu le jour, la Floride.
La Renault 8 de Filippo Sapino évoque par ses lignes certaines Talbot et Bugatti d'avant-guerre. Copyright
Le soin apporté à l'aménagement intérieur est fidèle à la réputation du carrossier turinois. La R8 Gordini de Ghia est présentée au Salon de Turin en novembre 1964. Copyright 1965 Le projet Cobra est confié par le plus grand des hasards à Filippo Sapino. C'est en effet le seul styliste présent dans l'entreprise le jour où Caroll Shelby et De Alejandro De Tomaso visitent Ghia, avec à l'esprit ce nouveau projet. Il s'agit de mettre rapidement au point un modèle capable de remplacer l'AC Cobra. Accessoirement, il est impératif de contrer un programme similaire que Ford a confié à Pietro Frua, que Shelby ne souhaite pas voir éclore. D'ailleurs, Shelby et Frua ont quelques inimitiés. De Tomaso y voit surtout l'occasion de développer son business, en produisant une voiture dotée d'un moteur De Tomaso et d'une carrosserie Ghia. Sapino avec le peu d'informations dont il dispose parvient à dessiner un modèle intéressant sur le plan esthétique. Mais aucune suite n'est donnée à cette proposition.
AC Cobra par Filippo Sapino. Son dessin paraît peut-être trop équilibré pour un châssis comme celui de la Shelby Cobra 427. En effet, l'image de la Cobra repose davantage sur la force brute que sur l'élégance. Copyright 1965 Cette Bugatti est présentée par Ghia au Salon de Turin en novembre 1965. La naissance d'une nouvelle Bugatti suscite de nombreuses interrogations. A la fermeture de l'usine de Molsheim, un châssis non achevé (le numéro 101.506) de Bugatti 101 a été isolé dans un coin de l'atelier. Il n'a jamais été habillé. Un amateur avisé du nom d'Allen Henderson en a fait l'acquisition, et l'a importé aux Etats Unis. Il a plus tard été racheté par Scott Bailey, fondateur du magazine de prestige Automobile Quarterly, qui lui-même l'a cédé à Virgil Exner en mars 1965.
Bugatti 101. Discutable et discutée. Sur un dessin de Virgil Exner, Ghia a habillé un châssis de Bugatti 101, le dernier sorti d'usine en 1951. Copyright Virgil Exner a quitté Chrysler en 1961, pour ouvrir son propre bureau d'études, avec son fils diplômé des beaux-arts. Il est passionné par les classiques américaines. En 1964, il conçoit la Mercer Cobra pour démontrer les propriétés décoratives du cuivre et du laiton, et raviver l'esprit de cette marque crée en 1909 et disparue en 1925. La Mercer Cobra a été assemblée par Sibona & Basano. Mais quand il a fallu choisir un carrossier pour la Bugatti, Exner s'est tourné vers ses anciens amis de chez Ghia. L'homme est doté d'un joli carnet d'adresses, qu'il s'est notamment constitué dans les années 1950. Il conserve une affection particulière pour la carrosserie turinoise, qui lui a permis de se faire un nom sur la scène internationale. Quand il s'agit pour Exner d'habiller ce châssis Bugatti neuf, il contacte donc très naturellement Ghia. Exner imagine pour cette Bugatti des lignes mixant modernité et tradition, en conservant notamment la calandre en forme de fer-à-cheval. Il est effectivement difficile de marier un radiateur classique avec une face avant de style moderne. Le traitement de l'arrière est jugé plus réussi, avec des ailes effilées. Ghia se charge d'assembler la voiture. Une fois terminée, elle est exposée dans le hall de France Motors à Neuilly, alors importateur Ghia, avant de prendre la direction du Salon de Turin. Le résultat est qualifié en l'époque de " navrant " dans une brève du célèbre magazine Moteurs.
Bugatti 101 par Virgil Exner. Cette réalisation est rendu possible par la découverte d'un châssis de Bugatti 101 qui n'avait jamais été carrossé. Copyright 1965 Alejandro De Tomaso qui ne veut plus se cantonner aux voitures de course et aux cylindrées inférieures décide après la Vallelunga qu'il est temps d'affronter les rivaux qu'il mérite. Ainsi, il imagine en 1964 une barquette à moteur V8 Ford de 4,7 litres optimisé par ses soins, qui reprend le concept du châssis poutre de la Vallelunga. Ce projet attire l'attention de son ami Carroll Shelby, qui lui prête les services de son designer maison, Pete Brock. Diplômé de l'Art Center of Design de Pasadena, il tient surtout sa notoriété de l'étude de la Cobra Daytona en 1964. A une époque où le moteur central révolutionne l'architecture des voitures de sport, De Tomaso apporte sa pierre à l'édifice. Un premier prototype dénommé P70 est dévoilé au Salon de la voiture de course de Turin en février 1965, suivi un second au Salon de Turin en novembre de la même année. La voiture se distingue par son pare-brise enveloppant et son aileron stabilisateur arrière articulé, qui peut servir de frein aérodynamique.
Ghia De Tomaso 5 Litres. Carroll Shelby, accaparé par la mise au point de la Ford GT 40, se désintéresse du projet de De Tomaso. Cette base sera alors utilisée pour donner naissance à la Mangusta. Copyright 1965 La G.230/S réapparaît au Salon de Genève 1965 sous la forme d'un cabriolet. L'obstination de Giacomo Gaspardo Moro permet de sauver ce projet. Il a frappé à toutes les portes. Seul Chrysler, son ancien partenaire, a exprimé de l'intérêt. En adoptant un V8 de Plymouth Barracuda, la G.230/S devient la 450 SS. Le contrat entre Ghia et Chrysler porte sur la production d'une cinquantaine d'exemplaires. Les voitures seront commercialisées par Ghia en Europe et Chrysler aux Etats-Unis. Les Américains ont imposé la production d'un cabriolet, et non d'un coupé. En effet, avec cette automobile, ils visent surtout le riche marché californien. C'est le meilleur endroit au monde pour trouver suffisamment de clients disposés à payer cher leur automobile, afin de ne pas avoir la même voiture que leur voisin. Cinquante-deux voitures seront produites et vendues par l'intermédiaire d'un concessionnaire exclusif de Beverly Hills.
La Ghia 450 SS est présentée au Salon de Paris 1966, confirmant le début de la diffusion de la voiture en France. Son prix de vente est fixé à 58 300 francs, soit plus de 12 fois celui d'une Fiat 500. Copyright
1966 Giorgetto Giugiaro vient d'être recruté par Giacomo Gaspardo Moro, et d'emblée, il va frapper fort. Le Salon de Turin 1966 va marquer l'histoire de Ghia qui présente quatre nouveautés absolues : la Maserati Ghibli et la De Tomaso Pantera en tant que modèles destinés à la série, et la De Tomaso Pampero et la Fiat 850 Vanessa en tant que prototypes. Giorgetto Giugiaro a dessiné la Maserati Ghibli en moins de trois mois. Alors que les Maserati précédentes jouaient sur une allure discrète, la Ghibli affiche sans complexe une silhouette spectaculaire. Il n'y a plus de distinction entre la carrosserie et l'habitacle, qui au lieu d'être superposé, est parfaitement intégré au volume général.
La Maserati Ghibli dévoilée en 1966 est un chef d’œuvre signé Giorgetto Giugiaro. Le trident sur la face avant est le seul lien de la voiture avec la tradition Maserati. Copyright Ce qui frappe sur la Ghibli, c'est le rapport inhabituel entre la hauteur de flanc et la surface vitrée. La nette prédominance de la tôle évoque l'idée de puissance et d'adhérence au sol. La hauteur réduite du capot est utilisée pour créer un avant complètement nouveau. La calandre occupe toute la largeur. Elle est entourée d'une bande de chrome faisait office de pare-chocs. L'actionnement des feux de route fait se lever les paupières qui accueillent des doubles phares circulaires. Une saillie centrale et deux vastes prises d'air ornent le capot.
La ligne de ceinture monte doucement de l'arête des pare-chocs jusqu'aux glaces, se relevant brusquement à la hauteur de la deuxième fenêtre, pour redescendre ensuite vers l'arrière. Copyright Le pavillon présente une ligne continue jusqu'à l'arrière en pan coupé, qui est doté d'un pare-chocs enveloppant, seul élément ajouté à cette forme très pure. La dimension la plus frappante est la hauteur de 1,16 mètre, comme si Giugiaro avait délibérément privilégié l'esthétique à l'habitabilité. La carrosserie est fabriquée chez Vignale. Les premières voitures sont commercialisées fin 1967. La Ghibli sera produite à 1 150 exemplaires. 1966 Le prototype de la De Tomaso Mangusta qui apparaît sur le stand Ghia au Salon de Turin 1966 est une réponse à la Cobra de Carroll Shelby. La mangouste étant, comme chacun le sait, l'ennemi héréditaire du cobra au sein du règne animal. Le châssis-poutre supporte un V8 Ford de 4 728 cm3, situé entre le pont arrière et les sièges, dans le dos des passagers. Retravaillé par De Tomaso, il offre 305 ch. La Mangusta affiche une ligne remarquablement dynamique. L'avant, effilé comme le nez d'un squale, et dépourvu de tout pare-chocs. Il contraste avec l'arrière rebondi et trapu. La hauteur de 1,03 mètre fait de la Mangusta au moment de sa sortie la voiture la plus basse jamais dessinée par Giugiaro.
De Tomaso Mangusta. Un moteur Ford américain placé au centre, un châssis à poutre centrale et une sublime carrosserie sculptée par Giorgetto Giugiaro pour Ghia. Pour nombre de spécialistes, elle devient une icône du design automobile des années 1960. Copyright Réalisée en tôle d'acier (seul le pavillon et le couvercle de coffre sont en aluminium), la Mangusta est une stricte deux places. L'accessibilité à la mécanique et à la roue de secours s'effectue grâce au soulèvement de l'arrière en deux parties, selon une articulation longitudinale et symétrique, située sur la côte dorsale de la carrosserie. Un cristal transversal sépare complètement l'habitacle de la partie postérieure. L'aménagement de l'habitacle apparaît très épuré.
La Mangusta est construite en petite série de 1967 à 1970 à la cadence de 3 ou 4 voitures par jour. Copyright Une fois les voitures arrivées entre les mains de leurs nouveaux propriétaires enthousiastes, des défauts majeurs apparaissent et les problèmes commencent. L'embrayage est lourd, la climatisation peu efficace, les vitres ne se ferment pas complètement, la direction apparaît dangereuse, le freinage est médiocre, la visibilité arrière est ridicule, et la position de conduite est décalée. On réalise ainsi à quel point l'attrait commercial de la Mangusta repose surtout sur le dessin brillant de Giugiaro.
La De Tomaso Mangusta lancée en 1966 est la première De Tomaso carrossée par Ghia. La voie arrière est sept centimètres plus large que celle de l'avant. L'arrière est dominé par la lunette en deux parties, sous laquelle se trouvent deux larges prises d'air. Copyright 1966 Comme les Vallelunga et Mangusta, La De Tomaso Pampero de Ghia est dotée d'un châssis à poutre centrale avec un moteur positionné entre les sièges et l'essieu arrière. Cette solution procure une meilleure répartition des masses, d'où un centre de gravité aussi idéal que possible, qui confère à la Pampero un comportement routier relativement neutre. Le moteur est celui de la Vallelunga, un 4 cylindres en ligne Ford de 1 498 cm3, alimenté par deux carburateurs double corps Weber.
Dans son dossier de presse, Ghia présente la Pampero de manière assez alambiquée : " Après avoir obtenu un succès indiscutable avec le coupé, Ghia présente maintenant le type roadster de la Mangusta ". Copyright L'avant se caractérise par une grande calandre à mailles fines qui recouvre des doubles phares circulaires. La calandre et le capot plat dépourvus de décorations contribuent à créer un aspect net, mais d'une telle rigueur que la Pampero semble bien dépouillée, voir ennuyeuse, par rapport à ses congénères. L'arrière présente quelques similitudes avec la Fiat 850 Spider que Giugiaro a conçue quand il travaillait pour Bertone. Ce modèle unique ne semble pas avoir marqué outre mesure le public de Turin.
La Pampero est l'un des concept cars les moins connus des années 1960. Le talent de Giugiaro ne s'est pas exprimé avec autant d'efficacité que sur les Ghibli et Mangusta. Copyright 1966 La Vanessa est un coupé quatre places et deux portes, réalisé sur un châssis de Fiat 850, et " pensé pour les femmes " ! C'est une deux volumes novatrice dont on peut penser qu'elle a influencé l'étude de Giugiaro pour l'Alfasud.
La Vanessa est une curieuse proposition de Giugiaro pour une voiture pratique conçue spécialement pour une clientèle féminine. Copyright L'habillage est habillé de draps de couleur mauve clair. Le dossier du siège arrière est rabattable, procurant ainsi un vaste plan de chargement, auquel on accède de l'extérieur, côté trottoir, par une portière latérale largement ouverte à hauteur de ... femme.
Le thème est inhabituel pour le monde automobile si profondément masculin : " une voiture à la mesure de la femme ". Plus tard, les constructeurs tenteront de séduire ce public en jouant sur l'aspect des voitures ou sur leur finition. Copyright Le toit supporte un panneau transparent qui peut être enlevé. La transmission est automatique. Le siège avant, dont le dossier est inclinable, est muni d'un dispositif autorisant sa rotation afin de faciliter la sortie de la conductrice. A l'arrière, le dossier de la banquette comporte un siège pour enfant.
Dans les années 1960, le sexisme a encore droit de cité. En 1966, c'est Madame qui fait les courses, et conduit les enfants à l'école. La Venessa laisse le public relativement indifférent. Copyright Si changer les vitesses est supposé peu commode pour une femme, il semble que lire les instruments de bord le soit autant. Les compteurs à aiguille sont donc remplacés par un panneau de voyants dont la vocation est d'alerter. Sur la planche de bord est installé un tiroir compartimenté pour ranger des effets de maquillage ou divers accessoires.
Le styliste a privilégié l'aménagement intérieur avec des sièges arrière rabattables, des panneaux latéraux " papillon ", un siège conducteur pivotant et une bonne visibilité facilitant les manoeuvres. Copyright 1966 Au début des années soixante, Virgil Exner s'amuse à " ressusciter " des automobiles : une Pierce Arrow qui ne dépasse pas le stade de la maquette, la Mercer Cobra, vision réactualisée de la Mercer de course des année 1911/1912, et enfin la Bugatti 101 basée sur un authentique châssis Bugatti. C'est en travaillant sur ces voitures uniques que lui vient l'idée de recréer l'esprit d'une marque disparue à travers une série spéciale basée sur l'un ou l'autre des modèles de série américains. Commence alors le projet Duesenberg, dont le but est d'aboutir à une production régulière dans le giron d'un grand constructeur, auquel le projet aura été vendu " clé en main ". Le prototype est réalisé chez Ghia et présenté en grande pompe au Sheraton Lincoln Hôtel d'Indianapolis le 29 mars 1966. Derrière l'écran de fumée médiatique, Exner est en pleine tractation commerciale avec Chrysler, le but étant de confier au troisième constructeur US la production d'une série spéciale d'Imperial baptisée Duesenberg, qui serait vendue par le réseau Chrysler à une clientèle aisée en quête d'exclusivité.
Si la Duesenberg qu'a fait renaître Virgil Exner avait eu un avenir, cela n'aurait certainement pas été dans les encombrements urbains. Ce prototype mesure en effet 6,22 mètres de long. Copyright Mais plusieurs problèmes se profilent à l'horizon. Premièrement, les droits sur le nom Duesenberg ne semblent pas totalement acquis à Virgil Exner. Plusieurs autres ayants droit se seraient fait connaître ! D'autre part, l'équipe marketing de Chrysler chargée d'étudier l'impact commercial de l'opération " Duesenberg " rend des conclusions particulièrement négatives. Certes, l'idée d'évoquer une marque célèbre et disparue n'est pas mauvaise, mais la clientèle pour ce genre de véhicule est trop limitée. La Duesenberg tombe dans l'oubli. 1966 Un ami de Giacomo Gaspardo Moro, un journaliste japonais dénommé Hideyuki Miyakawa, lui propose un contrat de consultant pour le compte d'Isuzu. C'est dans le cadre de ce contrat qu'est dessinée l'Isuzu 117 sous la responsabilité de Giugiaro. Il s'agit de son premier projet pour le compte de Ghia. Le prototype de ce coupé 2 + 2 aux lignes simples, fluides et lumineuses est présenté sur le stand du carrossier au Salon de Genève 1966.
La base des fenêtres de l'Isuzu 117 est parallèle à la ceinture en s'élevant légèrement vers l'arrière, alors qu'en haut, elle suit une ligne brisée. Copyright L'Isuzu 117 est commercialisée sous sa forme définitive à partir de décembre 1968, avec une mécanique issue de la berline Florian, sérieusement améliorée toutefois. Le thème du coupé 2 + 2 ramène Giugiaro aux formes de la Fiat Dino qu'il a dessiné pour Bertone. On retrouve sur l'Isuzu, en plus compact, le dessin de la face avant, le mouvement de la ligne de ceinture et la coupe du coffre à bagages typiques de la Dino.
L'Isuzu 117 Sport, performante et bien finie, est produite à 86 192 exemplaires. Elle disparaît du catalogue en 1981 pour céder sa place à la Piazza, un autre coupé dessiné par Giugiaro, depuis 1968 à son compte sous l'enseigne Ital Design. Copyright 1967 Ce coupé 2 + 2 dont le dessin est signé Giugiaro emprunte son nom au dieu viking Thor. Le moteur et le châssis sont identiques à ceux de l'Oldsmobile Toronado. L'empattement et les voies sont inchangés. Dans un but esthétique, la carrosserie qui reste imposante est réduite en longueur, grâce à des porte-à-faux réduits, 5,20 mètres contre 5,36 mètres. La largeur gagne 1 cm, 2,00 mètres contre 1,99 mètre, et la hauteur est inférieure, 1,25 mètre contre 1,34 mètre.
Trois ans après avoir réinterprété pour Bertone la Ford Mustang, Giugiaro se voit de nouveau proposer de reconsidérer l'aspect d'une classique américaine, l'Oldsmobile Toronado à traction avant née en 1965. Copyright La ligne de ceinture, à partir de l'arête du pare-brise, s'abaisse le long de la porte pour remonter vers le pied arrière. Le mouvement ascendant s'accentue après le montant, et presque à la hauteur du passage de roue, s'interrompt brusquement pour redevenir horizontal. Ce mouvement, souligné par le profil à raccord continu entre toit et arrière, devient la principale caractéristique de ce prototype. A l'intérieur, les quatre places offrent tout le confort souhaitable, et les normes de sécurité ont été étudiées pour répondre aux exigences américaines.
L'Oldsmobile Thor dessinée par Giugiaro est un gros coupé sur châssis Oldsmobile Toronado à traction avant. On peut regretter la ligne d'aile arrière excessivement courbée. Copyright 1967 Le projet de cette citadine électrique exposée au Salon de Turin 1967 a été commandé par Rowan Industries, une entreprise américaine, dont les beaux-frères d'Alejandro de Tomaso sont actionnaires et dirigeants. C'est la première fois que Ghia s'intéresse à une automobile à usage urbain. La surface vitrée latérale occupe une surface supérieure à celle de la tôle. Dans une longueur de 3 mètres, l'équivalent d'une Mini, Giugiaro a tracé un capot et un pare-brise à raccord continu, et un arrière très vertical. C'est une mono volume avant l'heure. Rowan fournit la motorisation électrique.
Sur le stand Ghia, à côté des trois coupés Mangusta, Ghibli et Thor, la Rowan fait figure de vilain petit canard. La porte s'ouvre dans le sens " contraire ". Copyright Rowan vient par ailleurs d'apporter les capitaux nécessaires au rachat de Ghia à la famille Trujillo et aux héritiers de Luigi Segre. C'est le seul projet qui pourrait justifier l'entrée de cette société au capital de Ghia, car elle est plus habituée à produire du matériel électrique. La Rowan suscite quelques perplexités liées aux performances annoncées, en l'occurrence une autonomie de 320 km pour une vitesse maximum de 75 km/h.
Rowan Industries, le nouvel actionnaire de Ghia, donne son nom à un monospace électrique citadin à quatre places, dessiné par Giugiaro. A l'époque, l'industriel travaille sur un chargeur rapide, capable de recharger les batteries en 20 minutes, contre les 8 heures normales. Copyright 1967 Pour relancer ses ventes, Iso Rivolta présente au Salon de Francfort 1967 une berline quatre portes dotée d'un V8 Chevrolet de 5,3 litres. La nouvelle voiture baptisée S4, est conçue pour concurrencer la Maserati Quattroporte apparue en 1963, alors quasiment seule sur le marché de la berline ultra sportive. Elle est lancée avec le slogan " les quatre fauteuils les plus rapides du monde ". Le style de la berline S4 est signé Giugiaro. Son dessin se veut moderne grâce à une ligne surbaissée et à de vastes surfaces vitrées. On retrouve sur la S4 quelques traits de style de la Mangusta, notamment au niveau de la face avant.
La première berline de la marque Iso Rivolta, la S4 lancée en 1967, apparaît bien plus moderne que sa concurrente directe, la Maserati Quattroporte née en 1963. Mais Iso n'a pas l'aura de Maserati. Copyright Aborder le thème de la berline trois volumes quatre portes à l'aspect franchement sportif n'est pas une sinécure pour un designer. Les dimensions généreuses de la voiture, 4,97 mètres de long sur 1,78 mètre de large, ne facilitent pas le dessin de formes équilibrées. Pour autant, la S4 démode d'un coup la Quattroporte de Pietro Frua, qui est supprimée du catalogue en 1969. Après une production de 45 exemplaires environ, de sérieux défauts de peinture et de finition imposent à Iso de revoir tout son processus de fabrication. Le modèle est rebaptisé Fidia, et relancé à Athènes en février 1969. Iso Rivolta produira 192 S4 / Fidia, contre 776 Maserati Quattroporte. La marque ne supporte pas la récession consécutive à la crise pétrolière, et disparaît en 1974.
Présentée en septembre 1967 au Salon de Francfort sous la désignation S4, la berline Iso Rivolta est rebaptisée Fidia en février 1969. Cette berline sera produite en 192 exemplaires, avec un V8 Chevrolet puis un V8 Ford. Copyright 1968 Le succès de la Maserati Ghibli, une stricte deux places, incite Ghia a lancer l'étude d'une nouvelle Maserati 2 + 2. La Simun est réalisée sur un châssis et une mécanique de Maserati Mexico. C'est le dernier projet de Giugiaro pour Ghia, avant qu'il n'ouvre son propre atelier de design.
La Maserati Simun reprend le même thème stylistique que l'Oldsmobile Thor. Le constructeur de Modène lui a préféré l'Indy proposée par Vignale. Copyright La Simun présente de fortes analogies avec l'Oldsmobile Thor, en particulier avec sa seconde fenêtre très courbée. Par contre, de vrais pare-chocs sont installés, qui protègent une calandre amincie. Les phares sont sous des paupières rabattables. L'ensemble apparaît moderne, sans pour autant apporter de véritables nouveautés.
Le prototype Simun sur base de Maserati Mexico sera la voiture personnelle d'Alejandro De Tomaso à la fin des années 1960. Il s'agit du dernier dessin de Giugiaro pour Ghia. Copyright
Maserati commence à appeler ses voitures avec des noms de vent (Mistral, Ghibli, Zonda, Khamsin). Le Simun est un vent chaud et sec qui souffle sur les régions désertiques du Sahara en direction du nord. Copyright 1968 Nous sommes en 1967. Alejandro De Tomaso vient de reprendre Ghia avec l'appui de Rowan Industries. Les nouveaux propriétaires ne manquent pas d’ambition, ils rêvent de diversification, et s’imaginent déjà constructeur automobile sur le sol américain. La tâche n'est pas simple : il faut à la fois se faire un nom, éviter d'attaquer de front les Big Three et faire un peu de volume. L'idée germe donc de séduire en priorité les flottes de taxis en proposant un successeur à l'antédiluvien Checker. Construite sur un châssis Checker et équipée d’un moteur General Motors de 4,6 L, la Ghia Centurion est une limousine de 5,40 mètres de long, qui offre un espace intérieur inédit. Mais à vrai dire, pour dessiner ce mastodonte, cela a ressemblé à une impasse : Ghia n'est plus qu'une coquille vide. Giorgetto Giugaro s'en est allé. Sergio Sartorelli et Sergio Coggiola ont aussi quitté le navire, entraînant dans leur sillage une bonne partie de l’équipe, ainsi que les clients, notamment Volvo et Renault. En attendant, Ghia n'a pas eu d’autre choix que de confier ce travail à la jeune et éphémère société Ital Styling, future Ital Design. A sa tête, un certain ... Giugiaro.
Comparé au style daté de la Checker que l'on croise dans les rues des grandes villes américaines, la nouvelle venue apporte quelques améliorations. Les roues sont toutefois sous dimensionnées, tandis que l'habitacle semble avoir été conçu pour des clients portant des hauts-de-forme. Ce n'est indiscutablement pas LE chef d'oeuvre de Giugiaro. Copyright Giugiaro confie cette tâche à Tom Tjaarda qui travaille avec lui pendant trois mois, avant d'accepter de revenir chez Ghia sur l'insistance d'Alejandro de Tomaso … Le prototype roulant est achevé durant l'été 68, la décision est prise de le présenter au Salon de Paris en fin d'année, puis à celui de New York en 1969. L'objectif est évidemment de tester la réaction du public avant d’envisager une éventuelle mise en production. A Paris, la Centurion rencontre un succès d'estime. Mais à New York, le concept est moqué par la presse, car jugé trop éloigné des canons américains, et en décalage avec le marché des taxis.
Checker s’accroche d’une manière incompréhensible à son modèle franchement démodé, repoussant toute idée de remplacement, comme chez l’indien Hindustan avec son Ambassador ou le britannique Morgan. En effet, la version modernisée proposée par Ghia en 1968 ne l'intéresse pas. Copyright 1968 Pour le constructeur turinois Serenissima, Tom Tjaarda imagine une berlinette à moteur central aux lignes épurées. C'est un projet de rêve pour tout designer. Il est commandé par le comte Giovanni Volpi, un ami de De Tomaso. Le comte est issu d'une vieille et noble famille italienne. Il a hérité de l'immense fortune de son père à 24 ans, et fondé sa propre écurie de courses, la Scuderia Serenissima.
Serenissima Ghia GT. Tom Tjaarda a regroupé dans ce coupé plusieurs idées qu'il a étudiées précédemment. L'un des motifs de style original est le montant central ajouré qui suggère la structure. Copyright En 1967, Serenissima étudie une première voiture de grand tourisme, l'Agena, dont le style reste assez impersonnel. De Tomaso fait comprendre à son ami que s'il souhaite intégrer la famille des fabricants de GT, il doit proposer une automobile au design plus attractif. La voiture est équipée à l'origine d'un V8 Massimino 3,5 litres, remplacé en 1969 par un moteur Alf Francis M-167, qui développe 320 ch. La Serenissima Ghia GT est présentée au Salon de Turin 1968.
La Serenissima Ghia GT, initialement de couleur verte, est exposée au Salon de Turin 1968 sur le stand Ghia où elle côtoie une Maserati Ghibli Spyder et le prototype Maserati Simun. Copyright Ghia revendique dans son dossier de presse une voiture présentant un équilibre esthétique, aérodynamique et technique exceptionnel. On retrouve cette voiture au Salon de Genève en mars 1969. C'est cette même année 1969 que la teinte change pour adopter la livrée bicolore rouge qui est encore la sienne de nos jours. Hélas, le comte Volpi rencontre au même moment quelques difficultés financières, et doit renoncer à son projet. La voiture est mise en vente par la famille. Artcurial s'en charge lors du Rétromobile 2019.
A l'intérieur, l'habitacle comporte deux sièges baquet en cuir d'origine. Sur la planche de bord est alignée une série complète de compteurs et manomètres. Le levier de vitesses se déplace dans une grille. Les vitres électriques, un volant à jante bois et des commandes de climatisation rappellent la personnalité GT de cette voiture, qui mêle sport et luxe. Copyright 1968 Maserati confie à Ghia l'étude d'une version Spyder de la Ghibli. La voiture est présentée au Salon de Turin 1968. Il s'agit de l'une des dernières interventions de Giugiaro pour Ghia, avant le retour de Tom Tjaarda. La modification apportée aux deux réservoirs d'essence qui avait influencé l'aspect de l'arrière du coupé Ghibli, lui permet de dessiner un arrière bas et fuyant.
Le Spyder Ghibli lancé fin 1968 épaule le coupé, et comme le Spyder Mistral, la capote disparaît complètement derrière les sièges. Copyright La voiture, normalement équipée d'une capote en toile, peut être livrée sur demande avec un hardtop au design harmonieux. Il est peint de la même couleur que la carrosserie, et le Spyder prend alors l'allure d'un véritable coupé. Le Spyder Ghibli comporte des renforts de bas de caisse et de tunnel de transmission.
La production du Spyder Ghili est restée marginale, seulement 125 exemplaires. L'essentiel de la production a pris la direction des Etats-Unis. Copyright 1969 Alejandro De Tomaso demande à Tom Tjaarda, de retour chez Ghia, de se pencher sur le cas de la Lancia Fulvia, qui dans sa version coupé remporte depuis 1965 un certain succès commercial. Il s'agit d'imaginer un concept car pour animer le stand du Salon de Genève 1969, et ainsi mettre en valeur le savoir-faire de Ghia. A la même époque, Lancia cherche un repreneur, et De Tomaso aimerait bien aiguiser l'appétit de la direction de Ford, par l'intermédiaire de son ami et PDG Lee Lacocca. Le but ultime de De Tomaso serait d'ailleurs d'obtenir la présidence de Lancia. Le projet de Tjaarda est sportif et agressif, avec une calandre mince et un postérieur façon fastback.
Il faut reconnaître à ce coupé Lancia Fulvia HF 1600 Competizione présenté au Salon de Genève 1969 à la fois une modernité dans les formes et une certaine élégance. Copyright A l'arrière, la finesse des feux et de la lame de pare-chocs s'inscrit dans la même logique. L'aileron est réglable électriquement depuis l'habitacle, et une fois abaissé, il s'intègre parfaitement au profil de la voiture. Il s'agit plus d'un accessoire esthétique que réellement fonctionnel. Ce prototype est plus bas que le coupé Fulvia de série, 1,13 mètre contre 1,30 mètre. La position de conduite exige que les jambes soient plus tendues vers l'avant. Les phares sont rétractables. Le dessin des parties basses des porte-à-faux avant et arrière remontant vers les extrémités sera reproduit quasiment à l'identique quelques mois plus tard sur la Lancia Flaminia Marica.
Lancia Fulvia HF 1600 Competizione. Cette voiture était destinée à devenir un modèle de série. Copyright Malgré la notoriété de Ghia, le projet de la Fulvia HF 1600 Competizione comme bien d'autres tourne court. L'arrivée progressive de Ford au capital de Ghia conduit le carrossier à s'intéresser à d'autres projets moins exotiques, plus en relation avec les besoins quotidiens de Ford. Fiat, ayant eu écho d'un possible rapprochement entre Ford et Lancia, s'empresse de racheter ce dernier avec le soutien moral des autorités italiennes. Le prototype Fulvia HF 1600 Competizione sera modifié dans un second temps de manière peu convaincante, en recevant, entre autres détails, une volumineuse prise d'air noire sur le capot avant. Les bas de caisse seront repeints en noir aux deux extrémités, et la partie noire entre les passages de roue sera rehaussée. Comme d'autres concept cars, celui-ci sera oublié dans les réserves de Ghia, avant d'être racheté en 1976 par Giulio Vignale, le neveu d'Alfredo Vignale. 1969 La De Tomaso Vallelunga, malgré des qualités reconnues par la presse spécialisée, ne s'est vendue qu'à 59 exemplaires en quatre ans. Depuis, De Tomaso a dévoilé la Mangusta au Salon de Turin 1969. La voiture, plus attrayante, et vendue à 402 exemplaires, a fait la une de tout la presse spécialisée lors de sa présentation, et a permis à De Tomaso de s'installer dans la famille des constructeurs italiens de GT.
Le prototype de la Mustela est présenté au Salon de Turin 1969. Bien que dessinée par Tom Tjaarda, la face avant rappelle la Mangusta de Giorgetto Giugiaro . Copyright Mais Alejandro De Tomaso voit plus grand avec un produit plus accessible, et il demande à Tom Tjaarda d'étudier un coupé à mécanique Ford. Le designer imagine la Mustela, une 2 + 2 dotée d'un hayon, capable de rentrer en production rapidement. La voiture est animée par un V6 de Ford Zodiac. La puissance de moteur retravaillé est portée de 128 à 230 ch. La Mustela mesure 4,05 mètres de long, et ne pèse que 1 100 kg. Sa vitesse maximale s'établit à 230 km/h. Mais elle ne dépassera pas le stade du prototype ...
De Tomaso Mustela. Alejandro De Tomaso qui voit grand souhaite proposer une automobile moins onéreuse. Il confie le dessin d'un coupé 2 + 2 à Tom Tjaarda. La voiture ne suscite pas l'intérêt des autres constructeurs que De Tomaso espérait. Copyright 1969 La marque Isuzu voit le jour au Japon en 1949 en fabriquant des utilitaires. A partir de 1953, Isuzu propose sur ses terres l'Hillman Minx, construite sous licence britannique. La première Isuzu originale, la Bellel, est présentée en 1961. La Bellett, plus compacte, complète l'offre en 1963. En 1964, la véritable star de la gamme Isuzu est la Bellett 1600 GT. Isuzu souhaite en dériver une version coupé dessinée en Europe, et contacte Ghia. Il s'agit du premier projet de Giugiaro pour Ghia, qui donne naissance à l'élégante Isuzu 117 dévoilée au Salon de Genève 1966. Lorsque Isuzu cherche à animer son stand du Salon de Tokyo 1968 avec une voiture de Grand Tourisme à moteur central, il s'adresse de nouveau assez naturellement à Ghia. Contraint par les délais, Alejandro De Tomaso demande à Tom Tjaarda de travailler vite sur ce projet. Pourtant, les exigences des Japonais sont nombreuses, tant sur le plan technique qu'esthétique, et décontenancent Tom Tjaarda. Alors que sur les quelques voitures à moteur central commercialisées dans les années 60, on peine à deviner où se trouve la mécanique, Tom Tjaarda fait en sorte que l'on n'ait pas à se poser la question avec cette nouvelle étude.
L'Isuzu Bellett MX 1600 GT de manière bien involontaire va constituer un brouillon de ce que va devenir la De Tomaso Pantera, incontestablement plus réussie. Copyright 1969 Tom Tjaarda se penche sur le sort de la Lancia Flaminia en fin de carrière. De nouveau, on lui demande de travailler dans l'urgence, car il s'agit de présenter la Marica au Salon de Turin 1969. Les extrémités supérieures des montants B et C permettent une découpe des vitres en forme de pyramide. C'est un motif que sera repris quelques années plus tard par Pininfarina sur le coupé Gamma. La voiture est effectivement exposée à Turin le 29 octobre 1969, mais non roulante. Le tableau de bord en bois a été bricolé à la va-vite et il n'y a ni freins, ni câblage électrique, ni réservoir de carburant ! L'amateur qui s'en est porté acquéreur en 1970 à rapidement remédié à ces quelques inconvénients ...
Lancia Flaminia Marica. L'arrivée de Fiat dans le capital de Lancia met fin à cette étude. Marica est un prénom féminin de l'époque romaine. On devine en arrière-plan la De Tomaso Mustela. Copyright 1970 Après la Rowan électrique de 1967, Ghia s'intéresse de nouveau à l'automobile à vocation urbaine, dotée cette fois d'un moteur thermique. Avec la Ghia City, il s'agit d'offrir un maximum d'espace intérieur dans une carrosserie très compacte.
Ghia City Car. Peu nombreux sont encore les ingénieurs à se préoccuper de l'optimisation de l'espace. A ce titre, la City Car est en avance sur son temps. Copyright Le moteur est un modeste 500 cm3. Avec quatre places assises et un espace pour les bagages au-dessus du moteur en position arrière, la voiture affiche 500 kg de charge utile. Les portes sont de type suicide. L'ensemble est plutôt agréable à l'oeil.
Ghia City Car. Ghia a réalisé une voiture compacte à souhait. Le moteur de 500 cm3 de cyclomoteur Brunelli est logé à l'arrière sous le plancher du coffre, auquel on a accès par une troisième porte. Copyright 1970 Lee Lacocca et Alejandro De Tomaso entretiennent d'excellentes relations. Le premier aimerait bien contrer le succès de la Chevrolet Corvette, et accessoirement laver l'affront infligé par Enzo Ferrari lors de la tentative ratée de rachat de Ferrari par Ford. Christina Ford, l'origine italienne, deuxième épouse d'Henry Ford II, adore sa Maserati Ghibli. Lee Lacocca a depuis toujours un faible pour les belles voitures italiennes. A eux deux, ils parviennent à convaincre Henry Ford II de développer une gamme de modèles haut de gamme italo-américains. Des ingénieurs sont dépêchés depuis les Etats-Unis chez De Tomaso pour évaluer le potentiel de la Mangusta. Mais celle-ci est loin de répondre à leurs exigences. Il paraît dès lors logique de développer une nouvelle voiture, plus aboutie. De Tomaso confie cette mission à Tom Tjaarda, heureux de retrouver plus de liberté de création depuis son départ de chez Pininfarina. Lee Lacocca et Tom Tjaarda sympathisent. En seulement neuf mois, l'étude de la Pantera est menée, et la production est lancée dans les ateliers de Vignale. Ford est enthousiaste, et prend une participation dans le capital de De Tomaso. Lee Lacocca fait face à une baisse des ventes des gammes Lincoln et Mercury. La Pantera, qui doit être diffusée dans le réseau des dealers de ces deux marques, sera un bon moyen de faire revenir la clientèle dans les show-rooms. Elle est propulsée par un V8 Ford de 5 763 cm3 de 310 ch.
Depuis 1967, Ghia travaille surtout pour De Tomaso. La Pantera lancée en 1970 est dessinée par Tom Tjaarda et succède à la Mangusta. Copyright La version définitive est dévoilée à la presse en mars 1970 à Monza. Le public américain la découvre au Salon de New York le 4 avril, où cette GT jaune vif est bien accueillie. Son prix plaide en sa faveur, car elle est près de deux fois moins chère que les Ferrari Daytona ou Lamborghini Miura, les deux supercars qui dominent le marché. Cela apparaît à priori comme un pari bien engagé. De Tomaso a l'ambition de produire 5 000 Pantera par an, principalement à destination des Etats-Unis. L'administration américaine tarde à homologuer la voiture. Sa diffusion commence donc d'abord en Europe. La Pantera est finalement commercialisée outre-Atlantique en 1971. Mais contre toute attente, les Pantera doivent d'abord passer par un atelier Ford spécialisé dans la résolution des problèmes de qualité. 130 clients américains se laissent séduire en 1971, puis 1 552 l'année suivante. Pour autant, la Pantera ne répond pas aux attentes de Ford. Le constructeur US lassé par les défauts récurrents de qualité, et face aux conséquences de la crise pétrolière, résilie le contrat avec De Tomaso en 1973. Il revend sa participation pour un prix dérisoire à Alejandro De Tomaso. Par contre, il conserve dans son portefeuille les marques et les ateliers Ghia et Vignale.
Au début des années 1970, Ford distribue les Pantera aux États-Unis. Les Américains aiment la voiture en raison de sa mécanique V8 Ford sans problème, et quelques milliers de Pantera y sont expédiées. Bientôt, les Américains apprendront à détester la voiture en raison de sa mauvaise qualité de construction. Finalement, Ford jettera l'éponge. Copyright La carrière de la belle italienne est loin d'être terminée, et les ventes se poursuivent en Europe. Une fois toutes les défaillances traitées, la Pantera apparaît comme une bonne affaire comparée à ses concurrentes. La présence au catalogue de cette supercar sera exceptionnellement longue, puisqu'il n'y sera mis fin qu'en 1993, avec au compteur 7 258 voitures produites. 1970 Toutes les De Tomaso sont équipées de mécaniques Ford USA. C'est lors d'une rencontre entre Tom Tjaarda, le designer attitré de la marque De Tomaso, et Lee Iaccoca, que ce dernier incite Tjaarda à concevoir une limousine capable de concurrencer les Jaguar outre Atlantique. L'objectif est de concevoir une Jaguar " différente ".
La Deauville est présentée en même temps que la Pantera au Salon de Turin en novembre 1970. Copyright Pressé par le temps, Tom Tjaarda accouche d'une berline certes élégante, mais qui reprend de nombreux traits caractéristiques de la Jaguar XJ. La face avant n'a toutefois pas la grâce de la voiture anglaise, avec sa calandre sans âme et ses phares qui semblent hésiter entre les formes rondes et carrées. Le dessin de la Deauville n'évoluera que très peu durant sa carrière.
La De Tomaso Deauville présentée en 1970 est une berline de luxe dessinée par Tom Tjaarda qui entend concurrencer les Maserati Quattroporte, Iso Fidia, Monteverdi 375/4, Mercedes 300 SEL 6.3 et Jaguar XJ6. Copyright D'une cylindrée de 5 763 cm3, le V8 Ford développe 270 ch Din, et permet à cette berline d'atteindre 230 km/h. Finalement, les relations entre Modène et Détroit se détériorent, et la Deauville n'est pas exportée vers les Etats-Unis. En Europe, la présence d'un réseau de vente réduit à sa plus simple expression ne favorise guère une large diffusion. Son prix plus élevé que celui d'une Jaguar XJ 12 à la mécanique autrement plus noble est un autre obstacle.
Moins d'une dizaine d'exemplaires de la De Tomaso Deauville sont vendus en France, sur les 244 Deauville produites jusqu'en 1988. Copyright 1971 Au Salon de Turin qui s'ouvre le 3 novembre 1971, Alejandro De Tomaso présente la 1600 Spider, une voiture dotée d'un quatre cylindres Ford de 1,6 litre, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la future Fiat X 1/9 en cours d'étude chez Bertone, et que Fiat s'apprête à commercialiser. L'affaire fait scandale et la presse surtout étrangère s'en empare. Une affaire d'espionnage industriel ? Réponse ici !
De Tomaso 1600 Spider par Ghia. Une partie du toit est amovible, et peut être rangée sous le couvercle du coffre avant. Le moteur 4 cylindres 1 599 cm3 retravaillé chez De Tomaso est emprunté à la Ford Escort. Copyright 1971 Le deuxième projet sur lequel a travaillé Tom Tjaarda lors de son retour chez Ghia a été celui d'un break de chasse Isuzu Bellett. Le prototype étudié en 1968 n'est curieusement présenté au public japonais qu'au Salon de Tokyo 1971, dans une teinte violette métallisée. On ignore pourquoi Isuzu a attendu si longtemps. Le dessin surprend avec sa ligne de caisse droite qui dévie brusquement vers le haut, sous forme d'une autre ligne droite pour rejoindre la partie la plus en arrière de la ligne de toit. L'arrière de type Kammback est dominé par un large hayon en verre.
Avec la Bellett Sport Wagon, Isuzu a surtout voulu attirer le regard du public avec un objet à la mode, sans véritablement envisager la moindre production. Copyright 1971 De Tomaso produit en série la Pantera, et s'apprête à lancer la Deauville. Après la Simun demeurée sans suite, l'industriel souhaite compléter son offre avec un nouveau coupé, et demande à Tom Tjaarda de s'inspirer de la Maserati Ghibli dessinée par Giugiaro, qui remporte un joli succès. Ainsi apparaît la Zonda qui s'appuie sur un châssis de Deauville raccourci de 22 centimètres, dont elle reprend le V8. Elle se veut aussi performante qu'une Ferrari ou une Maserati, moyennant un prix plus raisonnable. Le nom de Zonda fait référence au vent sec qui souffle sur le versant oriental des Andes en Argentine. Accessoirement, il répond à celui de Ghibli, un vent des déserts libyens. La Zonda est présentée au Salon de Genève 1971.
La Zonda est présentée dans une teinte bronze métallisée au Salon de Genève en mars 1971. Copyright Sa naissance est pourtant éclipsée par deux autres nouveautés majeures, la Lamborghini Countach de Marcello Gandini et la Maserati Bora de Giorgetto Giugiaro. La Zonda est ensuite présentée à Détroit en avril 1971, hélas dans une certaine indifférence. De Tomaso aimerait embarquer dans la même aventure américaine la Pantera et la Zonda. Sa présence à Détroit est surtout destinée aux décideurs de Ford. Mais la Zonda s'annonce trop coûteuse à produire. De nouveau, le projet est abandonné, et toute trace du prototype est perdue.
La De Tomaso Zonda présentée en 1971 est en quelque sorte la Maserati Ghibli de la marque De Tomaso, mais ce modèle dessiné par Tom Tjaarda ne sera pas commercialisé, étant remplacé de facto par un coupé d’allure plus classique, la Longchamp. Copyright 1972 Pour diversifier son offre, De Tomaso sollicite Tom Tjaarda pour l'étude d'un coupé 2 + 2 dérivé de la berline Deauville. Comme la Pantera, cela aurait pu être un projet à destination de Ford. Mais la Longchamp, puisque tel est son nom, ne sera diffusée que par le biais des distributeurs De Tomaso. Ford a compris la leçon après les déboires rencontrés avec la Pantera. Le constructeur US comprend qu'il est peut-être intéressant d'intégrer Ghia, mais il est plus prudent de laisser De Tomaso poursuivre seul son aventure industrielle. Notre homme aime le prestige lié à l'image de la France. Après la Deauville, sa nouvelle automobile fait de nouveau référence à un célèbre hippodrome.
La De Tomaso Longchamp lancée en 1972 est un coupé classique dessiné par Tom Tjaarda, dérivé techniquement de la berline Deauville. Curieusement, elle va donner naissance en 1976 à la Maserati Kyalami, avec quelques modifications signées Pietro Frua. La marque Maserati a en effet été rachetée par De Tomaso en 1975. Copyright De Tomaso a de grandes ambitions. En effet, il achète successivement Benelli (1970), Moto Guzzi (1972), Maserati (1975) et Innocenti (1976). La Longchamp n'est finalement qu'une des composantes du groupe industriel de De Tomaso. La Longchamp est présentée au Salon de Turin 1972. Tom Tjaarda a imaginé un coupé sans excès tapageur, comme une bonne machine que l'on viendrait presque à désirer plus par raison que par passion. Son V8 Ford dispose de 330 ch. La production en petite série va s'échelonner de 1973 à 1989. 395 coupés et 14 cabriolets seront produits. En 1973, Ford devient l'unique propriétaire de Ghia. L'activité du carrossier est désormais frappée du sceau de la marque américaine. Le rôle de Ghia reste toutefois de créer de nouveaux véhicules de tous types pour Ford. Certaines idées sont reprises sur des modèles de série. Ghia devient plus connu du grand public pour les modèles Ford à la finition luxueuse auxquels son nom est associé, même s'il n'en assure nullement la production.
Texte : Jean-Michel Prillieux / André Le Roux |