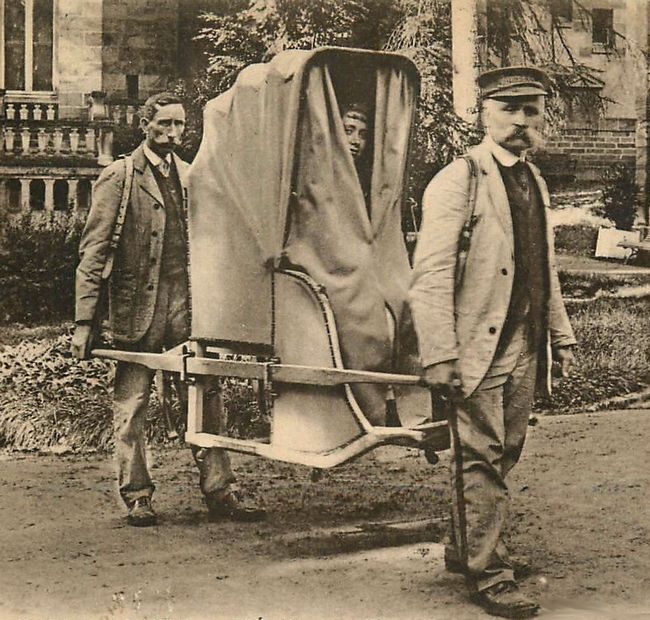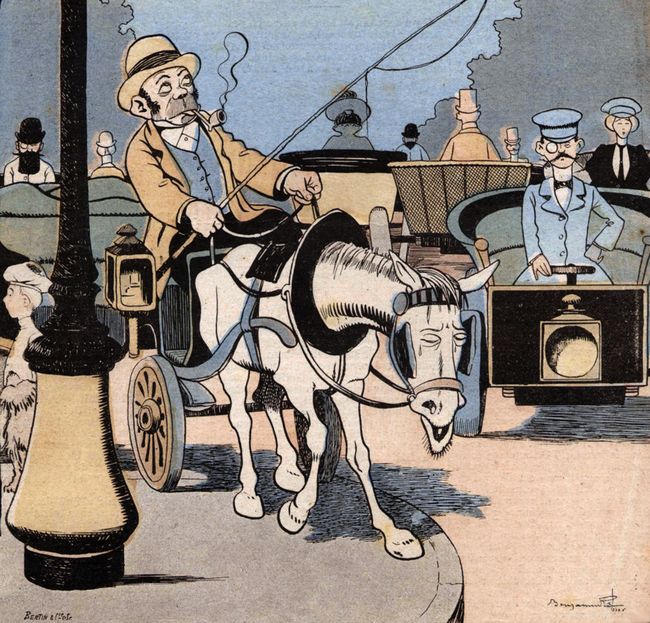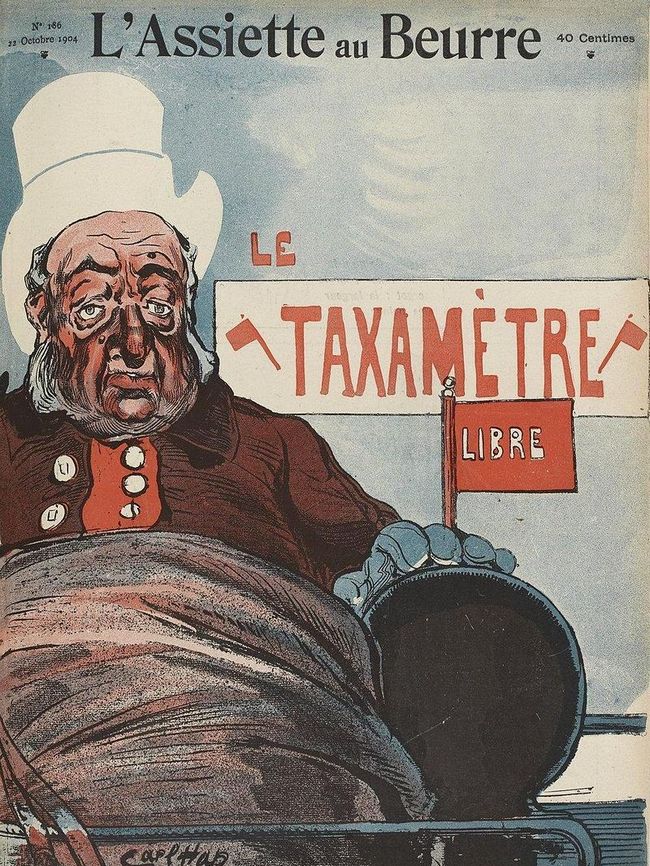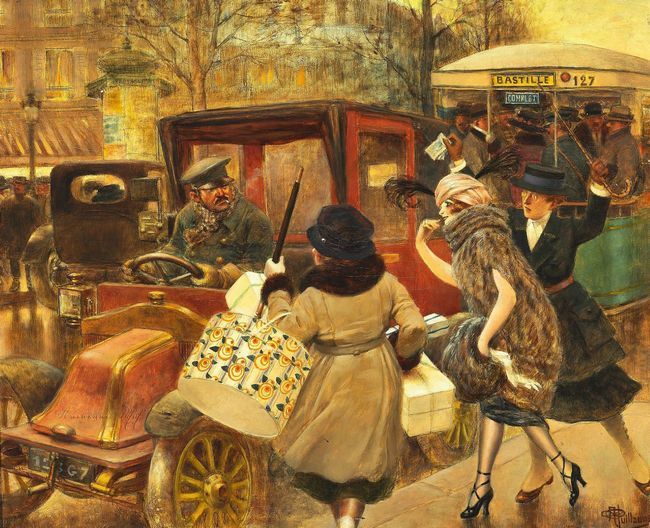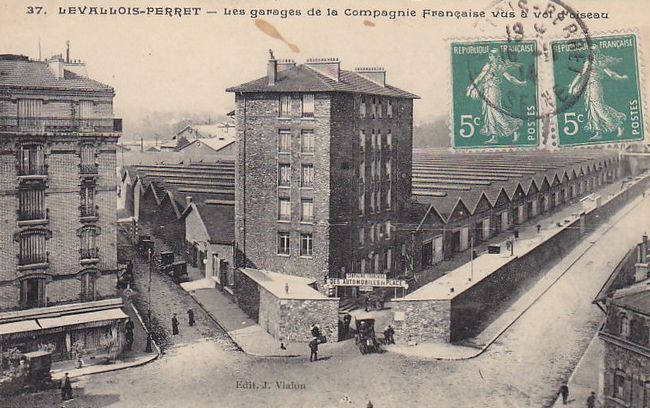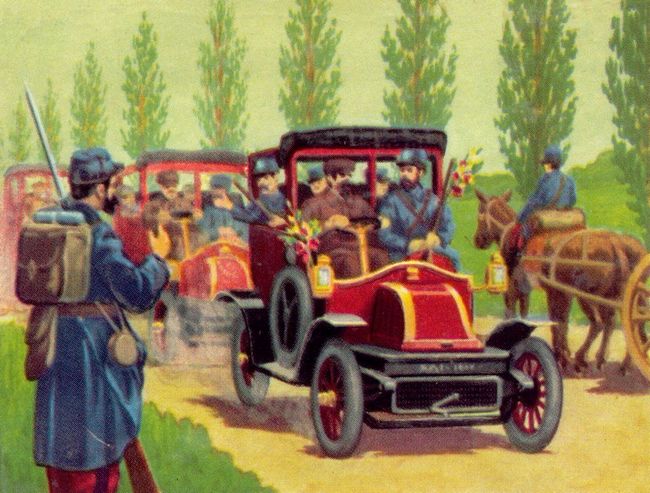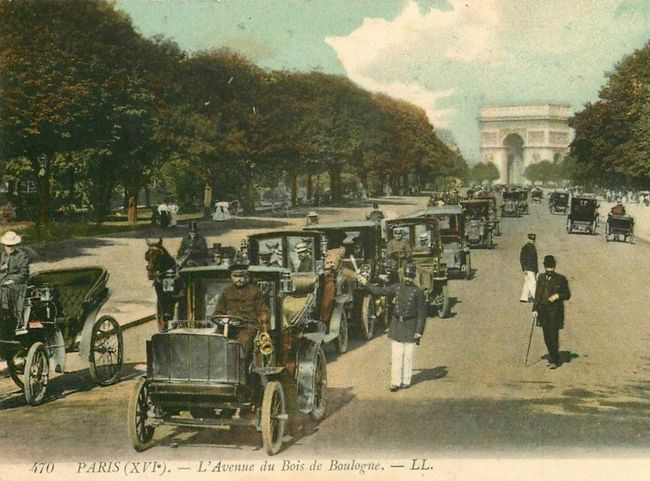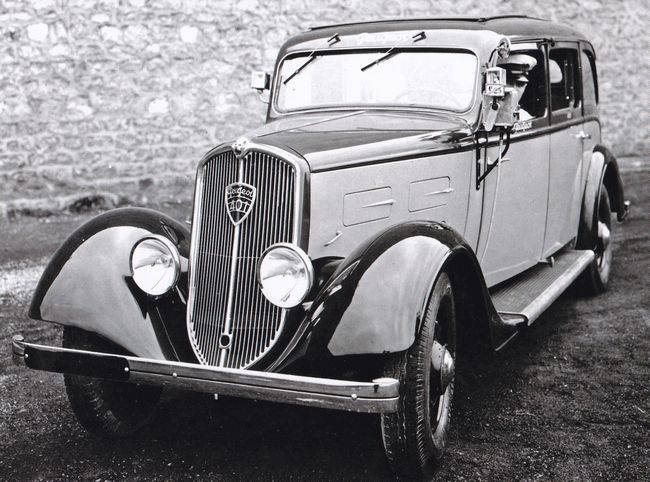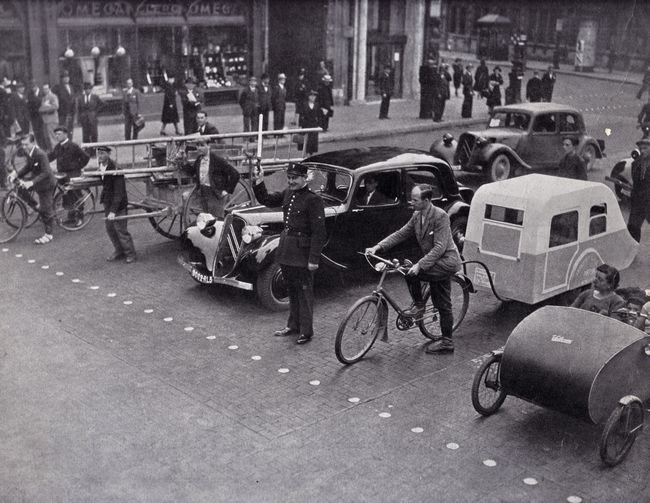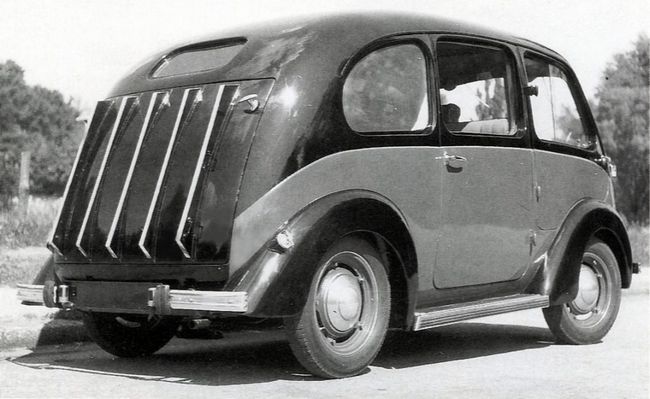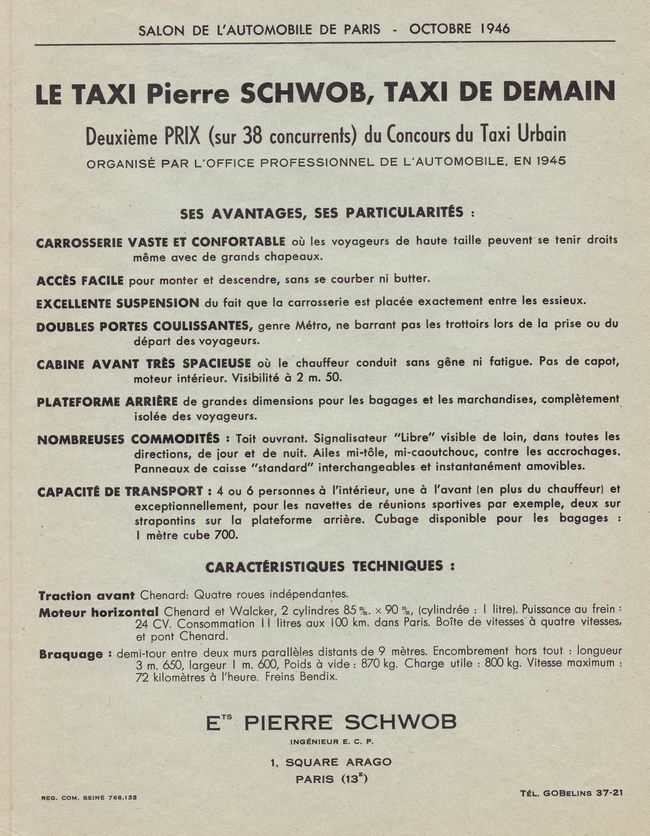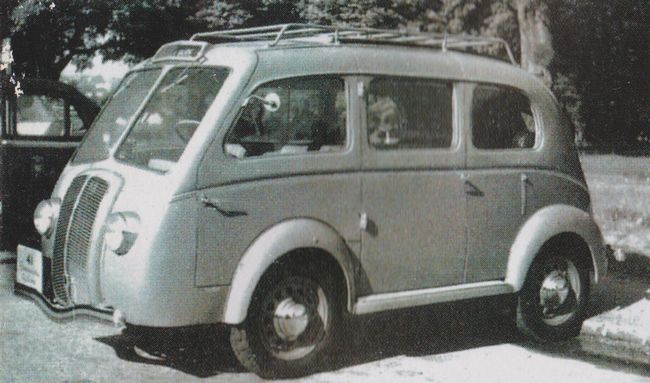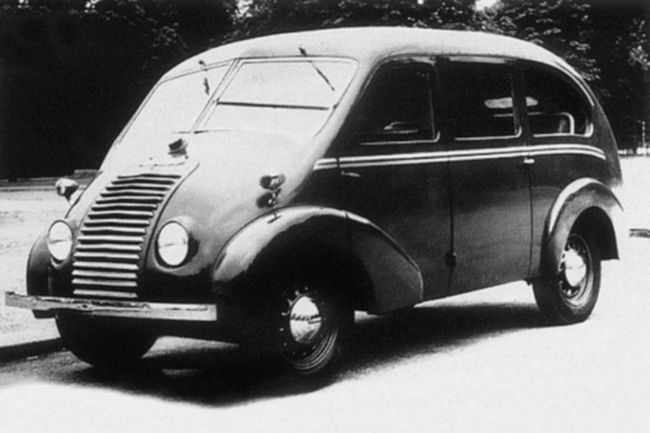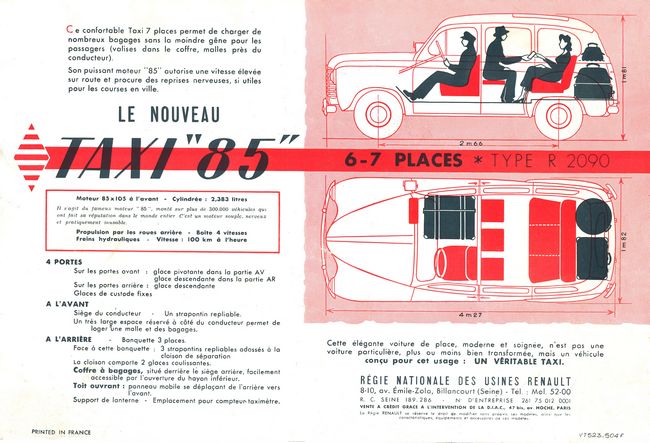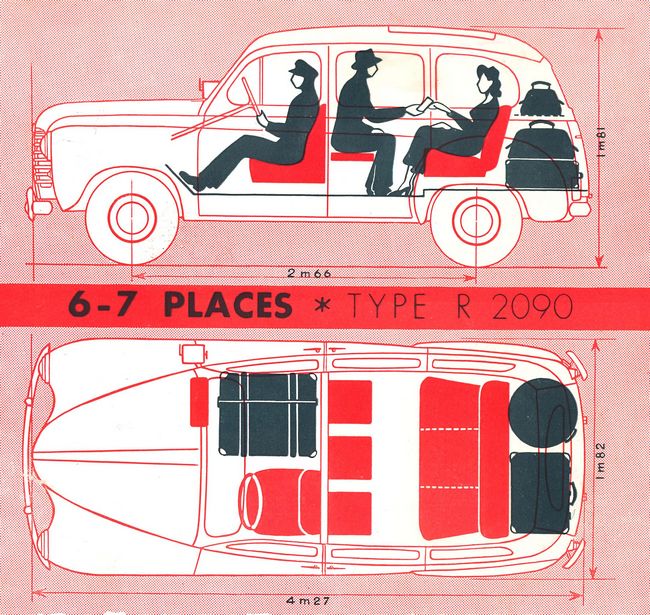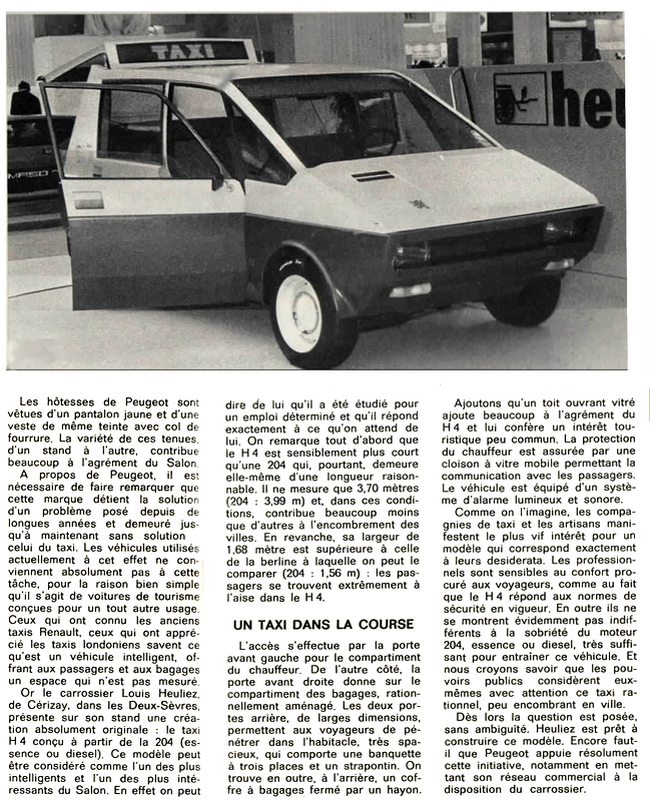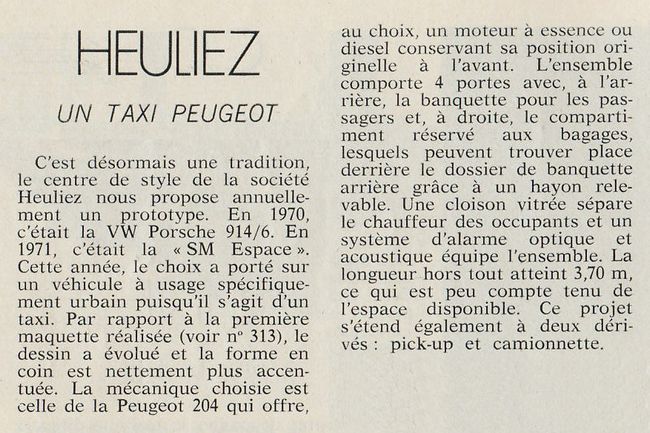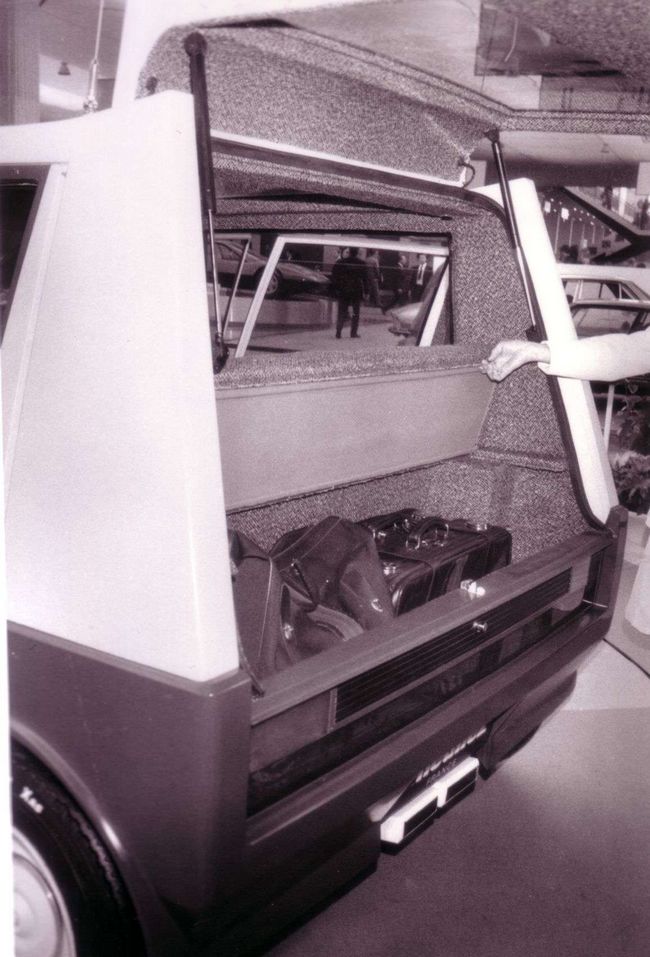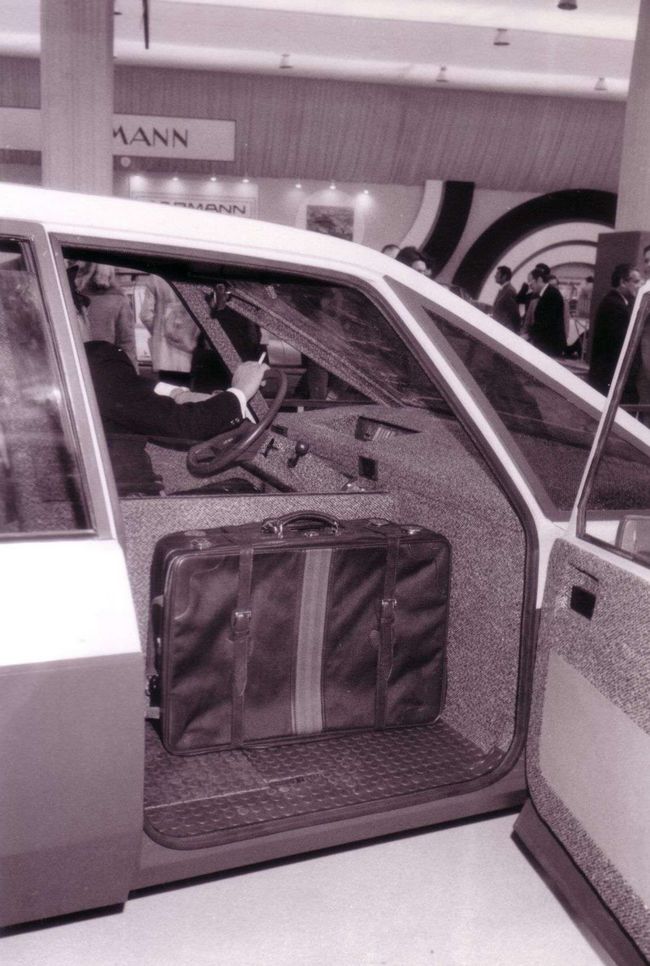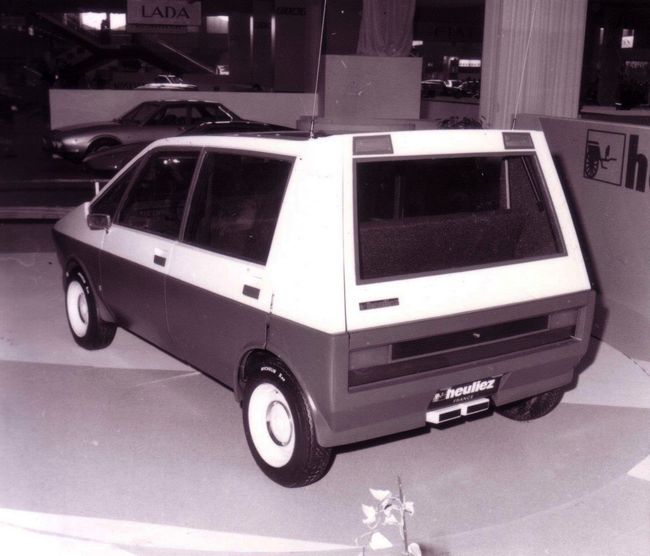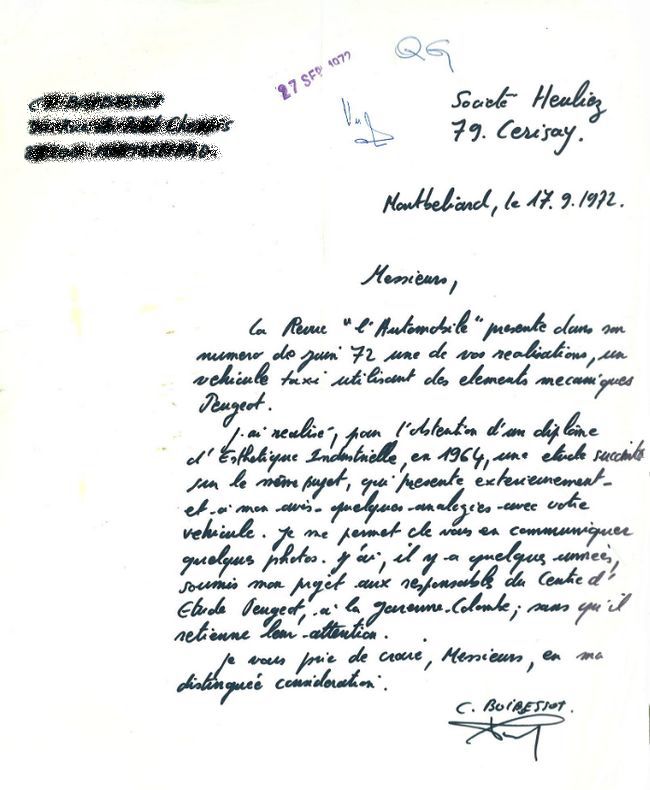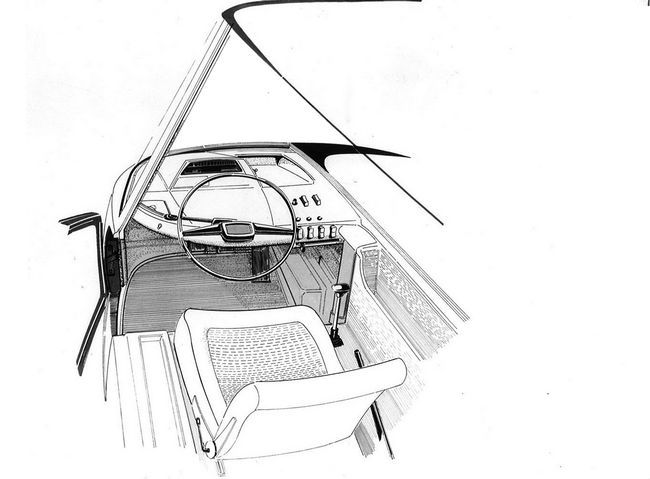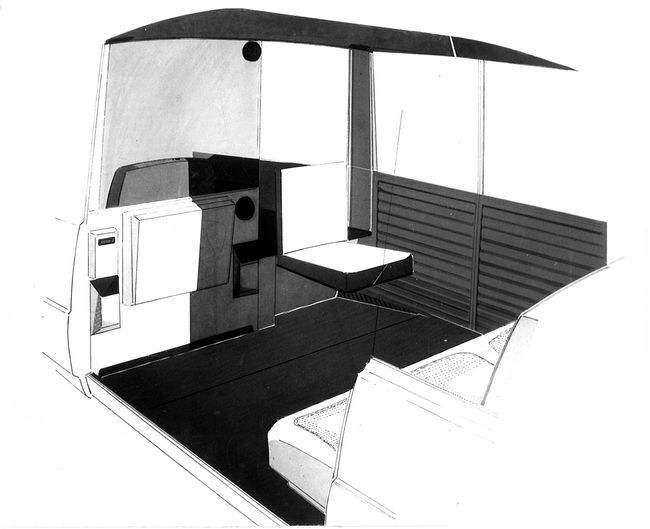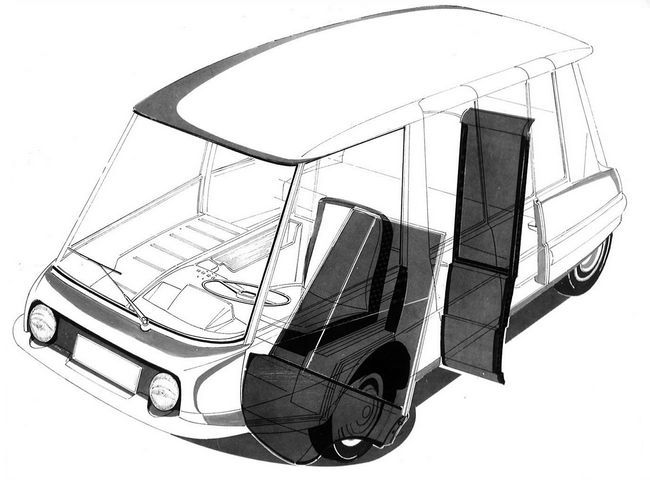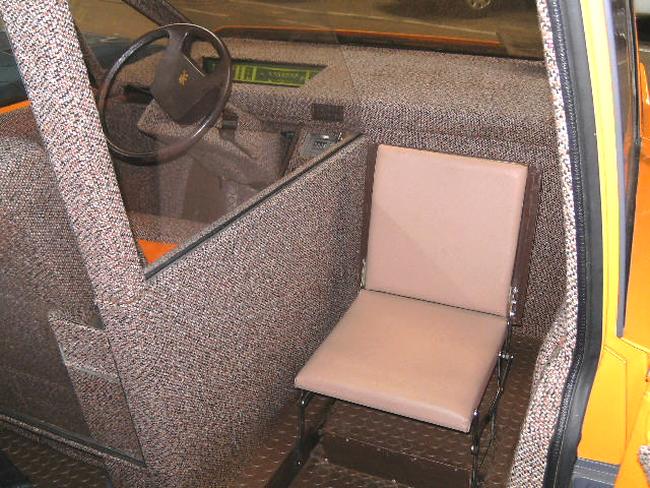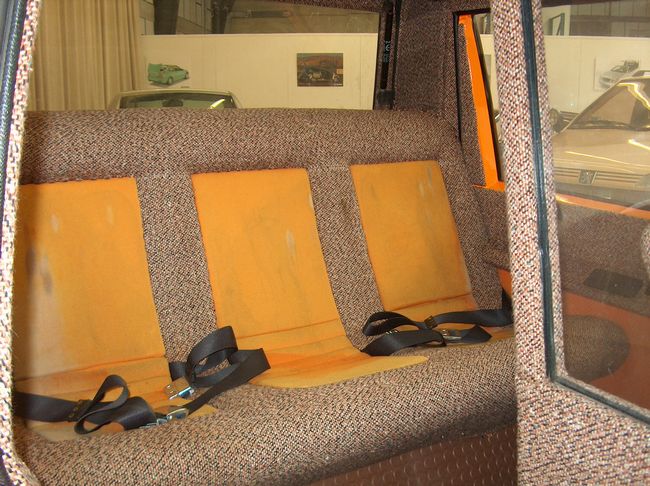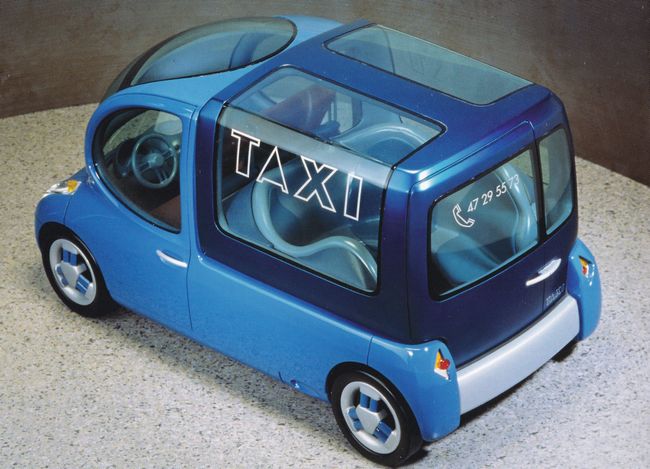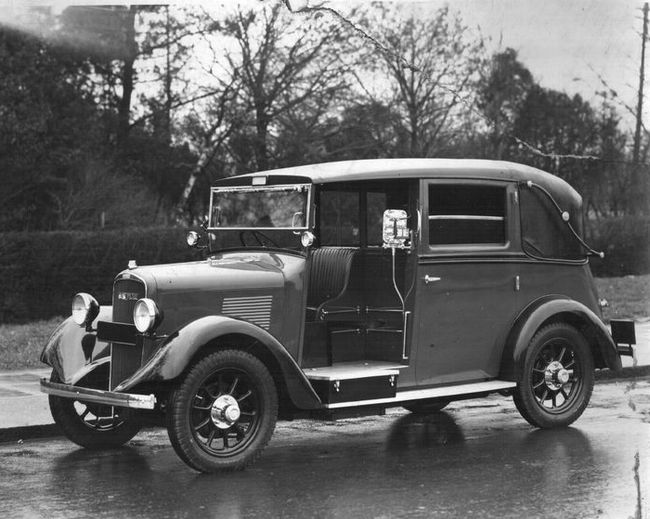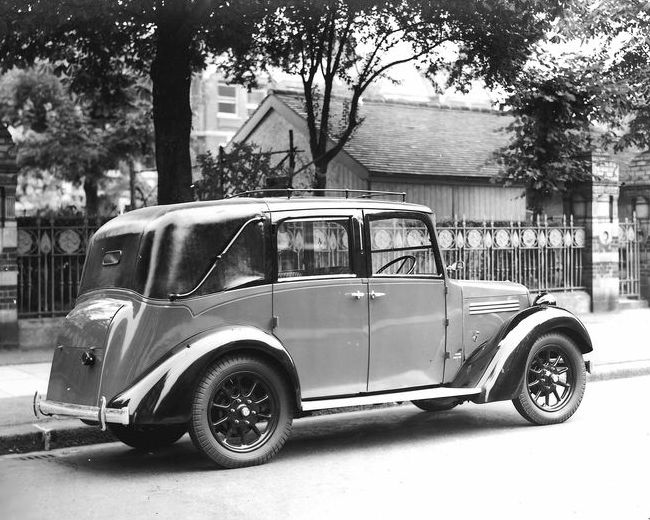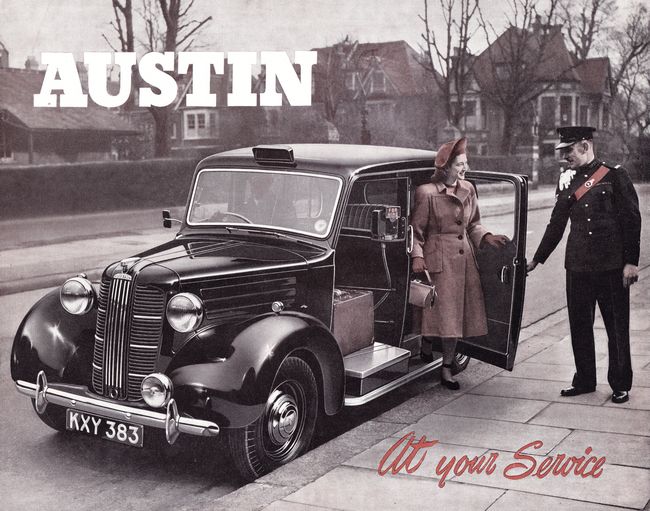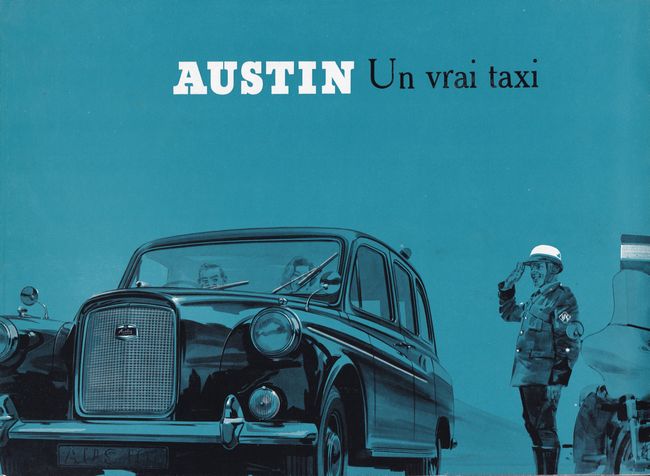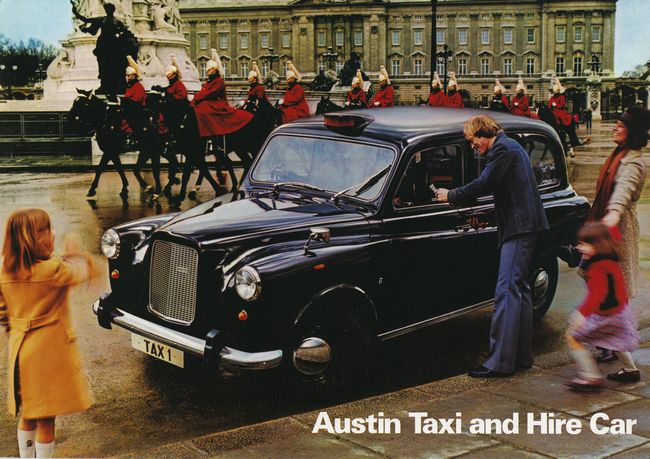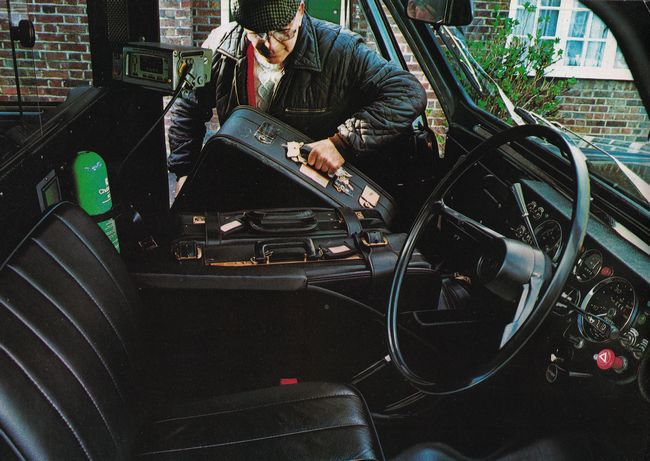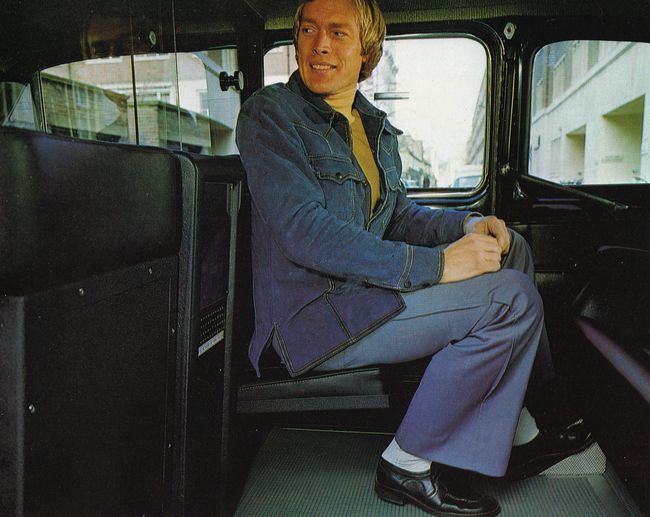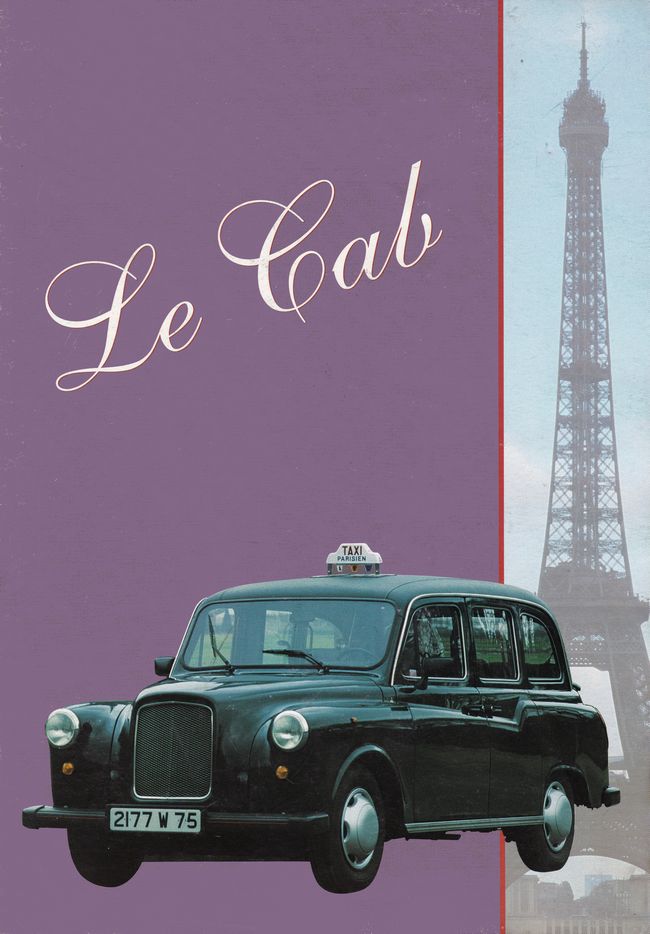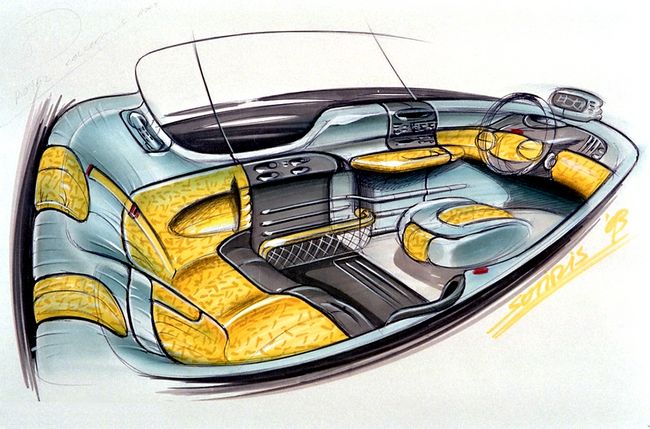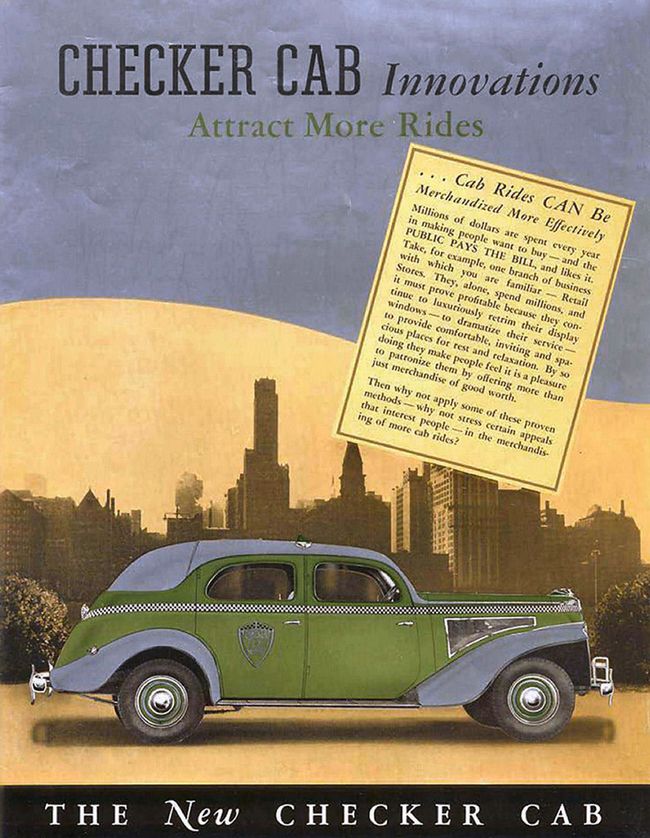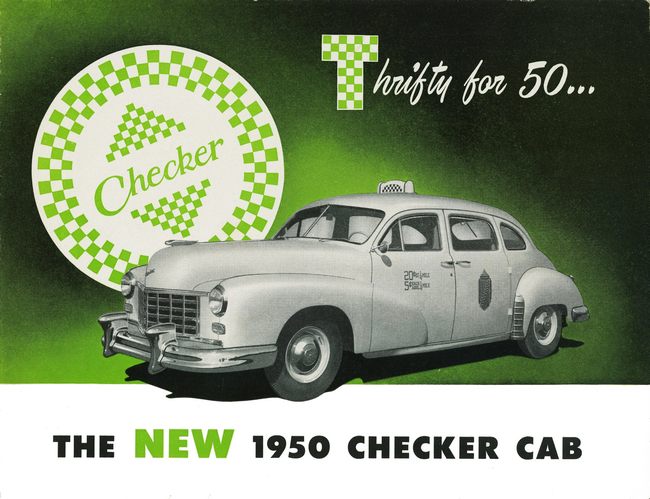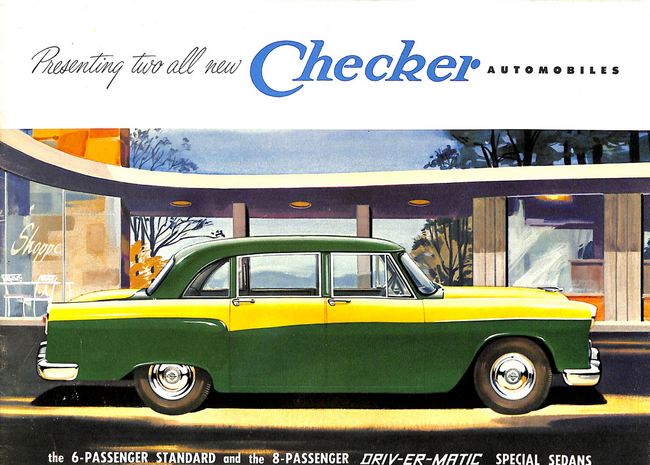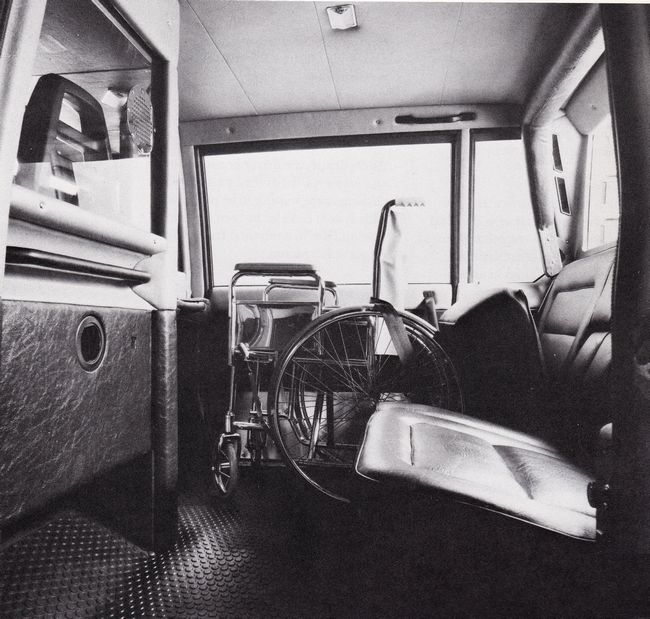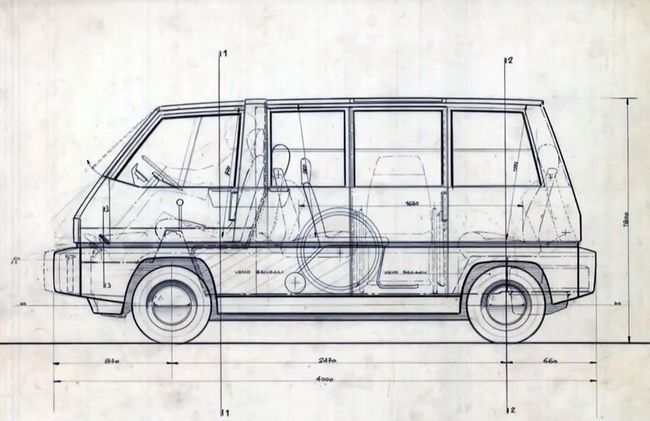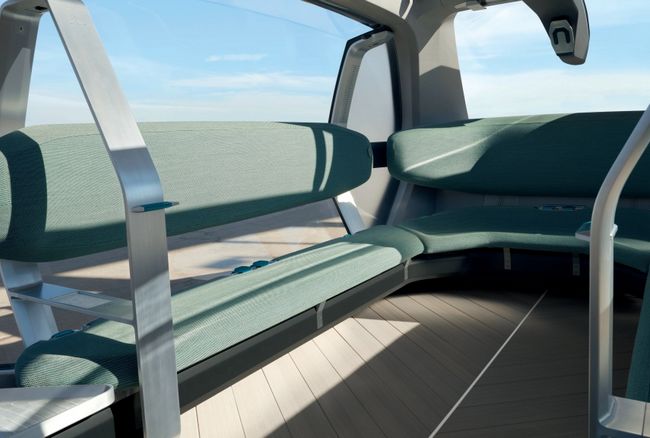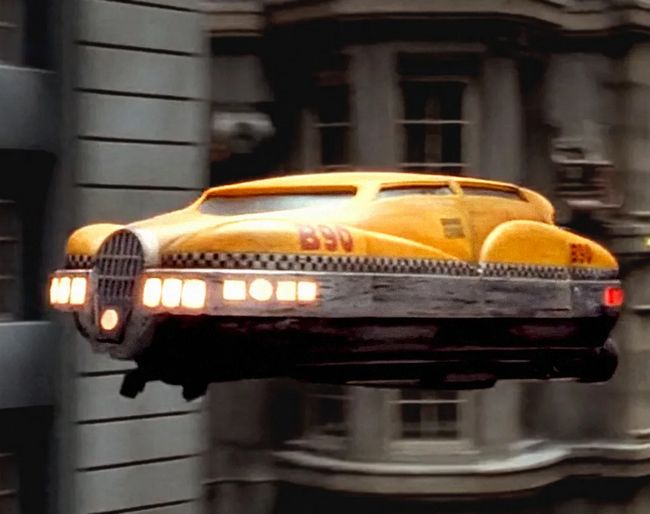|
Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. Ce document, fruit d'un travail de rédaction entamé en 2020, devait initialement célébrer le 50e anniversaire du taxi Heuliez H4 en 2022. L'importance accordée ici à ce prototype s'explique par cet objectif commémoratif. Toutefois, des contraintes de calendrier ont retardé sa publication. Je vous présente ici une version en ligne, diffusée avec un décalage de trois ans. Ce contenu se concentre exclusivement sur les automobiles conçues spécifiquement pour le service de taxi. Je vous souhaite une agréable lecture. L'histoire des taxis est un voyage fascinant à travers le monde, chaque pays ayant sa propre interprétation de ce service de transport essentiel. Des tuk-tuks thaïlandais aux Jeepneys philippins, en passant par les Coccinelles sud-américains, les taxis ouverts de Capri, les Checker new-yorkais, les Austin FX4 londoniens et les Peugeot 504 parisiennes, chaque modèle raconte une histoire unique. Le mot " taxi " vient de l'allemand " taxameter ", système inventé par Friedrich Wilhelm Gustav Bruhn en 1890, qui permet de mesurer le temps et la distance. Ce terme a évolué en français, passant de " taxamètre " à " taximètre ", puis " taxi ". Les Anglais ont adopté le terme " taxicab ", combinant l'idée de taxi avec le surnom donné aux fiacres. En 1909, un taxi est officiellement défini comme " un véhicule automobile de location, muni d'un taximètre, détenteur d'une autorisation administrative l'autorisant à stationner sur la voie publique en vue d'y charger des clients ". Cette exploration des taxis à travers le monde est loin d'être exhaustive. Il existe une multitude de modèles conçus spécifiquement pour cet usage, chacun ayant sa propre histoire et ses particularités. Des concours ont parfois été organisés pour encourager l'innovation dans ce domaine, mais la plupart des projets ont vu le jour de manière isolée, répondant à des besoins spécifiques et à des contextes locaux. Cette page se veut être une introduction à l'histoire des taxis, un aperçu des différents modèles qui ont marqué leur époque. Vous noterez un chapitre particulièrement complet sur le taxi Heuliez H4, qui a été le sujet déclencheur de cet dossier. Vos commentaires et corrections sont les bienvenus pour enrichir cette exploration et corriger d'éventuelles imprécisions ou erreurs. De la chaise à porteur à l'automobile Il est impossible de dater précisément l'apparition du premier taxi. L'être humain a très vite compris l'intérêt du transport payant de personnes. Les origines du taxi se perdent dans le temps et l'espace. Même si nous n'en avons pas de preuves concrètes, il est fort probable que des services similaires existaient déjà dans l'Antiquité, chez les Incas, les Romains ou les Égyptiens. Les premières représentations graphiques connues sont celles de chaises à porteurs ou de véhicules tirés par des animaux.
La chaise à porteurs, ancêtre du taxi, est un moyen de transport individuel qui a connu son heure de gloire, notamment auprès des classes sociales les plus aisées. Il s'agit d'une sorte de cabine, souvent richement décorée, équipée de brancards et portée à bras d'hommes. Ce moyen de transport urbain, pratique et peu encombrant, permettait de se déplacer confortablement en position assise, avec simplement deux porteurs. En France, le premier service de location de chaises à porteurs a été officiellement enregistré en 1617. Ce type de transport a ensuite connu un essor important, avant de disparaître progressivement avec l'arrivée des premiers véhicules automobiles. Copyright Sous le règne de Louis XIV, en 1637, apparaissent les premiers fiacres, ancêtres des taxis que nous connaissons aujourd'hui. Il s'agit de voitures fermées tirées par des chevaux et conduites par un cocher. Ces fiacres sont à la disposition des voyageurs, soit en les hélant dans la rue, soit dans des stations spécialement aménagées. Chaque voiture est identifiable grâce à une plaque distinctive, et les cochers sont responsables de l'entretien et de la propreté de leurs véhicules. Cette initiative marque une étape importante dans l'organisation du transport de personnes, offrant une alternative plus confortable et pratique aux chaises à porteurs. Les fiacres ont rapidement connu un grand succès et ont contribué à structurer le paysage urbain de l'époque.
La vinaigrette est l'autre nom donné à la chaise à porteur. Celle-ci est toutefois équipée de roues. Inventée au début du 17ème siècle, elle doit sa dénomination à sa ressemblance avec les petites voitures des vinaigriers. Copyright En 1666, les autorités tentent de réguler les prix, qui deviennent fonction du temps passé. Cela reste un moyen de transport réservé à une minorité aisée. Malheureusement, les fiacres souffrent d'une mauvaise réputation en raison du manque de savoir-vivre des cochers, des nombreux accidents et du mauvais entretien des véhicules. Pour remédier à cette situation, Louis XVI (1754-1793) décide de confier la gestion des fiacres à son administration, par le biais d'une délégation de service public. La Révolution de 1789 bouleverse ce système. Face à l'anarchie ambiante, l'État s'efforce, tout au long du 19ème siècle, d'imposer de nouvelles règles concernant le matériel, la tenue des cochers, les tarifs, etc. Il délègue le contrôle de ces règles aux autorités locales, qui ont également le pouvoir de modifier les quotas de fiacres. De nombreux cochers, découragés, abandonnent la profession. À Paris, le tissu urbain se développe. Dans une ville où la circulation est déjà difficile, la situation devient encore plus chaotique, d'autant plus que d'immenses travaux sont en cours pour réaménager la ville, sous la direction du baron Haussmann (1809-1891). En 1877, l'exercice de la profession de cocher est soumis à l'obtention d'un certificat de capacité professionnelle, qui nécessite de passer un examen de " remisage ".
En 1881, les fiacres de la CGV (Compagnie Générale des Voitures) représentent plus de la moitié des voitures de place circulant dans Paris. La compagnie possède aux alentours de 11 600 chevaux et plus 6 500 voitures, et emploie plus de 6 000 salariés. Source : https://www.attelage-patrimoine.com Dans les années 1890, les premiers fiacres automobiles électriques font leur apparition dans les rues de New York, Londres et Berlin. Puis, en avril 1899, à Paris, la Compagnie Générale des Voitures lance l'exploitation régulière de ce type de véhicules. Cette avancée technologique marque le début d'une transition pour les cochers, qui abandonnent progressivement les chevaux au profit des voitures à moteur électrique, une transition souvent accompagnée d'une formation professionnelle prise en charge par leurs employeurs.
Au tournant du siècle, la traction animale et la traction automobile tentent encore de faire bon ménage, cette illustration de Benjamin Rabier fait la part belle à l'automobile, conduite par un élégant mécanicien très stylé, en passe de déloger le cheval, d'une époque bientôt totalement révolue, émetteur du crottin qui souille la chaussée ... Copyright En France, il faut attendre 1890 pour qu'un tarif kilométrique obligatoire soit instauré pour les automobiles. La profession se structure, et les chauffeurs, qui dépendent des grandes compagnies et qui ont le sentiment d'une certaine prolétarisation de leur métier, commencent à exprimer leur mécontentement. Cela se traduit notamment par une grève de plus de quatre mois qui débute le 28 novembre 1911, et dont l'issue sera plus favorable aux grandes compagnies qu'aux chauffeurs.
Louis Kriéger, pionnier de l'automobile électrique, a marqué son époque avec des créations innovantes dès 1897. Ses voitures électriques ont d'abord connu un succès retentissant, tant en France qu'à l'étranger, grâce à une série de brevets portant sur l'utilisation de l'énergie électrique pour la propulsion des véhicules. Cependant, malgré cette percée prometteuse, l'entreprise Kriéger n'a pas su anticiper le changement de cap de l'industrie automobile. Le choix du moteur à explosion au détriment de l'électricité, plus contraignant et moins économique à l'usage, a été fatal à l'entreprise. Kriéger a dû cesser ses activités en 1909. Copyright L'énergie électrique, qui semblait promise à un bel avenir dans les villes, n'a finalement pas connu le succès escompté auprès des propriétaires de voitures particulières et des compagnies de taxis. Ces derniers ont préféré se tourner vers les moteurs à essence, jugés plus pratiques et plus économiques à l'usage. En effet, les batteries électriques de l'époque n'étaient pas encore suffisamment performantes, ce qui a conduit à l'abandon de la plupart des fiacres électriques au début du XXe siècle.
En , le magazine satirique l'Assiette au beurre ironise sur les taxamètres qui mécontente les usagers et les chauffeurs de fiacre automobile. Le mot " taxi " seul se glisse peu à peu dans le langage : en France, il devient courant dans les années 1910, notamment après l'opération des taxis de la Marne. Copyright A lire une intéressante étude parue dans Omnia en
1908 : Les taxis Renault de 1904 à 1914 En 1904 une trentaine de fiacres électrique de marque Jeanteau ou Krieger circulent à Paris. Ils rentrent régulièrement au dépôt pour changer de batterie. On croise aussi des véhicules à pétrole, à moteur de Dion, dont la fiabilité reste perfectible.
Mme Decourcelle, une femme en avance sur son temps, a obtenu son diplôme de "chauffeuse" de taxi le 23 février 1907. Cette ancienne cochère est devenue la première femme de l'histoire à conduire un taxi dans les rues de Paris, une profession alors dominée par les hommes. Copyright Au début du XXe siècle, Paris aspire à un service de taxis plus fiable et pratique. Pour répondre à ce besoin, André Walewski, un industriel influent, fonde la Compagnie Française des Automobiles de Place le 4 mars 1905, avec le soutien financier du baron Rognat et de la banque Mirabaud. Walewski, membre de nombreux conseils d'administration dans les secteurs de l'industrie, des mines, de l'énergie et des transports, est également un passionné d'automobile et d'aviation, titulaire du permis de conduire depuis 1890, le numéro 30. La Compagnie Française des Automobiles de Place lance un appel d'offres pour la conception et la fourniture de 1 500 taxis standardisés. Le cahier des charges est rigoureux : les véhicules doivent être d'une grande simplicité d'entretien, afin de pouvoir être conduits par des cochers de fiacre ayant des connaissances mécaniques limitées. Ils doivent également être silencieux, et offrir aux passagers la possibilité de profiter du soleil tout en étant protégés des intempéries. Louis Renault, qui dirige la Société Renault Frères depuis la disparition de son frère Marcel en 1903, répond à cet appel d'offres. Il conçoit le modèle AG, un véhicule à la mécanique accessible et facile à entretenir. Équipé d'un moteur bicylindre de 8 chevaux, surnommé " deux pattes ", ce taxi peut atteindre une vitesse de 40 km/h. Ce modèle deviendra plus tard célèbre pour sa participation à la première guerre mondiale.
Taxi parisien de la compagnie G7, véhicule Renault type AG. Copyright Les Renault AG se distinguent par leur standardisation : toutes les pièces sont identiques et interchangeables, une innovation majeure pour l'époque. La conception mécanique est simplifiée pour réduire les coûts, assurer la robustesse et faciliter l'entretien. La carrosserie de type landaulet permet aux passagers de profiter du soleil, tandis que le chauffeur est protégé par un simple auvent en toile repliable.
Taxi parisien de la compagnie G7, véhicule Renault type AG. Copyright Après une année d'essais concluants dans les rues de Paris et des tests comparatifs avec d'autres marques, Louis Renault reçoit en 1905 une première commande de 250 taxis. Ces véhicules se caractérisent par leur caisse rouge, leur toit noir et leurs roues et capot jaunes. La commande est rapidement portée à 1 500 exemplaires en 1906, puis à 2 100 en 1907. L'administration attribue l'immatriculation G7 aux taxis Renault de la Compagnie Française des Automobiles de Place. Cette immatriculation distinctive devient rapidement le surnom populaire de ces taxis rouges, qui sont désormais connus du public sous le nom de G7.
Dépôt de la Compagnie Française des Automobiles de Place à Levallois-Perret. André Walewski lance cette compagnie aussi appelée " Autoplace" " ou " Taxis G7 ", le 4 mars 1905. Il la dirige jusqu’à son décès, le 5 février 1954. Pendant la Première Guerre mondiale, André Walewski va participer à la mise en place de la stratégie des Taxis de la Marne. Copyright
Source : https://www.cparama.com. Au même endroit à Levallois-Perret, un groupe de chauffeurs de la G7 assure la pose. Copyright
Carte postale d'un taxi Renault de la compagnie G7. Copyright L'engouement pour le Renault AG s'étend rapidement au-delà de Paris. Renault conclut des ventes importantes à l'étranger, avec 2 100 taxis livrés à la British Motor Cab de Londres, 1 000 à New York et 275 à Buenos Aires. Sur le marché français, la Compagnie Générale des Voitures acquiert 2 500 exemplaires, et sept autres compagnies de taxis totalisent 1 300 commandes.En seulement trois ans, Renault produit un total de 9 000 taxis de type AG. Ce modèle, rendu abordable par sa production en série, représente plus d'un tiers de la production de Renault Frères. Ces commandes massives contribuent grandement au succès et à l'expansion des usines de Billancourt.
Le Renault AG avec son moteur deux cylindres est surnommé le " deux pattes ". C'est un 1 060 cm3 qui entraîne le véhicule jusqu'à 40 km/h. Il s'agit ici d'un modèle de la Compagnie Générale des Voitures, et l'administration leur a réserve l'immatriculation G3. Copyright Le Renault AG évolue avec son temps, suivant la tendance générale à l'augmentation de la puissance dans l'industrie automobile. À la fin de 1907, le modèle AG-1 est introduit, une version améliorée de l'AG. Son moteur bicylindre, surnommé " deux pattes ", passe à 1 205 cm³, ce qui se traduit par une légère amélioration des performances. À la veille de la Première Guerre mondiale, Paris compte environ 10 000 taxis, dont environ 85 % de Renault AG et AG-1. Le modèle AG-1 est produit jusqu'en 1921. La présence massive de ces taxis dans les rues de la capitale constitue une publicité exceptionnelle pour Renault, renforçant la notoriété de la marque. En septembre 1914, alors que les Allemands menacent Paris d'encerclement, le caporal Louis Breguet, grâce à une reconnaissance aérienne, alerte le général Gallieni d'un changement de direction des troupes allemandes, les situant au sud de la Marne. Face à l'urgence et à l'indécision des hautes instances militaires, Gallieni, gouverneur militaire de Paris, décide de transporter ses troupes par train, mais deux incidents ferroviaires compromettent cette opération. Pour pallier ces difficultés et acheminer rapidement des renforts, Gallieni réquisitionne, dès le 6 septembre 1914, les taxis parisiens, une idée qui lui aurait été soufflée par la comédienne Sarah Bernhardt lors d'un dîner, marquant ainsi le début de l'épisode légendaire des " taxis de la Marne ".
L'esplanade des Invalides est le lieu de rassemblement des taxis de la Marne. Durant leur voyage, par souci de discrétion, les chauffeurs ont pour consigne de suivre le taxi précédent, avec pour seul éclairage celui des lanternes arrière. Aucun chauffeur ne sera blessé, mais quelques voitures reviendront avec des impacts de balles. Copyright Le 6 septembre 1914, à 22 heures, 600 taxis, principalement des Renault AG mais aussi des De Dion et Clément-Bayard, quittent l'esplanade des Invalides à Paris et se rassemblent à Gagny et Livry-Gargan pour embarquer les soldats, transportant cinq hommes par véhicule, une première expérience automobile pour beaucoup, en direction de Nanteuil-le-Haudouin dans l'Oise ; le lendemain, un second convoi de 600 à 700 taxis traverse les grandes artères de la capitale pour rejoindre Meaux, marquant ainsi le début de l'épisode historique des " taxis de la Marne ".
Un des taxis qui permirent au Général Gallieni d'amener des renforts sur la Marne. Cette opération est menée en 48 heures dans le plus grand secret, et dans un temps record pour l'époque et dans l'histoire des mouvements de troupes sur le terrain militaire. Copyright L'épopée des Taxis de la Marne, immédiatement relayée et magnifiée, a rapidement pris une dimension légendaire après la repoussée des Allemands. Cette opération, sans précédent par son ampleur, a eu un impact psychologique considérable sur la population, devenant un symbole puissant d'unité et de solidarité nationale.
La victoire dans la Marne, puis celle de la guerre, font du Renault AG une fierté nationale. A une vitesse moyenne de 25 km/h, les chauffeurs mettent près de 4 heures pour conduire les soldats sur le Front, à 100 km de Paris. L'état français réglera d'ailleurs toutes les courses sans sourciller. Copyright A la fin du 19ème siècle, les investisseurs, initialement attirés par les fiacres électriques, se tournent vers les voitures à essence, jugées plus pratiques et économiques. La Compagnie Française des Automobiles de Place étend son influence à Londres en 1906. Face à un marché londonien naissant, avec seulement quelques compagnies exploitant un nombre limité de véhicules à moteur, la General Motor Cab Company Ltd, soutenue par des capitaux français, commande 500 " taxicabs " à Louis Renault.
La General Motor Cab Company Ltd, dont une partie importante des capitaux sont français, se fournit auprès de Louis Renault. Copyright Une campagne de dénigrement est lancée contre le taxi Renault, l'accusant de ne pas respecter certaines normes légales. Malgré ces attaques, la qualité indéniable des automobiles françaises prévaut. En 1911, les taxis londoniens sont majoritairement de fabrication française. On relève alors 650 Renault, 220 Unic, 50 Darracq ainsi que 7 autres marques ayant fourni chacune entre 1 et 17 châssis. Parallèlement, Georges Richard suit une trajectoire similaire à celle de Louis Renault, en fondant Unic en 1905 et en développant son entreprise grâce à la commercialisation de taxis. Ces véhicules connaissent également un grand succès à Londres. Même si la vente d'un taxi laisse à son fabricant une marge moindre par rapport à une automobile vendue à un particulier, la production en grande quantité de modèles similaires permet de réduire les coûts, et reste donc source de profit.
Les Britanniques ont goûté au silence et au confort des taxis Unic. Le constructeur se sert de ce succès sur les pavés londoniens pour promouvoir en France ses automobiles de tourisme. Copyright Les taxicabs doivent répondre à un cahier des charges déjà très exigeant : dimensions précises de l'habitacle, puissance de freinage, rayon de braquage, et nombre de points de détail qui participent au confort des passagers. Un espace est aménagé près du chauffeur afin de recevoir les bagages. La presse spécialisée française se montre assez critique envers ces exigences. Plus d'un siècle plus tard, force est de reconnaître qu'au regard du succès du FX4, de ses ascendants et descendants, les exigences britanniques étaient bien légitimes. Au début du 20e siècle, le taxi idéal doit être maniable par un conducteur novice, offrir un rayon de braquage court et résister à une utilisation intense. Son freinage doit être doux et simple, et son embrayage facile et progressif pour le confort des passagers. L'objectif est de simplifier la conduite, de prévenir les usages abusifs et de rendre le véhicule quasi indestructible. L'avenir du taxi reste incertain : conservera-t-il l'apparence des voitures de tourisme, ou deviendra-t-il un véhicule spécialisé ? Le confort du chauffeur, alors appelé automédon, n'est pas une priorité ; il reste exposé aux intempéries, surtout lorsqu'il est perché à l'arrière pour offrir une vue panoramique aux passagers.
A bord du taxi électrique de Jeanteaud présenté en 1898, le conducteur, s'il dispose d'une visibilité exceptionnelle, est par contre on ne peut plus exposé aux intempéries. Copyright Aucune grande marque ne peut se permettre d'ignorer cet immense marché des taxis en pleine effervescence. Une demande soutenue laisse entrevoir aux constructeurs et aux compagnies de taxis un avenir prometteur, source de profits. La récession qui touche l'automobile en 1907 et 1908 est mieux vécue par les constructeurs qui proposent un modèle de taxi dans leur gamme, qu'il s'agisse de Clément-Bayard, Unic, Delahaye, de Dion-Bouton, Chenard & Walcker, Panhard & Levassor, Darracq... Le marché des taxis se développe également dans les villes de province. Bordeaux et Nantes sont parmi les précurseurs. À l'étranger aussi, de grandes villes voient l'apparition de véritables réseaux, du Caire à Buenos Aires en passant par New York.
En 1923, le prototype d'un taxi très compact est présenté à la presse, il s'agit d'une Citroën 5HP où le conducteur est positionné derrière une cabine pouvant loger deux passagers, à l'image de certains fiacres du 19ème siècle. Cette idée n'aura cependant pas de suite, le coût de transformation, comparé au prix d'achat d'une 10 HP Taxi " de série " , étant bien trop élevé. Copyright La concurrence entre les nombreuses compagnies de taxis s'intensifie. Les tarifs ne sont pas uniformes ; bien qu'un tarif maximal soit imposé, il n'existe pas de tarif minimal. La plupart des professionnels considèrent toujours cette concurrence comme nécessaire et bénéfique pour les usagers. À Paris, le nombre de taxis automobiles passe de 300 en juillet 1906 à près de 1 700 un an plus tard. Le chauffeur automobile gagne mieux sa vie que le cocher, en multipliant les courses au cours d'une même journée. Les automobiles ne remplacent pas immédiatement les fiacres tirés par des chevaux, mais viennent s'y ajouter, ciblant une clientèle plus aisée et proposant des tarifs plus élevés. Cependant, au fil des ans, la traction animale cède du terrain à l'automobile. L'automobile présente de nombreux avantages : elle est moins encombrante dans les villes où la circulation s'intensifie et ne laisse pas de déchets sur les pavés.
Vers 1910, le cheval est encore présent dans les beaux quartiers de la capitale, même si le fiacre automobile a de plus en plus la faveur des classes aisées. Copyright
Une partie de campagne en taximètre vers 1908. La traction animale fait encore de la résistance. Copyright Afin de rendre l'automobile indéniablement plus attractive que la traction hippomobile, une réduction des coûts d'exploitation s'avère impérative. Ceci implique une simplification des mécaniques et des carrosseries, afin de diminuer la complexité de l'entretien et des réparations. Une diminution du poids des taxis, ainsi qu'une adaptation de leurs performances à leur fonction, sont également indispensables. Citroën, Renault, Peugeot et Simca Sur le marché des taxis, la période de l'entre-deux-guerres voit Renault et Citroën s'affronter. En février 1922, Citroën lance la 5 HP. Partout, elle rencontre un succès inouï, tant en France qu'à l'étranger. L'usine de Javel, désormais parfaitement rodée, la produit en masse, à des cadences inédites en Europe. Le revers de la médaille est que l'autre modèle Citroën, la 10 HP, première voiture de la marque apparue en 1919, se vend moins bien et que les stocks s'accumulent. Raoul Mattei, concessionnaire Citroën à Marseille, saisit l'opportunité. Il propose à André Citroën de transformer ces voitures en taxis verts à bande blanche et capote noire. Il s'engage à en acheter cent pour transporter les milliers de visiteurs attendus à l'Exposition Coloniale de Marseille en 1922. Dans la cité phocéenne, les "petits verts" remportent un immense succès. André Citroën, toujours prompt à saisir les occasions, décide de se lancer lui-même sur le marché du taxi, mais à plus grande échelle.
Les taxis Citroën du début des années 20 déclassent immédiatement tous les taxis antérieurs à 1914 encore en service. Ils passeront à la postérité grâce à leur élégante caisse cannée. Copyright À Paris, les vieux Renault AG et AG-1, fatigués par des années de service, circulent encore largement. Le 5 février 1924, André Citroën fonde la Société des taxis Citroën et habille ses conduites intérieures 10 HP d'un cannage jaune. C'est un triomphe. Les élégantes Parisiennes préfèrent les taxis Citroën aux vieux Renault, associés aux souvenirs de la guerre de 1914. Pour André Citroën, c'est aussi un excellent outil de communication, permettant à la clientèle de se familiariser avec les voitures de Javel et d'apprécier leur qualité. La gamme des taxis Citroën se développe tout au long des années 20, avec des modèles successifs tels que la B2, la B12, la B14 et la C4. En 1928, on estime à 5 000 le nombre de taxis aux doubles chevrons circulant à Paris, dont près de 40 % aux couleurs de la Compagnie des Taxis Citroën. C'est également une opération financière avantageuse pour André Citroën, qui vend ainsi un grand nombre de véhicules ... à lui-même, environ 6 700 jusqu'en 1935. Renault contre-attaque en lançant la 6 HP NN en 1924, avec un nouveau capot à angles vifs remplaçant l'ancienne "pelle à charbon", mais sans succès.
Renault tente de contre-attaquer l'hégémonie de Citroën en proposant en 1924 la 6 HP NN. Le constructeur de Billancourt a revu le dessin de ses capots avant, qui paraissait immuable depuis le début du siècle, modernisant ainsi la silhouette de ses automobiles. Copyright En 1931, Citroën domine le marché des taxis parisiens, représentant environ 60 % des 20 000 véhicules en circulation. Les taxis Citroën sont appréciés tant par les propriétaires et conducteurs que par les passagers. On n'imagine pas Citroën perdre ce marché. Cependant, la crise économique de 1931, survenant avec deux ans de décalage par rapport à l'Amérique, bouleverse cette situation. Louis Renault, cherchant à compenser la baisse des ventes de voitures particulières, revient en force sur ce marché, qu'il avait dominé de 1905 à 1922. En 1933, Renault lance le taxi KZ 11, dérivé de la Vivaquatre, dont il reprend le 4 cylindres 2 120 cm3 et l'empattement de 2,89 mètres, qui séduit rapidement le public par son élégance, sa modernité et son confort. Ce modèle surpasse les Citroën et devient le taxi préféré des Parisiens. La finition intérieure est soignée. Le compartiment passager peut accueillir trois personnes sur une banquette et deux autres sur des strapontins. Un espace à bagages est disposé près du chauffeur, qui peut être remplacé par un autre strapontin. Renault s'impose durablement sur le marché des taxis, mettant fin aux ambitions monopolistiques de Citroën. Les deux constructeurs ont désormais leur propre compagnie. Renault reste présent au sein de la G7 jusqu'en 1958, date à laquelle Simca reprend la compagnie.
Le KZ 11 n'a jamais été remplacé en France par un taxi aussi pratique, et conçu pour cet usage. Longtemps, il est resté l'archétype du taxi parisien, sillonnant sans cesse les rues de la capitale. Renault en aurait produit 2 400 exemplaires, dont 1 878 pour la seule compagnie G7. On en a vu en service jusqu'au début des années 60. Copyright Le lancement du Renault KZ 11 survient à un moment critique pour Citroën, confronté à de graves problèmes financiers et préparant le lancement de la Traction Avant. Ce nouveau modèle, cependant, va se révéler mal adapté au service de taxi : sa hauteur trop basse rend l'accès difficile, et son prix élevé, son rayon de braquage limité et sa fiabilité initiale douteuse rebutent les professionnels. Citroën peine à reconquérir le marché des taxis jusqu'en 1955, avec l'arrivée de la DS. Ce modèle innovant, véritable concentré de technologie, séduit les chauffeurs et incarne la modernité pour le public. Alors que Renault reprend l'ascendant sur le marché des taxis parisiens dans les années 30, d'autres constructeurs profitent des difficultés de Citroën. Peugeot, jusque-là absent de ce secteur, s'y aventure en 1934 avec une version longue de sa 301. Fort de cette première expérience, Peugeot lance la 401 DLT (Taxi), un modèle souvent peint en vert pâle, produit à 1 803 exemplaires entre 1934 et 1935. Conscient de l'impact publicitaire des taxis aux couleurs de sa marque, Peugeot investit massivement dans la promotion de la 401 DLT
Peugeot a avec la 401 une véritable politique commerciale concernant les taxis. Contrairement à ses concurrents Citroën et Renault, le constructeur sochalien ne possède pas de compagnie de taxis, mais vend son modèle directement aux chauffeurs en leur offrant une ristourne significative. Copyright Contrairement à Renault et Citroën, Peugeot privilégie une approche différente en s'appuyant sur le réseau des taxis indépendants plutôt que de créer sa propre compagnie. La marque au lion mise sur la satisfaction des chauffeurs pour promouvoir ses modèles, sachant que leur approbation et le bouche-à-oreille sont des gages de qualité auprès du public. La confiance des compagnies de taxis envers un modèle est également perçue comme un signe de fiabilité, de performance, d'économie et de confort par le public. En 1936, la Peugeot 402, avec sa ligne " fuseau ", modernise l'image de la marque et offre des performances améliorées, atteignant 110 km/h. Peugeot met en avant les nombreux taxis 402 circulant dans Paris pour rassurer le public. Le constructeur s'impose ainsi comme un acteur majeur sur le marché des taxis, position qu'il conservera jusqu'aux années 80 avec les modèles 403, 404, 504 et 505. Ni Renault ni Citroën ne parviendront à contester sa position dominante.
C’est au Salon de 1935 que la Peugeot 402 LT remplace la 401, et offre une ligne plus moderne. Peugeot en produit 2 083 exemplaires au cours de l’année automobile 1936. Ses qualités dynamiques et son esthétique permettent à Peugeot d’équiper une bonne partie des artisans taxi de la capitale. Ce qui les séduits le plus, c’est sans doute son excellente tenue de route et l’efficacité de son freinage. Source : http://blog.ricochon.fr
La 402 LT peut accueillir cinq passagers. Trois sur la confortable banquette et deux sur des strapontins amovibles insérés dans la séparation chauffeur. Une poignée, en métal chromé, permet au passager de la banquette de sortir du véhicule plus facilement. Au Salon de 1938, Peugeot présente sa nouvelle 402B. La déclinaison LT (taxi) n’est pas reconduite. C’est la berline familiale qui reprend le flambeau. Source : http://blog.ricochon.fr Lors de la reprise en main de la G7 par Simca en 1958, la compagnie s'équipe de Chambord, Trianon, Versailles, Beaulieu, Aronde. Mais c'est l'Ariane qui a la faveur des professionnels, grâce à son rapport espace/coût d'utilisation exceptionnel. Simca n'est pas le meilleur gestionnaire de cette affaire, qui au final lui fait perdre de l'argent. En 1960, André Rousselet, cadre chez Simca, prend le contrôle de l'entreprise. Il modernise avec succès l'exploitation de la compagnie qui renoue avec les bénéfices. Aujourd'hui, le groupe Rousselet gère près de 11 000 des 17 770 taxis parisiens.
Simca devenu actionnaire majoritaire au sein de la G7 y diffuse largement son modèle Ariane, version quatre cylindres de la Vedette, dont elle reprend la volumineuses carrosserie, avec une moindre consommation de carburant. Copyright Edmund Rumpler, un ingénieur autrichien visionnaire, débute sa carrière chez Nesseldorf, qui deviendra plus tard Tatra, avant de rejoindre Adler en 1903. En 1907, il se tourne vers l'aéronautique, un secteur en plein essor, et fonde la Rumpler Verke Gesellschaft GmbH, qui constitue le fondement de sa fortune. C'est à partir de cette entreprise qu'il lance, dès 1915, le projet de la voiture Rumpler à moteur arrière. À l'issue de la Première Guerre mondiale, comme Voisin ou Farman en France, il se reconvertit dans l'industrie automobile, appliquant ses connaissances en aérodynamique. La Rumpler Tropfen-Auto, littéralement " voiture goutte d'eau ", est dévoilée au public lors du Salon de Berlin de 1921, sous forme de châssis, de cabriolet et de berline, témoignant des études aérodynamiques poussées menées par Rumpler dans la soufflerie de Zeppelin.
En raison de son aspect révolutionnaire en forme de larme, et de l'implantation arrière de son moteur, la Rumpler fait sensation au Salon de Berlin 1921. Le chauffeur est installé à l'avant, tandis que quatre passagers prennent place au milieu de la voiture, à l'endroit où les secousses de la route sont les moins sensibles. Sur demande, deux strapontins supplémentaires peuvent émerger du plancher. Copyright La Rumpler Tropfen-Auto se distingue par son moteur 6 cylindres en W de 2,6 litres, développant 34 ch, et sa capacité à atteindre 120 km/h, une vitesse remarquable pour l'époque, avec une consommation de 12 litres aux 100 km. Proposée en versions torpédo et limousine, sa production est interrompue en 1922 par un incendie criminel. Le financement s'avérant difficile, c'est finalement le Dr. Erich Rabbethge, industriel allemand de la betterave sucrière, qui investit pour la production des cent premiers exemplaires.
Des essais en soufflerie réalisés en 1979 par Volkswagen ont démontré que la Rumpler affiche un Cx de 0,28, une valeur identique à celle d'une Porsche 911 type 997. Copyright Les débuts de la Rumpler Tropfen-Auto sont assombris par des problèmes techniques : direction difficile, surchauffe et freinage insuffisant. Bien que ces défauts soient corrigés, ils entachent durablement la réputation du véhicule et engendrent des coûts de garantie élevés. L'innovation aérodynamique, pourtant centrale dans la conception de Rumpler, ne parvient pas à séduire le grand public. Malgré des tentatives pour relancer les ventes, notamment des offres avantageuses pour les taxis berlinois en 1925, la production s'arrête en 1926, avec seulement 80 exemplaires produits.
Plusieurs exemplaires à usage de taxi sont revendus à Fritz Lang pour la réalisation de son film Metropolis en 1927. C'est une sombre évocation d'un venir de science-fiction. Leurs propriétaires sont trop heureux de se débarrasser de cette auto peu fiable. Copyright Les soubresauts d'une profession La victoire du Front populaire en 1936 permet la mise en place d'une convention collective pour la profession, qui prévoit une limitation du nombre de véhicules en circulation. Une commission regroupant les professionnels et des représentants de l'administration est instaurée, afin de traiter des problèmes rencontrés par les premiers. Les représentants des usagers seront plus tard invités à cette commission.
Source : https://www.humanite.fr. Des taxis prennent part à une manifestation organisée par la CGT, le 23 juillet 1935, à Paris.
La profession des taxis n'échappe pas aux conséquences de la guerre. Les chauffeurs sont appelés sur le front. Le rationnement en carburant rend la pratique du métier impossible. On voit réapparaître les fiacres et les charrettes à bras. Les vélos-taxis attirent une partie de la clientèle. Copyright Après la guerre, les chauffeurs de taxi se réorganisent progressivement et obtiennent le statut d'artisan en 1948. La profession se structure avec l'instauration de la visite médicale obligatoire, la création de la carte professionnelle en 1950, et l'obligation d'assurance pour les taxis avant même que cela ne devienne obligatoire pour les particuliers. En 1953, le lumineux " TAXI " sur le toit devient la norme. Parallèlement, le droit de céder les licences de stationnement se met en place, une pratique qui générera de nombreuses controverses dans la profession.
En 1945, une Renault Vivasix garée devant un panneau " Reserved for American red cross / réservé pour la croix rouge américaine / Taxis only", rue Duphot à Paris. Source : https://www.lestaxis.fr La modernisation des services de taxis s'amorce en 1956 avec l'apparition des premières centrales radio de réservation, suivie de l'installation de bornes d'appel dans les stations au début des années 60 et de la généralisation des centrales téléphoniques. Parallèlement, la réglementation évolue : en 1962, le certificat de capacité remplace l'examen de remisage, des normes sont établies pour l'identification des taxis (plaque de stationnement, emplacement du lumineux " TAXI ", visibilité du compteur, facture sur demande), et une mise à jour législative en 1995 renforce la protection et la régulation de la profession. Contrairement aux États-Unis ou au Royaume-Uni, la France n'a pas de modèle de taxi unique. Le marché français est varié, avec des voitures de marques françaises et étrangères. Autrefois, Citroën, Renault, Peugeot et Simca se disputaient le marché. Aujourd'hui, la concurrence est mondiale, avec des constructeurs japonais, coréens et allemands. D'ailleurs, un touriste arrivant à Paris en 2025 sera surpris par le grand nombre de berlines noires Toyota Camry et Lexus ES 300h de la compagnie G7 en circulation, conséquence d'un récent accord avec le géant japonais. Le 30 septembre 1940, le gouvernement de Vichy instaure le Comité d'Organisation de l'Automobile (COA), théoriquement destiné à faire le lien entre les constructeurs automobiles et l'occupant. Mais le COA a surtout pour vocation de diriger et de coordonner les activités de cette industrie. Il s'agit d'en finir avec la dispersion jugée peu efficace des moyens, qui résulte d'un nombre trop important de constructeurs. L'avenir selon le COA est à la concentration et à la grande série. Guidé par la Société des Ingénieurs de l'Automobile (SIA), le COA organise en juin 1943 un concours, dont l'ambition est d'imaginer, en s'inspirant du concept mis en place à Londres, le taxi parisien qui remplacera après la guerre tous les modèles existants issus de berlines de grande série. On peut s'étonner du thème de ce concours en pleine guerre, à un moment où les problèmes de circulation dans la capitale ne constituent pas une priorité. Un cahier des charges est rédigé qui précise le rapport habitabilité/encombrement, la consommation maximum de carburant, l'accessibilité, la maniabilité avec un rayon de braquage réduit, le niveau sonore, le prix de revient et celui de l'entretien, etc. Ce sont donc cinq projets qui sont présentés le 3 mai. Conséquence du cahier des charges, tous les prototypes dévoilés ce jour là ont retenu la forme de la cabine avancée - on ne parle pas encore de monospace - peu répandue à l'époque. Le moteur est positionné près du conducteur, ou en dessous de lui. Le style ponton n'en est encore qu'à ses balbutiements, et aucun des projets ose supprimer complètement la forme des passages de roues. Pour de multiples raisons, aucun des véhicules de ce concours n'aboutira à une production en série. Sur les 58 projets soumis au jury le 5 février 1944, sept sont retenus. Parmi la quinzaine de personnalités composant ce jury, on note la présence d'Ettore Bugatti et de Maurice Jordan, vice président de Peugeot. Les sept candidats sont invités à présenter leur projet définitif lors de la finale qui se tiendra le 3 mai 1945, à la Grande Cascade du Bois de Boulogne. Entre temps, deux des finalistes déclarent forfait. Il s'agit de la carrosserie Chalaud qui devait présenter un Citroën TUC et des établissements Georges Guérin qui travaillaient sur un taxi électrique. La Seconde Guerre mondiale prend officiellement fin en Europe le 8 mai 1945, par capitulation sans condition du Troisième Reich. L'Action Automobile dans son numéro de juin 1945 rappelle l'enjeux. Il s'agit de " créer un modèle de taxi se rapprochant le plus possible du type idéal au point de vu confort des voyageurs, accessibilité, transport des bagages, visibilité, maniabilité. En fait il s'agit de forger le parangon des taxis, pour le plus grand bien de tous les braves gens dénommés sans beaucoup de poésies les usagers " Le classement final du jury est le suivant : 1er : Charles Escoffier Les débouchés restent limités pour les constructeurs. En effet, les taxis ne représentent pour eux qu'un faible appoint de volume. Ils se vendent encore par petits groupes, voire à l'unité. Ce sont essentiellement des automobiles du quotidien munies d'un taximètre. On y ajoute une séparation pour isoler le conducteur, et on règle quelque peu le carburateur afin de réduire la consommation. Le tout est appelé taxi, et les autorités se montrent peu regardantes pour faire respecter les règlements préfectoraux. Le retour de la paix en 1945 avec des perspectives plus joyeuses est pourtant la période idéale pour concevoir des voitures entièrement adaptées à la fonction de taxi, et remplacer le parc hors d'âge, usé, ou simplement disparu pendant les évènements. Le projet vainqueur est présenté par Charles Escoffier, futur beau-père de Jean Rédélé, le fondateur d'Alpine, et important concessionnaire Renault installé près de la Place de Clichy à Paris. Il se singularise par ses portes arrière coulissantes, et par le compartiment passager découvrable. Le toit est en plexiglas au niveau du chauffeur et à l'avant du compartiment voyageur, ce qui rend plus agréable les balades en milieu urbain. L'emplacement réservé aux bagages est à l'arrière. La finition est assez basique, et l'on a préféré des panneaux peints dans l'habitacle plutôt que des garnitures plus difficiles à entretenir. Le poids à vide atteint 1 050 kg, et la vitesse maximum est de 60 km/h. Les plans ont été sont réalisés par Jacques Rousseau, ingénieur, et futur auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de l'automobile. La carrosserie tout acier est fabriquée chez Faget-Varnet à Levallois-Perret. Les panneaux qui la constituent sont de formes simples, pour faciliter une éventuelle production en série. Le moteur, la boîte, la direction et les freins sont empruntés à la Renault Juvaquatre, tandis que le cadre et le pont arrière proviennent de la Novaquatre. Le véhicule peut accueillir trois personnes sur une banquette, et deux sur des strapontins.
Moins gracieux que ses concurrents, c'est néanmoins le taxi présenté par Charles Escoffier qui remporte ce concours. La présence de portes coulissantes, de strapontins, de banquettes très large et d'une séparation chauffeur caractérisent ce prototype. Source : Archives Fondation Berliet - Lyon/France (avec leur aimable autorisation). A la Régie Renault, les préoccupations sont ailleurs. Le lancement de la 4 CV occupe les esprits. Si les taxis de Londres constituent une manne pour leur constructeur, le marché parisien paraît pour l'instant plus étroit. Charles Escoffier est disposé à fournir la mécanique à toute entreprise qui manifeste son intérêt pour lancer une production régulière. Rosengart, dont la disparition est proche, aurait répondu à l'offre, en produisant dix taxis vendus par le garage Escoffier. Compagnie Générale des Voitures (CGV) La Compagnie Générale des Voitures (CGV) a été fondée en 1866 à Paris. Cette compagnie de taxi expérimente dès 1898 la motorisation électrique, mais au regard des coûts d'exploitation élevés, elle y renonce vers 1905 au profit des moteurs thermiques. Avec son expérience de près d'un demi-siècle d'exploitation, cette société maîtrise parfaitement son sujet, et il paraît logique aux yeux de tous qu'elle se soit intéressée au concours du COA. Son projet est classé deuxième par le jury. L'utilisation de Duralinox, alliage mis à disposition par la société " l'Aluminium Français ", permet de concevoir un châssis et une carrosserie relativement légers. Avec ses 780 kg et son moteur de Renault Juvaquatre - comme le projet Escoffier - volontairement bridé dans un souci de longévité et de sobriété, ce " monospace " de 3,73 mètres atteint environ 70 km/h.
L'efficacité et la fonctionnalité sont les critères majeurs pris en compte par les participants du concours du COA. Le souci d'esthétique est souvent relégué au second plan. Source : Archives Fondation Berliet - Lyon/France (avec leur aimable autorisation). L'étroitesse de la lunette arrière, haut placée, surprend, car elle semble peu pratique pour une utilisation urbaine. La signalisation sur le toit se compose de trois lampes de couleurs différentes, permettant d'identifier la disponibilité de la voiture. En retirant une dizaine d'écrous, la caisse se désolidarise du châssis, facilitant ainsi l'accès à tous les éléments mécaniques.
Le prototype CGV dispose d'un très grand coffre. Son couvercle peut se rabattre et ainsi former un long plancher. Dans ce cas, une bâche doit être étendue pour protéger les bagages. Source : Archives Fondation Berliet - Lyon/France (avec leur aimable autorisation). Le taxi de Pierre Schwob obtient la troisième place du concours. Il se distingue par une excellente habitabilité, grâce à son compartiment passager surbaissé auquel on accède par une porte coulissante à double battant. Les occupants s'installent à son bord en vis à vis, comme dans une voiture de métro ! La banquette arrière étant située bien en avant de l'essieu arrière, elle s'étend sur toute la largeur du prototype. Le toit ouvrant permet d'apprécier le soleil des beaux jours. La partie intérieure des ailes est en tôle, tandis qu'à l'extérieur sont positionnés des éléments en caoutchouc, afin de faire face aux chocs inhérents à la circulation urbaine. La carrosserie est divisée en hauteur en deux parties, haute et basse. Les panneaux du bas sont amovibles, ce qui permet de les changer facilement après un accrochage. Avantage de ces astuces de conception, Pierre Schwob projetait un coût d'assurance moindre négocié auprès des compagnies.
Sur le taxi Schwob, la porte coulissante est en deux parties, façon métropolitain, et d'un fonctionnement très sûr. De manière générale, l'utilisation de l'espace de carrosserie disponible a été bien étudiée sur l'ensemble de projets. Source : Archives Fondation Berliet - Lyon/France (avec leur aimable autorisation). Le coffre arrière, séparé de l'habitacle, brise l'aspect monovolume du véhicule, offrant un espace de rangement indépendant pour les bagages ou autres objets, sans gêner les passagers par les odeurs. Cet espace peut également accueillir deux strapontins pour des trajets en plein air. À l'avant, un dispositif de signalisation visible de loin, jour et nuit, indique la disponibilité du taxi, sa partie inférieure servant de plafonnier.
Un bloc triangulaire est positionné sur le toit, permettant quel que soit l'angle de vue de savoir si le taxi est libre ou occupé. Eclairé dans sa partie supérieure et inférieure qui traverse le toit, il sert aussi de plafonnier. Source : Archives Fondation Berliet - Lyon/France (avec leur aimable autorisation). Conforme aux exigences du concours, ce véhicule offre une maniabilité exceptionnelle avec un rayon de braquage de seulement 9 mètres, le rendant idéal pour les artisans taxis et les grandes compagnies de taxis. De plus, sa conception pourrait intéresser la SNCF pour ses navettes urbaines, facilitant le transport de groupes de voyageurs avec des bagages volumineux.
Comme l'autorise le règlement, ce prototype n'est pas roulant. Il a toutefois été étudié pour recevoir un bicylindre Chenard & Walcker, comme l'indique la fiche descriptive diffusée lors d'une nouvelle présentation au Salon de Paris 1946. Guilloré s'est distingué parmi les nombreux carrossiers français à la fin des années 30 en proposant des carrosseries plutôt conventionnelles, principalement sur base Delage, Delahaye et Talbot. En 1937, le carrossier est choisi par Delahaye, tout comme Chapron, pour produire en petite série des carrosseries de coach d'usine. Guilloré fait son retour sur les salons à la fin des années 40, avant de recentrer ses activités dans les années 50 sur les habillages de poids lourds. Entre-temps, il participe au concours du COA. A la carrosserie, Guilloré a adapté un moteur de Peugeot 202 et un pont arrière d'utilitaire 202. Toutes les pièces mécaniques sont d'origine Peugeot.
Une partie du toit s'ouvre avec la porte et permet aux voyageurs de monter ou de descendre du véhicule sans être obligé de se courber. Source : Archives Fondation Berliet - Lyon/France (avec leur aimable autorisation). Un porte-bagages installé sur le toit complète l'espace utile du taxi Guilloré. Dépourvu de tout revêtement intérieur, ce véhicule est doté de sièges escamotables, ce qui facilite grandement son nettoyage au jet d'eau. À l'arrière, il peut accueillir jusqu'à six passagers, dont trois sur un strapontin. Une septième place est prévue à l'avant, à côté du conducteur, près du moteur. Une partie du toit s'ouvre en même temps que la porte pour faciliter l'accès à bord. Construit en acier, l'ensemble pèse 1 190 kg, mais ce poids pourrait être réduit à 950 kg en utilisant des métaux plus légers tels que le Dunalinox. Le carrossier n'a pas l'ambition de produire ce véhicule lui-même et préférerait vendre la licence à un autre constructeur
Ce taxi est dû entièrement aux efforts de la carrosserie A. Guilloré : conception, construction, mise au oint, présentation au concours. Source : Archives Fondation Berliet - Lyon/France (avec leur aimable autorisation). Société Parisienne de Camions (SPC) Le taxi de la Société Parisienne de Camions (SPC) a toutes les apparences d'un petit autocar. Parmi les cinq concurrents, c'est celui qui offre le plus de volume intérieur. La principale particularité de ce prototype est la possibilité de désolidariser en quelques minutes toute la partie mécanique de la carrosserie. On aurait pu imaginer, à l'extrême, un chauffeur de taxi rentrant à son dépôt pour des opérations d'entretien, détachant puis attelant un nouvel ensemble mécanique, et repartant le lendemain matin avec le même habitacle. Le moteur est un V8 Ford de 2,2 litres accouplé à une boîte trois vitesses, décalé vers la droite pour laisser plus d'espace au conducteur. Un petit panneau sur le toit permet de vérifier si le taxi est libre. Celui-ci est rabattu dès qu'un client prend place à bord. On accède à l'habitacle par des portes coulissantes très élaborées, silencieuses et étanches. Si les passagers bénéficient d'un certain confort, le compartiment du conducteur est plus austère dans sa présentation.
La proposition de la Société Parisienne de Camions (SPC), particulièrement volumineuseSource : Archives Fondation Berliet - Lyon/France (avec leur aimable autorisation). Depuis 1933, une armada de Renault KZ 11 de la compagnie G7 sillonnait les rues de Paris. Ils seront définitivement mis à la retraite en 1959. La Régie Renault, parfaitement consciente de l'ancienneté du KZ 11, décide en 1948, soit trois ans après le concours du COA, de revisiter à sa façon le concept du taxi urbain. Le projet qu'elle présente, bien qu'également basé sur la Juvaquatre, n'a rien à voir avec la proposition de Charles Escoffier, même si le dessin d'ensemble est proche et si l'on retrouve sur les deux projets un pavillon découvrable. La cabine avancée n'est plus une nouveauté. Les portes sont à ouverture classique, et non coulissantes. Si leur forme rectangulaire paraît fonctionnelle, à l'arrière, il semble manquer une dizaine de centimètres en largeur pour qu'à leur ouverture, le passager ne soit pas en décalage par rapport à la banquette. Comme sur son ancêtre le KZ 11, une cloison sépare le conducteur des passagers. Le coffre à bagages est plus généreux que sur le prototype Escoffier. De longs essais sont menés dans les rues de la capitale en 1948, mais aucune compagnie de taxi ne manifeste son intérêt. Une dizaine d'exemplaires auraient été assemblés sous la forme d'une présérie, que l'on a vus circuler dans le Paris d'après-guerre.
Les projets issus du concours du COA et ce prototype Renault préfigurent, avec quatre décennies d'avance, l'architecture des monospaces qui fleuriront à la fin du siècle. Cependant, les compagnies parisiennes boudent ce type de proposition, préférant s'en tenir à de très classiques berlines. Copyright Aucun industriel, Renault pas plus qu'un autre, n'ose s'aventurer dans la production en série d'un véhicule spécifiquement conçu pour la profession de taxi. Cette réticence s'explique sans doute par une appréhension quant à la maturité du marché, et donc à la possibilité d'atteindre des volumes de vente suffisants, à une époque où la relance économique engendre d'autres priorités. Il est pourtant aisé d'imaginer la Régie Renault synthétiser les meilleures innovations du secteur, afin de rejoindre le clan très fermé constitué par Austin et Checker. Cependant, les espoirs ne sont pas totalement anéantis lorsque Renault présente, en mai 1950, la Prairie, première déclinaison de la gamme Colorale. Colorale est une contraction des termes coloniale et rurale. Ce nom est révélateur de la clientèle visée, qui se trouve à la fois dans les nombreux territoires de l'Union française (les colonies) et dans les campagnes (le monde rural) de la métropole. La Prairie est dévoilée au grand public lors du Salon de Paris en octobre 1950. Les stylistes, sous la direction de Robert Barthaud, démontrent leur savoir-faire en proposant diverses carrosseries sur une même base. L'accueil des concessionnaires est chaleureux, séduits par l'esthétique du véhicule et la perspective d'enrichir leur offre. En l'absence de nouveautés majeures, les Colorale font la couverture de nombreux magazines spécialisés, notamment les éditions spéciales du Salon. Le design, avec sa ligne ponton enveloppante et sa calandre à moustache rappelant la 4 CV, témoigne d'une volonté de cohérence de gamme. Sur le plan technique, la simplicité est de mise, la vocation utilitaire primant. Le robuste châssis est inspiré du fourgon 1000 kg. Le moteur, un 4 cylindres de 2 383 cm3 et 48 ch, bien que peu puissant, est reconnu pour sa fiabilité. Conçu en 1919 et ayant évolué au fil des ans, il équipe les utilitaires Renault depuis 1936 et est connu du réseau sous l'appellation " 85 latéral ". La Colorale sera la dernière Renault à l'utiliser. Afin de soulager l'usine de Billancourt, la fabrication des caisses est confiée à Chausson à Gennevilliers, avant d'être envoyées à l'Île Seguin pour la peinture et l'assemblage final.
Renault Colorale. Copyright La Prairie, lancée au début de 1951, incarne un break familial spacieux, doté de quatre portes à ouverture "en armoire" et d'un double hayon arrière. Conçu pour accueillir six passagers, avec la possibilité d'un septième siège amovible dans le coffre, il offre un vaste espace pour les bagages. La banquette arrière escamotable transforme le véhicule en un utilitaire volumineux. Renault privilégie la fonctionnalité à la performance, bien que la consommation de carburant, avoisinant les 14 litres aux 100 km, puisse dissuader certains acheteurs. Le " taxi 85 ", dérivé de la Prairie, propose sept places : trois sur la banquette arrière, trois sur des strapontins déployables face à celle-ci, et un autre strapontin installé près du conducteur. En position dépliée, il peut être utilisé pour accueillir un passager ou, sinon, servir d'emplacement pour les bagages. En configuration sans strapontins arrière, l'espace aux jambes est particulièrement généreux.
Renault Colorale. Copyright La sellerie moelleuse est tendue de velours, tandis que la présence d'un toit ouvrant apporte une touche finale de raffinement. Avec cette version, Renault espère convaincre les compagnies de taxi, notamment la G7 à Paris qui devra un jour ou l'autre remplacer son vieux KZ 11. Hélas, vendu trop cher, le taxi Renault Colorale n'intéresse ni la G7 ni les autres professionnels du secteur, entraînant sa disparition du catalogue dès 1953. À défaut de s'imposer sur le marché français, tant à Paris qu'en province, le " taxi 85 " trouve son public à l'étranger. La Grèce commande soixante exemplaires, et d'autres sont acquis par des compagnies de taxis madrilènes. Pour ces dernières, Carrier, basé à Saint-Ouen, propose des peintures bicolores spécifiques et des aménagements sur mesure, témoignant d'une finition haut de gamme.
Brochure Renault Colorale Taxi 85. Copyright
C'est au Salon de Paris 1972 qu'a été présenté ce véhicule monocorps, baptisé H4, basé sur un châssis et une mécanique de Peugeot 204. Le carrossier Heuliez sort des sentiers battus en proposant un concept novateur, adapté aux besoins des artisans taxis. Si, aujourd'hui, les monospaces font partie intégrante de notre quotidien, il faut se replacer au début des années 1970, époque où ce type de configuration relevait encore de la science-fiction (si l'on excepte les voitures issues du concours COA, au design très daté). Le H4 innove par un accès à bord facilité par des portes arrière généreuses, et surtout par un rapport habitabilité/encombrement exceptionnel.
Peugeot H4 par Heuliez, Salon de Paris 1972. Copyright Très compact, il mesure 3,65 mètres de long, 1,70 mètre de large et 1,60 mètre de haut, soit 14 cm de moins qu'une Renault Modus en longueur, pour une hauteur et une largeur similaires. La banquette arrière est conçue pour accueillir trois passagers. À l'image des taxis londoniens Austin ou Winchester, le H4 dispose, à côté du conducteur, d'un espace dédié aux bagages. Un strapontin est installé sur cet emplacement pour accueillir si cela s'avère nécessaire un quatrième voyageur. Une vitre sépare le chauffeur du reste de l'habitacle.
Extrait de l'Auto Journal n° 18 du 15 octobre 1972 (montage) Innovation majeure pour l'époque, le H4 est doté d'un toit en verre transparent, un équipement qui ne se démocratisera que dans les années 2000, notamment chez Peugeot (307/308 SW, 407 SW). Par ailleurs, le pare-brise et les vitres latérales affichent des dimensions inhabituelles pour l'époque. Renault a lancé le concept des boucliers avec sa Renault 5, en remplacement des pare-chocs classiques. Heuliez lui emboîte le pas avec un ensemble teinté dans la masse qui encercle la voiture, dans une couleur bleue contrastant avec le reste de la carrosserie orange. Cette teinte orange, omniprésente jusque dans l'habitacle, est très en vogue au début des années 1970. La mécanique reste quant à elle assez conventionnelle : un 1 130 cm³ de 60 ch SAE. L'œil averti remarquera la présence d'optiques empruntés au coupé 504. Peu après sa présentation, le H4 remporte le Grand Prix de l'art et de l'industrie automobiles français, une récompense décernée depuis 1948 à l'initiative de la Société d'encouragement à l'art et à l'industrie (SEAI).
Source : L'Automobile N° 318 de novembre 1972. Le concept semble être trop en avance sur son temps. Le H4 ne dépasse pas le stade de prototype. Les taxis 504 et R16 ont encore de beaux jours devant eux. Heuliez envisage sur papier d'en dériver des versions camionnette et pick-up. Peugeot reste sceptique face à ce type de véhicule, lorsque Matra lui propose quelques années plus tard un projet grand public dans le même esprit. Renault se lance avec plus d'audace à partir des plans proposés par le groupe de Jean-Luc Lagardère, et connaît le succès que l'on sait avec l'Espace. Le concept du monospace est décliné en 1996 sur une voiture plus courte, la première Scénic, autre réussite commerciale pour l'ex-Régie. Citroën suit le mouvement plus tardivement en 1999 avec le Picasso. Heuliez avait déjà vu juste un quart de siècle plus tôt, à l'exception du style très " bio design " des premiers monospaces de série, pas encore d'actualité au début des années 1970. Déjà, comme l'écrivait Marguerite Yourcenar, " C'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt ". Cette vérité, Heuliez allait encore la vérifier bien des fois dans les années à venir. Le H4 demeure un véhicule majeur dans l'histoire d'Heuliez. Il a en effet été le premier concept-car de la marque présenté au public, si l'on considère que la Murène a été créée chez Brissonneau et Lotz, et que les Citroën DS Cabriolet quatre portes ou Simca 1501 Coupé n'ont été que des transformations sur des bases existantes. Le prototype a été récupéré par Heuliez auprès de Peugeot, et stocké au sein du conservatoire Heuliez. En 2010, il obtient son inscription à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Lors de sa mise en vente par Artcurial le 7 juillet 2012, il se présente dans un bel état de conservation, sans pour autant être capable de prendre la route, faute de circuit de freinage et de système de remplissage de carburant. Estimé entre 30 000 et 50 000 euros, il est vendu 19 657 euros frais compris. Yves Dubernard, le père du H4, précisait que " ce véhicule a fait entrer Heuliez dans une ère nouvelle, celle de la création, de l'innovation et du design ". A l'issue de la vente Artcurial en juillet 2012, son retour dans le département des Deux-Sèvres, aux mains d'un amateur éclairé, n'a pu que rassurer le designer. Le collectionneur se disait disposé à prêter le taxi H4 à différents musées régionaux, et à participer à des événements mettant en scène la culture et l'histoire de l'automobile.
Peugeot H4 par Heuliez, un espace bagage supplémentaire est aménagé près du conducteur. Copyright Claude Rouxel évoque le H4 dans l'ouvrage " La grande histoire des taxis français ", édité en 1989 par Edijac. " Malgré des perspectives peu réjouissantes pour le marché du véhicule conçu spécifiquement, certains continuent à croire au " vrai " taxi. Dans les années 60, la Compagnie G7 avait testé le taxi londonien, mais aucune suite ne fut donnée à cet essai. Dans les années 70, on vit une intéressante tentative du dynamique carrossier Heuliez qui avait retenu la mécanique de la Peugeot 204. Son projet avait de nombreuses qualités, il permettait un prix de revient économiquement intéressant et prévoyait une large place pour les passagers, ce qui est finalement le double avantage que doit présenter un taxi. Et en plus, il était très esthétique, ce qui n'est pas négligeable. Même s'il ressortait aujourd'hui, avec une autre mécanique, il serait toujours au goût du jour. La France tenait peut-être le remplaçant de l'éternel G7, elle a laissé échapper l'occasion. " Yves Dubernard nous relate la lente évolution des mentalités qui a mené à la création du taxi H4. Ce qui suit est une synthèse de ses écrits, tirée de son ouvrage " Heuliez, carrossier et constructeur ", publié aux éditions ETAI en 2012. Sans Gérard Quéveau, le H4 n'aurait probablement pas existé. Gérard Quéveau est né à Landerneau, dans le Finistère, en 1934. Il est le fils de Fernand Quéveau (1914-1938) et de Fernande Forre (1915-2007). Cette dernière a épousé en 1950 Henri Heuliez (1914-1996), fils de Louis Heuliez (1887-1947) et petit-fils d'Adolphe Heuliez (1884-1935). Gérard Quéveau entreprend en 1954 des études à l'École Nationale Supérieure d'Ingénieurs Arts et Métiers d'Angers, qu'il complète à l'École Supérieure des Techniques Aérospatiales de Paris. Durant sa formation, il fait ses premiers pas en tant que stagiaire dans l'entreprise familiale, qu'il intègre finalement en mars 1961, après un service militaire de trente-deux mois en Algérie, en tant que sous-lieutenant au sein de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre. Il arrive à Cerizay avec un regard neuf. Un voyage aux États-Unis en 1964, en compagnie de son frère Jean-Pierre Heuliez, le conforte dans la nécessité de faire évoluer l'entreprise familiale. Il est présenté aux grands constructeurs américains par l'un des fournisseurs américains d'Heuliez. À l'image d'André Citroën qui rendit visite à Henry Ford en 1912, Gérard Quéveau revient des États-Unis avec de nouvelles références. Il convainc Henri Heuliez de faire évoluer la stratégie de l'entreprise et d'adopter une nouvelle organisation pour la développer. Celle-ci se structure en plusieurs divisions, qui deviennent autant de sociétés indépendantes, formant ainsi un groupe d'envergure. Gérard Quéveau, en tant que directeur général, nomme à la tête de ces divisions des hommes de confiance, ingénieurs pour la plupart. L'un d'eux est Christian Chéron, son camarade de promotion. Les deux amis, très complémentaires dans leur manière d'aborder l'avenir, forment un tandem particulièrement efficace. C'est donc une équipe jeune et renouvelée qui contribue à l'extraordinaire expansion du groupe dans les années 1960, grâce à une politique d'investissement en machines mûrement réfléchie et au développement des effectifs. Ceux-ci passent de 440 salariés en 1960 à près de 2 000 en 1970. Dans les années 1960, Heuliez est devenu un sous-traitant apprécié des grands constructeurs français. Des relations durables permettent à Heuliez de produire des cadres de portes, des planchers, des sièges, etc., pour le compte de Peugeot, Citroën ou Simca. Une véritable coopération industrielle, promise à un bel avenir, s'installe en quelques années. Parallèlement, Heuliez tente par tous les moyens de séduire ces constructeurs, en particulier Citroën, en soumettant à l'entreprise de Javel différentes études : un cabriolet DS quatre portes en 1962, un break Ami 6 en 1963, une Dyane tout-terrain en 1967, etc. Ces voitures pourraient être produites à Cerizay. Une demande émane de chez Simca. Il s'agit d'entreprendre l'étude d'un petit utilitaire à partir des éléments mécaniques des 1000 et 1100, dont l'une des particularités serait d'être doté d'une grande porte latérale coulissante, donnant accès à la fois au poste de conduite et à l'espace de chargement. Ce véhicule devrait répondre aux nombreuses contraintes des livraisons en ville. Un créneau de marché semble en effet libre, un cran en dessous des Renault Estafette, Peugeot J7 et Citroën H. On espère à Cerizay que cet utilitaire apportera une nouvelle charge de travail régulière pendant quelques années. Mais le géant américain Chrysler, dont la part dans le capital de Simca ne cesse de croître depuis 1958, met son veto, alors même que les machines d'emboutissage sont déjà au point. À titre de dédommagement, Heuliez se voit confier la fabrication des soubassements des Simca 1301 et 1501. Confier à Heuliez ces travaux de sous-traitance s'inscrit dans une stratégie industrielle. On se prépare à Poissy à lancer la 1100. Il faut de la place. Et puis, pour Simca, contribuer au développement d'un industriel qui œuvre à son service, c'est disposer à terme d'un fournisseur capable de répondre à différentes demandes, qu'il s'agisse de sous-traitance régulière ou de fins de série."
Projet d'utilitaire Simca. Source : http://www.artcurial.com Malgré ce projet avorté, Gérard Quéveau ne renonce pas. Il faut provoquer les clients potentiels, leur proposer des idées, des projets, et peut-être les inciter à passer commande d'une production en série, même de volume modéré. C'est ainsi que l'entreprise de Cerizay expose au Salon de Paris 1968 sa première automobile de tourisme, une étude de coupé Simca 1501. Gérard Quéveau aurait contribué aux lignes de cette Simca unique. La belle automobile semble le séduire. Hélas, cette version arrive un peu tard dans la vie du modèle pour connaître une suite industrielle. Le projet du taxi H4 s'inscrit dans cette stratégie de propositions d'études aux constructeurs.
Le taxi H4 auu Salon de Paris, en octobre 1972. Copyright Yves Dubernard a apporté lors d'échanges qui ont eu lieu début 2021 les informations suivantes au sujet du H4. Le concept " L'idée de concevoir un projet de taxi pour le Salon de 1972 est née du constat de l'absence de véhicule spécialement conçu pour cette fonction, la plupart étant de simples berlines. Le taxi londonien faisait exception à la règle et a véritablement inspiré le projet H4. Je n'ai pas été le seul à me pencher sur le sujet. Guy Greffier, arrivé chez Heuliez en 1969, avait été embauché pour la division cars et bus et travaillait principalement à la personnalisation des autocars. Il s'est orienté vers une architecture à poste de conduite avancé, de type Fiat Multipla. L'inconvénient de ce projet était l'absence de base disponible. Venant de Peugeot et Simca, j'ai jugé pertinent d'exploiter celle d'une berline à groupe motopropulseur transversal avant, bénéficiant ainsi d'un bloc avant compact et offrant un rapport surface au sol/habitabilité particulièrement favorable. Le choix s'est porté sur la 204 (un modèle d'occasion acheté chez un garagiste local) plutôt que sur la Simca 1100. Le dessin du H4 a été très rapidement arrêté, ainsi que le choix de sa présentation bicolore, l'idée étant que la partie basse du véhicule soit revêtue d'une peinture souple protégeant des rayures et des indentations. Il a également été décidé de réaliser pour le Salon non pas une maquette ou un moulage en polyester monté sur une base de 204, ce qui aurait été plus facile, mais un véhicule en tôle et roulant. L'équipe de Pierre Thierry, responsable du bureau d'études automobile, disposait d'un effectif de tôliers formeurs très performants qui a réalisé tous les éléments de la carrosserie directement à partir de la maquette en plâtre, et les a assemblés sur un marbre référencé, et ce dans un délai extrêmement court " Salon 72 " Le premier jour du Salon, les professionnels de l'automobile se croisant dans les allées avaient l'habitude d'échanger leurs impressions. Je me souviens que cette année de la présentation du H4, en fin de matinée du jour de l'ouverture, ceux qui avaient déjà pu faire un tour complet recommandaient à ceux qui commençaient seulement la visite : " Allez voir chez Heuliez, c'est le seul stand où il y a quelque chose de vraiment intéressant à voir ! " Le stand a vu défiler en particulier les ingénieurs des différents services du centre d'étude Peugeot de La Garenne. Il faut se souvenir de la frilosité de la marque quant à sa stratégie. C'est d'abord à Peugeot que Philippe Guédon avait proposé son projet de monospace Matra. " Pas de marché pour ce type de véhicule ! " Vous pensez bien que le concept du taxi et de son dérivé utilitaire constituait à leurs yeux une aventure risquée à ne pas tenter. " Thonons les bains Le H4 demeure un véhicule majeur dans l'histoire d'Heuliez. Il est en effet le premier concept-car de la marque présenté au public, si l'on considère que la Murène fut créée chez Brissonneau et Lotz, et que la Citroën DS Cabriolet quatre portes et le coupé Simca 1501 n'ont été que des transformations sur des bases existantes. En juillet et août 1973, la Maison des arts et loisirs de la ville de Thonon-les-Bains organise une exposition sur le thème de "L'esthétique automobile". L'initiative revient à un passionné d'automobile, un dénommé Jean-Louis Blaisius. L'objectif est de montrer au public les tendances de style depuis les débuts de l'automobile. Ce sont au total quinze voitures à l'échelle 1 qui sont exposées. Plusieurs constructeurs et carrossiers ont répondu à l'appel. En dehors des quatre grands constructeurs français du moment et d'Heuliez, on peut citer Matra, Opel, BMW, Bertone, Pininfarina, Italdesign, ainsi que les stylistes Joël Brétecher et Aldo Sessano. Yves Dubernard nous raconte cet épisode " vu de l'intérieur " : " Début 1973 je suis contacté par un homme responsable de la communication au Crédit Lyonnais. Il est basé au siège, Avenue de l'Opéra, à Paris. Cet homme, Jean-Louis Blaisius, passionné d'automobile, me parle du projet d'une d'exposition consacrée au style, qu'il veut organiser à la maison de la culture de Thonon-les-Bains dont il est originaire. Il a les appuis du maire de la ville, et même du préfet, tous deux également passionnés d'automobile (Le Préfet possède une Alpine A110). L'idée est que cette exposition débouche sur une Biennale du Style Automobile. Un autre enthousiaste local en la personne du patron d'une entreprise de transports offre son concours pour prendre en charge l'acheminement des concept-cars qui seront proposés. Le taxi H4 est finalement exposé en la compagnie prestigieuse de la Lamborghini Marzal de Bertone ou de L'Opel CD de Chuck Jordan. BMW a mis à disposition la maquette de la Turbo de Paul Bracq et Matra une Formule 1. Peugeot a envoyé un témoignage du passé sous forme de la 402 Eclipse, etc ... Quelques personnalités de l'automobile honorent de leur présence cet évènement lors de son inauguration. Je me souviens de Jean-Pierre Beltoise, Giorgetto Giugiaro, Paul Bracq ou Amédée Gordini. Cette exposition s'est ensuite déplacée à la Maison des Arts de Sochaux. L'idée de la biennale a malheureusement fait un flop en raison de la rencontre de réticences, provenant toutes du milieu automobile, sous de mauvais prétextes (concurrence avec le Salon notamment !). J'étais présent à l'inauguration et m'étais fait accompagner par Guy Greffier et Michèle Gendroneau, l'attachée de Presse d'Heuliez également invitée. Le H4, et après ... " Après le Salon de 1972, Heuliez n'a plus exposé de véritable concept-cars sur son stand jusqu'en 1986, à l'exception du concept de l'autobus futur sur le stand Cars et Bus en 78. Le retentissement que le taxi H4 a eu dans la sphère automobile a amené les constructeurs, français dans un premier temps, à s'intéresser à Heuliez sur le nouvel aspect de la création. La tentation de consulter la société pour soumettre des projets et obtenir des réponses alternatives à leurs études internes a débouché sur des amorces de collaborations. Le service de style de Renault dirigé par Gaston Juchet a été le premier à tenter l'expérience. Il faut dire que chez Renault, faire appel à des sources extérieures étaient déjà dans les habitudes depuis la Renault 8 (Philippe Charbonneaux). Le président Gérard Quéveau voit dans ce démarrage de consultations une nouvelle carte à jouer, pouvant apporter un vrai plus à l'image de l'entreprise, avec en plus la perspective de retombées sur le plan industriel. Il me donne carte blanche pour commencer à constituer une petite équipe. A ses yeux, la démonstration de créativité que le taxi H4 a apportée ne justifie pas de renouveler l'opération au salon de 73 ainsi que sur les suivants, d'autant que la charge du service Style naissant ne permet plus de consacrer du temps à de nouvelles études. La promotion du Style Heuliez se fait par l'intérêt des propositions, et par le bouche à oreille dans la profession, ce qui a amené en 1977 au gros contrat avec Ford , puis la construction du centre DEA au Pin en 1978. Par ailleurs G Quéveau va désormais privilégier lors des Salons la présentation des productions de l'entreprise : 604 Limousine, Renault 5 Le Car Van, Simca 1100 avec le pick up de loisirs Wind, qui ne peut pas être considéré comme un véritable concept-car. "
Uwe Bahnsen et Robert Lutz en visite en 1978 chez Heuliez? qui est chargé d'une étude préliminaire pour le Ford Transit II. Source : Archives Patrick le Quément. Le DEA au Pin " Concernant la collaboration interne entre le style et le bureau d'études dirigé par Pierre Thierry . Gérard Quéveau avait, dans une logique de complémentarité, mis à ma disposition un studio au sein du bureau d'études, qui comprenait l'atelier de réalisation des prototypes où le taxi a été construit. En 1972, il n'y avait aucun personnel véritablement formé pour la réalisation de maquettes de style, et ce sont les tôliers qui se sont improvisés staffeurs pour construire la maquette du taxi. La simplicité des volumes très géométriques ne posait pas trop de difficultés, et j'étais donc très dépendant des moyens de Pierre Thierry. Gérard Quéveau a fini par me positionner au même niveau hiérarchique que Pierre Thierry, ce qui a rendu notre collaboration plus efficace. La création du taxi H4 a entraîné au sein de l'entreprise une succession de bouleversements, le plus marquant ayant été la séparation des Etudes et du Style Automobile de l'activité industrielle de Cerizay avec la création du centre DEA au Pin, codirigé par Pierre Thierry et moi-même. " Laurent Pautrot, toujours à l'affût de bonnes informations au sujet d'Heuliez, m'a fait parvenir le document suivant. Il s'agit d'un courrier adressé à Heuliez suite à la présentation par la presse du projet du taxi H4. Bien que ce ne soit pas une réalisation Heuliez et que nous soyons plutôt dans le domaine de l'anecdote, ce document reste intéressant pour l'histoire qu'il raconte et la qualité de sa présentation. La démarche est par ailleurs particulièrement sympathique.
Courrier adressé à Heuliez après la présentation du H4. Copyright 2012, la fin d'une histoire industrielle En février 2012, deux événements soulignent les difficultés d'Heuliez : la vente de 38 véhicules du conservatoire de la marque, incluant des modèles uniques tels que des études et des concept-cars, ainsi que l'annonce de la cession de 750 brevets appartenant à l'entreprise. Les visiteurs avertis du salon Rétromobile de Paris, qui s'est tenu du 1er au 5 février 2012, ont été surpris de découvrir sur le vaste stand d'Artcurial Motorcars deux voitures d'Heuliez : la Citroën SM Espace et la WM n° 51, célèbre pour avoir atteint 405 km/h sur la ligne droite des Hunaudières en 1988. Artcurial Motorcars s'apprêtait à mettre en vente, sans prix de réserve, le 7 juillet 2012 lors du " Le Mans Classic ", trente-huit voitures et prototypes qui étaient jusqu'alors conservés au sein du conservatoire. La collection complète comprenait environ quatre-vingts véhicules roulants et maquettes. Quelques voitures avaient déjà été vendues en septembre 2001 pour prouver la bonne foi de la direction de l'époque, qui faisait face aux premières difficultés de l'entreprise
Peugeot H4 par Heuliez, avec d'autres réalisations Heuliez plus modernes (Mercedes Intruder, BMW Rétractop ...). Copyright Quelques passionnés, à travers notamment l'association Deux-Sèvres Auto Mémoire, tentent de sensibiliser François de Gaillard, président de BGI, à l'énorme perte que constituerait la dispersion, même partielle, de cette collection unique. BGI est alors propriétaire, depuis 2010, de la marque Heuliez et de ses installations. François de Gaillard déclare dans le numéro 1512 de La Vie de l'Auto, daté du 21 juin 2012 : " Il n'y avait pas vraiment de politique patrimoniale en dehors d'une association locale de passionnés, qui a sauvé les véhicules jusqu'à ce jour. J'en profite pour les remercier ici ! Les voitures étaient stockées dans un hangar. On les a regroupées et remises en route, restaurées pour certaines, et l'on a cherché une solution pour les valoriser, par exemple en partenariat avec le musée de Châtellerault. Nous n'avons pas trouvé de solution., l'entreprise n'a pas vocation à posséder son propre musée et vous comprendrez que ce n'était pas la priorité, qui reste de sauver les emplois. En accord avec les partenaires sociaux, il a donc été décidé de vendre ces autos, sans prix de réserve, de manière à libérer de l'espace, récupérer de l'argent et faire vivre l'image d'Heuliez car ces véhicules vont de nouveau rouler, être vus du public. Chacun est unique, a demandé un coût de réalisation astronomique et l'on peut aujourd'hui les acheter. " Malgré les tentatives du président de BGI pour obtenir le soutien des pouvoirs publics, aucune solution de reprise par les collectivités n'a été trouvée. Depuis 2007, l'association Deux-Sèvres Auto Mémoire espérait valoriser cette collection, un atout pour Heuliez et le département. Les passionnés ont déployé des efforts considérables pour préserver cet ensemble, menacé par les difficultés d'Heuliez. Dès 2010, ils ont même entrepris des démarches pour inscrire trois véhicules (la SM Espace, la WM et le Taxi H4) à l'Inventaire des Monuments Historiques. L'amertume était d'autant plus vive que l'association a eu la possibilité, pendant trois ans, de faire découvrir la collection à un cercle restreint de passionnés, lors de visites guidées par Vincent Thibaudeau, qui rappelait à chaque fois la fragilité de ce patrimoine.
Le taxi H4 et ses acolytes au sein de l'éphémère conservatoire Heuliez dans l'usine de Cerizay. Copyright
A l'issue de la vente Artcurial de juillet 2012, le H4 retourne dans le département des Deux-Sèvres, aux mains d'un amateur éclairé. Octobre 2012 - © VD Quelques reproductions miniatures du taxi H4 ont été réalisées à l'initiative du CAMP, le Club Autos Miniatures Peugeot. Merci à Alain Bermond, membre du club depuis 1998, et président depuis 2013, pour la transmission du communiqué et des deux illustrations ci-dessous. " Le Club Autos Miniatures Peugeot a été créé en 1995 ; il rassemble à ce jour près de 300 membres issus de 14 pays différents, tous passionnés par les miniatures Peugeot mais également par les voitures de la marque à l’échelle 1. Au cours de ses 26 années d’existence, le club a proposé en exclusivité à ses membres plus de 60 reproductions exclusives qui n’avaient jusqu’alors jamais existé en miniature. La réalisation est confiée à un artisan et les exemplaires sont proposés en série limitée à prix coûtant. C’est au cours de l’année 2003 que le projet de reproduction du Taxi H4 d’Heuliez est initié. Un membre du bureau du club ayant par le passé effectué un stage chez Heuliez dans le but de découvrir les métiers de l’industrie automobile, et qui avait à cette occasion participé à la restauration d’un élément du prototype, s’est alors chargé de contacter l’entreprise. Avec beaucoup de gentillesse, Madame Trouvé, responsable de la communication, avait transmis un Cd-Rom avec des photos et des données techniques. Mais cela n’étant pas suffisant pour réaliser le prototype de la miniature, un rendez-vous fût pris pour une visite sur place avec Monsieur Bernier le responsable des prototypes. Faute de place, le Taxi H1 était stocké dans un hangar en dehors de l’usine en compagnie d’autre prototype. Il a pu être sorti à l’extérieur pour effectuer des prises de vue et prendre toutes les côtes nécessaires. La miniature dont la conception et la réalisation avaient été confiées à l’artisan Esdo a été proposée en souscription pour les membres en 2004 à son prix de revient de 76€. Elle a été produite à 250 exemplaires dont 20 avaient été acquis par la société Heuliez pour les distribuer auprès ses clients. La miniature de ce véhicule atypique et novateur pour son époque est souvent en bonne place dans les vitrines des collectionneurs. N’étant bien entendu plus disponible, elle est recherchée par certains passionnés et trouver un exemplaire de nos jours n’est pas facile."
Peugeot H4. Source : CAMP, Club Autos Miniatures Peugeot La Renault Espace, lancée en 1984 et souvent considérée comme la grande sœur du taxi Heuliez H4, suscite toujours l'intérêt du secteur des transports publics. En 1985, Matra et Renault présentent une version taxi spécialement conçue pour les professionnels. Ce modèle novateur, fonctionnant au GPL grâce à un partenariat avec Primagaz, offre un espace intérieur modulable avec une banquette et des strapontins pour les passagers, séparés du chauffeur par une cloison vitrée. Cette configuration répond à une demande croissante de sécurité, notamment à Paris où les agressions de chauffeurs sont fréquentes. L'Espace taxi se positionne ainsi comme un véhicule moderne et sécurisé, équipé d'alarmes dissuasives, d'un téléphone pour les clients et d'un espace pour les bagages.
Renault Espace taxi. Source : https://www.lespetitesrenault.fr L'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite reste un point à améliorer en raison de la hauteur du seuil. Malgré cette limitation, vingt exemplaires aux couleurs de la Ville de Paris sont livrés à la compagnie G7 en 1986. Ces taxis, fonctionnant au GPL, se démarquent par leur aspect écologique et leurs tarifs identiques aux autres taxis parisiens. Si Matra voit dans l'Espace taxi l'avenir du transport public parisien, la Fédération Nationale des Artisans Taxi y perçoit plutôt une opération de communication. Néanmoins, ce modèle expérimental marque une étape importante dans l'histoire de l'automobile, en démontrant l'intérêt pour des véhicules plus spacieux, plus confortables et plus respectueux de l'environnement.
Renault Espace taxi. Copyright En 1997, Matra vend à l'entreprise publique Petronas une série d'un millier de taxis (teksi, en malais) basés sur la Renault Espace III, destinés à l'agglomération de Kuala Lumpur en Malaisie. L'adaptation du véhicule à sa nouvelle fonction est confiée à Heuliez, qui rehausse l'habitacle et se charge de l'aménagement intérieur. Le projet initial prévoyait 10 000 exemplaires... Aucun badge Renault ne figurait sur cette auto, dont un exemplaire est aujourd'hui exposé au Musée Matra de Romorantin.
Renault Espace / Petronas. Copyright Renault repense la mobilité urbaine en présentant le concept Modus au Salon de l'Automobile de Paris 1994. Ce véhicule polyvalent, issu d'une série de six concept-cars innovants nommés " Les Citadines ", explore de nouvelles solutions pour le transport de personnes et de marchandises. Le Modus se distingue par sa modularité. Sa base en forme de fer à cheval permet de configurer l'intérieur selon les besoins : camion ouvert pour les livraisons, fourgon fermé pour le transport de marchandises ou taxi pour accueillir jusqu'à six passagers. Cette flexibilité en fait un outil bien adapté pour les professionnels et les taxis indépendants. Le poste de conduite est baigné de lumière naturelle grâce à une vaste surface vitrée, tandis que l'équipement embarqué est à la pointe de la technologie pour l'époque : téléphone, fax et système de navigation par satellite Carminat.
Renault Modus Taxi. Copyright Au début des années 1930, les taxis de la capitale britannique sont principalement des modèles français du constructeur Unic, qui a investi ce marché lucratif dès 1906, jusqu'à représenter près de 80 % de la flotte en 1925. L’augmentation des taxes sur les importations et une concurrence accrue ont eu pour conséquence de sortir la marque française de ce marché. Austin présente en 1930 un prototype de taxi issu d'un modèle de grande série qui est validé par l’administration britannique. L'idée émane d'un concessionnaire automobile, Mann & Overton, qui suggère à Austin d'adapter son modèle 12/4 pour en faire un taxi qui réponde aux normes de la profession, notamment un rayon de braquage inférieur à 25 pieds. C'est ainsi que la marque Austin devient en peu de temps le principal fournisseur des compagnies londoniennes. Cette voiture est couramment désignée sous l'appellation High-Lot, en référence à sa hauteur intérieure supérieure à celle qu'offrait la concurrence.
Taxi Austin High-Lot. Copyright Le modèle évolue en 1934, et est alors connu sous la désignation Low Loader, en raison de son aspect moins haut perché. Le châssis a en effet été abaissé. Il ne s'agit plus de la transformation d'un véhicule existant, mais bien d'une création originale. La voiture est vendue sous forme de châssis qu'il faut faire habiller par un carrossier indépendant. Toutefois, l'acheteur peut confier ce travail à Austin, qui travaille avec plusieurs sous-traitants référencés.
Taxi Austin Low Loader. Copyright
Taxi Austin Low Loader. Copyright Austin s'empresse de sortir un nouveau modèle de taxi en novembre 1947, le FX3, en association avec Mann & Overton d'une part, et Carbodies d'autre part. La compagnie de location de taxis Mann & Overton est le principal client. Carbodies assure la construction de la carrosserie, l'assemblage, la finition et la livraison des voitures. Dans la continuité des modèles précédents, le FX3 a une carrosserie à trois portes, avec une plate-forme à bagages ouverte à côté du conducteur. A son lancement, le FX3 est équipé d'un moteur 2,2 litres essence, qui s'avère coûteux en carburant à l'usage. En 1954, Carbodies intègre le groupe BSA, propriétaire par ailleurs de la marque Daimler
Taxi Austin FX3. Copyright L'adoption d'un moteur diesel en 1950 rend plus compétitif le FX3. Ce carburant est moins lourdement taxé. Cette initiative ne revient pas à Austin, mais à l'un des clients propriétaires d'un compagnie de louage de taxi, John Birch, qui a fait installer sur sa flotte de trente voitures un moteur de tracteur distribué par Harry Ferguson, après avoir obtenu l'approbation du Public Carriage Office (PCO), l'organisme de régulation de la profession. John Birch, généreux, commercialise auprès de ses concurrents cette transformation.
Publicité pour la transformation de John Birch. Copyright Austin ne peut rester insensible à cette évolution de la demande et entreprend l'étude de sa propre version diesel. Celle-ci est commercialisée en 1956. La cylindrée reste inchangée à 2,2 litres, mais la consommation baisse d'environ un tiers, passant de 15 à 10 litres aux 100 km. En peu de temps, la version diesel supplante la version essence, et de nombreux propriétaires de FX3 qui n'ont pas succombé à l'offre de Birch convertissent leur voiture à la nouvelle mécanique Austin. Après Londres, d'autres villes adoptent le FX3, et on le voit circuler en abondance dans les rues de Manchester, Birmingham, Glasgow ou Liverpool. Au total, le FX3 est produit à 12 435 exemplaires de 1948 à 1958, dont 7 267 unités vendues à Londres. La réglementation dans la capitale britannique conduit à la réforme des derniers exemplaires en 1968, mais nombre de FX3 poursuivent leur carrière dans d'autres villes de Grande-Bretagne ou dans d'autres pays, car le FX3 s'est aussi vendu en Suède, au Danemark, en Espagne, en Iran, etc ...
Jusqu'à l'avènement du FX4, les taxis anglais ne comptent que trois portes. En effet, la plateforme à bagage restait accessible de l'extérieur, sans grande protection. Copyright Le taxi FX3 dispose de strapontins en vis-à-vis. A contrario, à bord de sa version limousine destinée à un usage civil, la FL1, ils sont positionnés face à la route. De même, la place dévolue à l'avant aux bagages est remplacée par une large banquette et le " taxi sign " disparaît au-dessus du pare-brise.. Le FX4 remplace le FX3 en 1958. Ses lignes plus contemporaines semblent issues d'une union entre une Rolls-Royce Phantom V et une Mini (qui apparaît un an plus tard…). Le designer maison, Eric Bailey, a dû s'y reprendre à plusieurs fois avant que la direction d'Austin ne se résolve finalement à adopter ses esquisses. Comme ce fut le cas pour le FX3, la conception du FX4 est le fruit d'une concertation entre Austin, Mann & Overton et Carbodies. C'est le premier taxi londonien équipé de quatre portes. La tradition de la plateforme destinée aux bagages, exposée aux intempéries, est abandonnée.
Austin FX4. Copyright L'arrivée du FX4 sur le marché est très bien accueillie. Mais la production peine à suivre la demande, en raison d'une montée en cadence laborieuse. Le parc de taxis existant date sérieusement, et le nombre de véhicules autorisés à circuler par le Public Carriage Office tend à s'amenuiser. La limite d'âge, fixée à dix années d'activité depuis 1935, crée une urgence : le parc roulant ne permet plus de répondre aux besoins croissants des usagers londoniens, dans une ville en pleine effervescence. Le FX4 est identifié dans la nomenclature Austin en tant qu'ADO6. La mécanique est identique à celle du FX3. Le FX4 progressera au gré des évolutions des voitures auxquelles il empruntera différents éléments, issus des modèles de BMC puis de British Leyland. Cela concerne aussi bien l'accastillage que les motorisations.
Austin FX4. Copyright Dans le meilleur des cas, un taxi FX4 ne dépasse que légèrement les 100 km/h. Cela n'est pas très important en ville, où il vaut mieux privilégier le couple, et le FX4 n'en manque pas. Il est réputé pour sa capacité à effectuer, malgré ses dimensions imposantes, des demi-tours sans manœuvre dans les rues étroites, le fameux U-turn. Le FX4 est une voiture fiable à l'usage, capable de tourner en 3x8 avec des chauffeurs qui se relaient. Une fois par an, il est soumis à un contrôle technique des plus stricts. Il est solide de conception, avec des traverses qui renforcent le châssis. La carrosserie reçoit de multiples couches de peinture. Les ailes sont boulonnées, ce qui facilite leur remplacement en cas d'accrochage.
Brochure Austin Taxi, 1978. Copyright En 1972, face à l'obsolescence grandissante de son modèle phare, le FX4, et soucieux de pérenniser son activité, Carbodies entame, de manière autonome, la conception d'un successeur baptisé FX5. Pour Carbodies, dont les activités de carrosserie sur mesure, autrefois florissantes, ont considérablement décliné au début des années 1970, la production de taxis représente désormais un enjeu stratégique majeur. L'entreprise réalisait en effet des conversions en cabriolets ou breaks sur base Ford, Triumph, Humber ou Singer. Cependant, alors que le projet FX5 semble sur le point de se concrétiser, avec la commande des outillages de production, il est brutalement interrompu en 1976 par l'arrivée d'un nouveau dirigeant. Ce dernier, soucieux de la rentabilité immédiate et effrayé par les faibles marges prévues, décide d'abandonner ce projet ambitieux. Ce choix s'explique par le succès continu du FX4, malgré son âge et ses caractéristiques techniques désormais dépassées. En l'absence de véritable concurrence, ce modèle continue de bien se vendre auprès des sociétés de louage et des conducteurs indépendants, assurant ainsi à l'entreprise des revenus stables, quoique peu élevés
Brochure Austin Taxi, 1978. Copyright Bien que le projet FX5 ait été abandonné, Grand Lochkhart, nouveau dirigeant de Carbodies, ne renonce pas à l'idée de renouveler le FX4. Afin de limiter les coûts de développement et de bénéficier d'une base technique éprouvée, il décide d'utiliser le Range Rover comme point de départ pour un nouveau modèle, dénommé CR6 en interne. Les études de style, initiées en 1981, mettent en évidence une filiation esthétique avec le célèbre 4x4 de luxe, tout en intégrant de nombreuses pièces de carrosserie spécifiques au monde du taxi. La réalisation de plusieurs prototypes, conçus notamment pour répondre aux nouvelles normes d'accessibilité, témoigne de l'ambition de Carbodies de proposer un véhicule à la fois moderne et adapté aux besoins de la clientèle, et aux récentes obligations d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Néanmoins, les essais menés auprès des futurs utilisateurs ne donnent pas les résultats escomptés. Après cinq années de développement et d'investissements conséquents, le projet CR6 est lui aussi finalement abandonné. En 1982, la British Leyland est en pleine restructuration. Elle a d'autres préoccupations que le FX4, et cède la licence de fabrication à un prix avantageux à Carbodies. Sa production est complètement marginale pour la BL, et sa rentabilité proche de zéro. Cela fait en effet plus de vingt ans que le FX4 roule sa bosse, et sa survie est surtout due à une absence de proposition pertinente pour le remplacer. Parallèlement au taxi traditionnel, Carbodies propose une version Hire Car, avec des strapontins positionnés à la route (et non plus en vis-à-vis) et une finition haut de gamme, destinée aux entreprises, grands hôtels ou particuliers qui souhaitent s'offrir une automobile vraiment marginale. Carbodies accepte enfin de proposer une vraie gamme de teintes en dehors du noir traditionnel. En 1985, Carbodies, sous-traitant historique d'Austin, qui a acheté son indépendance trois ans plus tôt, change de nom et devient LTI, pour London Taxi international, société regroupant les activités de production, de distribution (ex Mann & Overton) et de financement. Au fond, c'est toujours Carbodies qui est à la manoeuvre. D'ailleurs, le V5, équivalent britannique de la carte grise, mentionne bien le nom de Carbodies en tant que constructeur. Les pare-chocs en chrome sont remplacés par de simples pare-chocs en tôle pliée, de teinte noire. C'est plus une nécessité matérielle qu'une réelle envie de modernisation qui préside à ce changement. En effet, les formes d'emboutissage du pare-chocs utilisés par Carbodies sont totalement usées. Cette solution provisoire sera conservée jusqu'à la disparition du FX4. En 1987, LTI décide de moderniser l'habitacle. La mission est confiée à un jeune designer qui reconsidère complètement le compartiment passager et la cabine du conducteur. La planche de bord est nouvelle, constituée d'un ensemble en plastique moulé, comme le propose la plupart des constructeurs automobiles au monde depuis plus de deux décennies. Cette mise à jour plaît, le bouche à oreille fonctionne, et les compagnies de location de taxi passent commande ... Ce remodelage est aussi rendu nécessaire par l'arrivée d'un concurrent, Metrocab. C'est le premier challenger sérieux du FX4 depuis sa naissance. En 1989, LTI annonce l'arrivée d'une nouveau taxi, le Fairway. Point de révolution en vue, au contraire, c'est de nouveau le FX4 et sa carrosserie surannée que l'on retrouve. Si les " vieux " défauts (infiltration d'eau et crissements divers) sont toujours de la partie, un nouveau moteur emprunté au Nissan Terrano améliore nettement l'agrément de conduite. La législation ayant évolué, le Fairway est accessible aux personnes handicapées en fauteuil roulant. En 1990, pour la première fois de sa carrière, le taxi britannique est produit à plus de 3 000 exemplaires. Les versions Fairway Driver de 1992, Fairway Driver Plus de 1993 et Fairway 95 de 1995 permettent de proposer d'ultimes raffinements techniques ou de confort. Le dernier taxi Fairway est produit en août 1997, ce qui permet au FX4 et à ses dérivées Fairway d'afficher l'une des meilleures longévités de l'industrie automobile, presque aussi bien que la Mini Austin dont la carrière fut presque parallèle (1959/2001). Le FX4 est depuis longtemps identifié dans l'inconscient collectif comme étant " le taxis anglais ". C'est devenu une icône de la ville de Londres, au même titre que la cabine téléphonique rouge ou le bus à impérial. Le FL1 était la version civile du FX3, à destination notamment des grands hôtels, des entreprises de pompes funèbres pour transporter les familles et des société de location de voitures avec chauffeur. Naturellement, le FL2 dérive du FX4. Il est dépourvu du fameux " taxi sign ", et bénéficie de nombreux aménagements qui renforcent son aspect luxueux : strapontins dans le sens de la marche, sellerie velours des sièges, accoudoirs, climatisation en option, etc ...
LTI FL2 - Source : https://topcarspecs.com L'exportation n'a jamais été une priorité pour Austin, Carbodies et LTI. Quelques Austin FX4 auraient franchi la frontière hexagonale en 1964, via l'importateur français de l'époque. Mais l'épisode le plus remarquable, est dû à David Lea, un gallois installé en France. Celui-ci a, avec beaucoup de persévérance, entrepris les démarches auprès des autorités françaises pour y homologuer le Fairway. Après plusieurs tentatives vaines, il obtient du service des Mines le procès-verbal de réception par type. Le lancement officiel a lieu en mai 1996 à l'Ambassade de Grande-Bretagne en France. Un réseau d'après vente est structuré en région parisienne. Le Fairway est adapté à notre marché, sous la désignation " Le Cab ", avec un volant installé à gauche, et un " roof sign " remplacé par le panneau lumineux " taxi " aux normes françaises.
LTI Le Cab, importé à l'initiative de David Lea. Copyright Mais l'offre de David Lea ne convainc pas grand monde dans la profession, toujours peu ouverte au changement. Nombreux sont les chauffeurs de taxi à utiliser leur voiture à usage privé durant les jours de repos, et le TX4 n'est pas vraiment adapté à cet usage. Alors que David Lea a mis huit ans à obtenir son homologation en France, LTI annonce l'arrêt de production du Fairway pour 1997 ... L'importateur doit renouveler ses démarches pour homologuer son remplaçant, le TX1. Quelques dizaines de Fairway et TX1 circuleront en France, mais le gallois ne rencontrera jamais le succès auquel il aspirait. D'autres tentatives d'importation ont été menées en Europe et à travers le monde, avec des succès très divers.
L'habitacle luxueusement aménagé sur " Le Cab ". Copyright LTI TX Le TX1, apparu au Salon de Londres en 1997, sous une forme qui demeure classique, constitue un vrai changement. Son constructeur a pourtant longuement hésité entre trois solutions : partir d'un véhicule de série d'un grand constructeur en l'adaptant à sa nouvelle fonction, faire évoluer encore une fois le FX4 au risque de s'enliser, ou opter pour un véhicule moderne rappelant l'allure du FX4. C'est cette troisième voie, qui semblait répondre à une demande forte de la profession, qui a été retenue. Elle permettait de conserver l'image classique du FX4, avec sa silhouette unique et ses rondeurs.
LTI TX1. Copyright Le TX1 s'inscrit dans la mouvance néo-rétro de la fin des années 1990. Le cahier des charges mentionne que le nouveau modèle doit répondre à toutes les exigences modernes de confort, de sécurité et d'équipement, tout en restant parfaitement identifiable en tant que taxi anglais. L'équipement de sécurité est renforcé avec l'ajout d'ABS, d'airbags et d'une structure renforcée. Conçu par le designer britannique Kenneth Grange, le TX1 conserve les lignes générales de son prédécesseur tout en proposant un design plus moderne et aérodynamique. Les phares et les feux arrière sont redessinés, et l'intérieur est repensé pour offrir un espace plus fonctionnel et confortable. Le TX1 est régulièrement commercialisé à partir de 1998. Le châssis est une évolution de celui du Fairway Driver. Les trains roulants sont d'origine Ford, et Nissan fournit le moteur. La réglementation imposant désormais une limite d'âge de quinze ans pour les taxis, le TX1 remplacent petit à petit les derniers TX4 en circulation. Le TX1 devient TX2 en 2002 avec l'adoption d'un nouveau moteur Ford, en phase avec les récentes normes antipollution, plus puissant et plus coupleux. L'aspect général est inchangé. Hélas, sa carrière est entachée par des problèmes de vibrations mécaniques, et par des soucis électriques récurrents. Ceux-ci portent un sérieux coup à la réputation et aux ventes du TX2.
LTI TX2. Copyright Le TX4 succède en 2007 au TX2. Pourquoi TX4 et non pas TX3. Le TX4 répond aux récentes normes antipollution Euro 4 de 2006. Son moteur diesel 2 499 cm3 est fabriqué par VM Motori, du groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Et puis TX4, cela sonne comme FX4. Il serait dommage de se priver d'une telle référence. Visuellement, le TX4 se distingue par sa calandre toute en hauteur. L'aménagement intérieur a fait l'objet de diverses améliorations. Une fois encore, le TX4 n'est pas dépourvu de défauts. L'habillage intérieur fait appel à des matériaux de qualité moindre qui se détériorent dans le temps, la mécanique présente des défaillances. Plusieurs TX4 prennent feu, contraignant LTI à rappeler 500 véhicules.
LTI TX4. Copyright Mitsuoka Motor, fondé en 1968, était à ses début un importateur automobile japonais. Il est aussi connu depuis la fin des années 80 pour construire des voitures au style peu conventionnel, souvent inspirées par les productions européennes des années 1950 et 1960 (Porsche, Jaguar, Riley, Lotus ...). Le taxi britannique est devenu iconique au Japon. Mitsuoka qui en assure parallèlement l'importation propose la Yuga en 2001 et 2002, une interprétation libre du taxi londonien sur la base du Nissan Cube de première génération. Toute la partie avant est redessinée, avec une grande calandre chromée et des phares arrondis. Le passage à une deuxième génération de Cube met fin à la carrière de ce modèle.
Mitsuoka Yuga. Copyright En janvier 2007, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de LTI approuve la création d'une coentreprise avec le constructeur chinois Geely, pour fabriquer le TX4 en Chine à partir de juillet 2008, à l'exception des TX4 destinés au marché britannique qui restent produits à Coventry jusqu'en 2011. London Taxis International (LTI) devient The London Taxi Company (LTC). En août 2010, Geely commence à fournir l'usine anglaise en SKD (semi-knocked-down). En janvier 2013, Geely, qui a par ailleurs racheté Volvo à Ford en 2010, reprend intégralement LTC, qui est en redressement judiciaire. La nouvelle société prend le nom de The London Taxi Corporation Ltd. Les derniers exemplaires du TX4 sont assemblés en 2017.
Le TX4 produit en Chine par The London Taxi Company. Copyright The London Electric Vehicle Company TX5 The London Taxi Corporation, désormais rebaptisée The London Electric Vehicle Company (LEVC), dévoile en 2015 le TX5, digne héritier du TX4. Conçu dans les studios de design de Geely à Barcelone, ce modèle est plus haut et plus large que son prédécesseur. Fabriqué à partir de 2017 à Ansty, à quelques kilomètres du siège historique de Carbodies à Coventry, le TX5 est alimenté par un moteur électrique Siemens, secondé en cas de nécessité par un trois cylindres essence de 1,5 litre d'origine Volvo. Curieusement, les portes " suicide " ont fait leur retour. Cette nouvelle génération de taxis répond à la réglementation londonienne, qui a interdit la mise en circulation de nouveaux taxis diesel depuis janvier 2018. En avril 2022, plus de 5 000 véhicules TX avaient été vendus à Londres, soit environ un tiers de la flotte de taxis. On retrouve le TX5 dans de nombreuses villes à travers le monde, notamment à Paris.
Le TX5 produit près de Coventry par la London Electric Vehicle Company. Copyright Morris est présent sur le marché des taxis depuis 1929 avec les types G (1929/1932), G2 Junior (1932/1937) et Super Six (1937/39). A l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le parc de taxis londoniens est décimé. Nombreux sont ceux qui ont été détruits durant les bombardements, et les exemplaires qui y ont échappé sont à bout de souffle, en raison des difficultés à les entretenir durant cette période sombre. Le groupe Nuffield constitué avant-guerre par l'absorption successive par William Morris (1877/1963) des marques Wolseley, Riley et MG termine alors le développement d'un prototype conçu en 1940 par Wolseley, et longuement testé pendant la guerre. L'industriel va bénéficier de conditions favorables pour lancer sa production, car il est nécessaire de renouveler au plus vite la flotte des taxis londoniens. Pour disposer de matières premières, il n'est notamment pas contraint à des quotas d'exportation pour ce modèle.
Nuffield / Morris Oxford. Copyright Le Nuffield Oxford ou Morris Oxford est lancé en 1947. Sa production est transférée à l'usine Nuffield d'Adderly Park en 1948. La distribution, la vente et l'entretien sont assurés par Beardmore Motors, qui a cessé la production de sa propre marque de taxis avant le déclenchement de la guerre. Le PCO, qui considère que les carrosseries de type landaulet ne répondent plus aux exigences en matière de sécurité, a imposé une berline fermée. Le taxi Morris Oxford est doté d'une structure traditionnelle en bois. Cela obère évidemment son coût de production comparé aux carrosseries tout acier de plus en plus nombreuses sur le marché. Il est animé par un quatre cylindres essence de 1802 cm³. Il est choisi pour transporter des invités lors du mariage de la princesse Elisabeth, héritière du trône d'Angleterre, avec Philip Mountbatten, à l'abbaye de Westminster en novembre 1947. Avec la création de la British Motor Corporation (BMC) en 1952, née de la fusion de Morris Motors, la société holding des activités de production de Nuffield, avec Austin, la Morris Oxford se retrouve en concurrence directe avec l'Austin FX3, plus moderne. Face à cette concurrence interne, la production du Nuffield Oxford est arrêtée en 1953 après 1 926 exemplaires, laissant le champ libre à l'Austin FX3
Nuffield / Morris Oxford. Copyright Beardmore, ce n'est pas seulement une marque automobile, c'est avant tout un conglomérat industriel écossais fondé en 1886, dont les activités s'étendent sur les secteurs ferroviaire, naval et d'armement. Fort de sa puissance industrielle, Beardmore se lance dans l'automobile en 1919, en proposant des véhicules spécifiquement conçus pour la profession de taxis. Contrairement à la pratique courante qui consiste à adapter des châssis existants, Beardmore conçoit dès le départ des véhicules carrossés et prêts à l'emploi. Cette approche innovante lui permet de s'imposer rapidement sur le marché londonien, où ils couvrent près de la moitié des besoins au début des années 1920. Sa réputation est telle qu'on le surnomme la " Rolls-Royce des taxis ". Malheureusement, la crise de 1929 emporte la maison mère. Seule la branche automobile, Beardmore Motors Company, survit grâce à son rachat par ses directeurs. Cependant, la marque ne parvient pas à se renouveler et ses modèles deviennent obsolètes face à la concurrence de Morris et Austin, plus dynamiques et mieux structurés. Beardmore tente de réagir en lançant différents modèles : Mk VI en 1938, Mk VII en 1954. Mais ces efforts sont insuffisants. Au moment de développer son prototype Mk VIII, Beardmore est confronté à un problème majeur : l'absence de commandes régulières d'une compagnie de location. Sans ces commandes, il est impossible de financer les investissements nécessaires à la production. La concurrence du FX4, soutenu par Mann & Overton, partenaire historique d'Austin et Carbodies, est trop forte. Beardmore, affaibli, disparaît en 1963.
Beardmore. Copyright La Westminster Motor Insurance Group, mutuelle britannique toujours active à ce jour, s'est historiquement spécialisée dans l'assurance des chauffeurs de taxi. Fondée dans les années 1930 par l'Owner Drivers Society, elle visait à offrir à ses membres une protection juridique et des contrats d'assurance adaptés. Après la Seconde Guerre mondiale, face au quasi-monopole d'Austin et à l'augmentation constante de ses tarifs pour les réparations et les pièces détachées, la mutuelle cherche une solution. Elle ambitionne de créer son propre modèle de taxi pour maîtriser les coûts. Cependant, la marque Westminster est déjà déposée par Austin, qui l'utilise pour un de ses modèles haut de gamme entre 1954 et 1968. L'assureur contourne cette difficulté en baptisant son taxi Winchester, du nom d'une autre ville anglaise. Une nouvelle entité est créée à cet effet, la Winchester Automobiles Ltd, basée à Londres. En 1963, un premier modèle est proposé. Son châssis est le même que celui utilisé par Bearmore et Morris, les trois compagnies ayant recours au même sous-traitant, Rubery Owen. La fabrication de la carrosserie en matière synthétique est confiée à James Whiston, plus spécialisé dans les véhicules de transport en commun. Le moteur 4 cylindres est fourni par le britannique Perkins. Le résultat est un taxi peu convaincant : finitions laissant à désirer, mécanique bruyante, position de conduite mal étudiée. Son prix de vente est à peine inférieur à celui du FX4, modèle de référence du marché. Seule une dizaine de voitures trouve preneur, la clientèle préférant la qualité et la fiabilité éprouvées du FX4. En 1965, la version Mk II apporte des améliorations. La marque change de fournisseur pour les carrosseries, Wincanton Engineering remplaçant James Whiston. Le moteur Perkins est remplacé par un bloc Ford de 1,5 litre, et la boîte de vitesses est celle de la Cortina Lotus. Malgré ces améliorations, le succès commercial n'est pas au rendez-vous, avec une quarantaine de voitures assemblées en deux ans. Winchester, ayant peu de poids face à ses fournisseurs, doit s'adapter à leurs aléas de production. Ainsi, en 1967, la marque se tourne vers un ensemble mécanique emprunté au Ford Transit, la carrosserie restant inchangée. Une quarantaine d'exemplaires sont encore assemblés en deux ans.
Winchester Mk 1, 1963. Copyright Avec la version Mk IV de 1969, Winchester opère une transformation significative. Le style désordonné du modèle initial est révolu. La marque aborde les années 1970 avec des lignes plus anguleuses et modernes, se démarquant du traditionnel FX4. Wincanton Engineering continue de fabriquer les carrosseries, tandis qu'un nouveau partenaire, Keywest Developments, prend en charge l'assemblage. Le châssis est entièrement repensé et renforcé, évoquant davantage un châssis de véhicule utilitaire que celui d'une voiture particulière. Ford demeure le fournisseur des éléments mécaniques, et de nombreux accessoires tels que les phares, les clignotants et les feux arrière sont issus de divers modèles du constructeur américain. Cependant, malgré ces améliorations, les ventes demeurent insuffisantes pour assurer la rentabilité de l'entreprise. L'aventure commerciale de Winchester s'achève en 1971, après la production de seulement 54 exemplaires de la Mk IV. Paradoxalement, la Mk IV était enfin au point. Alors que le projet émanait d'une association de chauffeurs, peu d'entre eux prennent le risque d'acquérir ce modèle. Ils hésitent à essuyer les plâtres d'une mise au point potentielle et s'interrogent sur la capacité du constructeur à assurer un entretien et des réparations adéquats. Désormais, le FX4 règne en maître sur le marché.
Winchester Mk IV, 1963 - Source : Peter Braclay - https://www.flickr.com La firme Metro Cammel Weymann (MCW), fondée en 1932, se spécialise dans la fabrication de carrosseries de bus et de rames de métro. À la fin des années 1960, elle s'appuie sur le taxicab Beardmore pour concevoir une voiture plus moderne et aboutie. Deux prototypes, baptisés Metrocab, sont construits en 1970, mais l'étude de faisabilité industrielle n'aboutit pas. Au début des années 1980, le projet refait surface. Une partie de la profession s'agace du monopole du FX4, assemblé par Carbodies, et critique les tarifs des pièces et de l'entretien. Le FX4 est vieillissant, mais son fabricant ne semble pas s'en soucier, car il se vend sans difficulté en l'absence de concurrence. Une petite équipe, composée de deux personnes, sans réel budget, est constituée. S'appuyant sur les travaux réalisés en 1970, un premier prototype voit le jour en 1984, suivi d'un second, plus abouti esthétiquement et plus proche de la version définitive. MCW, spécialisée dans la carrosserie, possède une expérience limitée dans le travail de la fibre de verre. Elle fait appel à Reliant, constructeur réputé de voitures à trois roues et du coupé Scimitar, qui maîtrise ce matériau depuis près de trente ans.
Reliant Metrocab. Copyright Le taxi Metrocab est commercialisé en 1987. Il est immédiatement plébiscité par les professionnels et les usagers pour son confort, son vaste espace intérieur et sa visibilité, supérieure à celle du FX4. Ses lignes modernes sont cependant jugées banales, et plusieurs éléments sont empruntés à des modèles de série, comme les phares de la Ford Granada et le bloc compteur de l'Austin Montego. En 1989, le propriétaire de Metrocab, malgré des résultats positifs, annonce son intention de vendre l'entreprise. Après quelques difficultés, Reliant rachète finalement Metrocab en 1989 et rapatrie la production sur son site historique de Tamworth.Cependant, Reliant, confronté à de sérieuses difficultés financières au début des années 1990, abandonne à son tour le Metrocab. C'est la prestigieuse maison Hooper qui reprend l'affaire.
Reliant Metrocab. Copyright Le carrossier Hooper des années 1990 n'est plus celui des années 1950, mais le Metrocab continue à bien se vendre sous sa direction. La production est assurée par une équipe d'une vingtaine de personnes, et des améliorations sont apportées au fil du temps : moteur Ford plus économique et moins polluant, nouvelles teintes de carrosserie, nouvel habillage intérieur, possibilité d'accueillir un sixième passager, etc ... Dans les années 1990, le Metrocab devient une alternative crédible au FX4, s'octroyant environ 25 % du marché londonien. En 2000, pour anticiper la nouvelle norme Euro 3, le Metrocab adopte une nouvelle mécanique Toyota en remplacement de l'ensemble Ford. La concurrence est rude avec le TX1, qui regagne des parts de marché. Les ventes baissent à une dizaine de voitures par semaine, ce qui compromet l'équilibre financier de Metrocab, qui dépose son bilan en 2003. Une société basée à Singapour, KamKorp Europe Ltd, rachète Metrocab. Mais les ventes sont très faibles, avec seulement un ou deux véhicules produits par semaine. Le dernier Metrocab est fabriqué en avril 2006, marquant la fin du dernier concurrent crédible de LTI. En 2015, Kamkorp, propriétaire de la marque Metrocab depuis 2004, tente de relancer la marque de taxis londoniens. Sa filiale Ecotive Ltd. conçoit un tout nouveau modèle électrique, le New Metrocab. Équipé de deux moteurs électriques dans les roues et d'un moteur thermique destiné à recharger les batteries en cas de nécessité, ce taxi est immédiatement reconnaissable comme un successeur des emblématiques Carbodies et LTI, et plus sûrement encore du TX5 de la LEVC.
New Metrocab. Copyright Justement, The London Electric Vehicle Company intente un procès pour contrefaçon. Bien que Kamkorp gagne ce procès après trois ans de procédure, l'attaque bloque l'industrialisation du New Metrocab, dont on ne verra que quelques modèles de pré-série dans les rues de Londres en phase de test auprès de quelques cabbies (chauffeurs de taxi).
New Metrocab. Copyright Fondée en 1872, Lucas est un fabricant renommé de composants pour l'industrie automobile et motocycliste. Cette entreprise britannique, souvent brocardée par les humoristes anglais pour la fiabilité parfois aléatoire de ses produits, présente au Salon de Londres en 1975 un prototype de taxi électrique. La réalisation de ce véhicule a été confiée à Ogle, un studio de design et carrossier britannique qui s'est illustré dans les années 1960 en collaborant notamment avec Reliant. C'est sur le stand de ce dernier que le public découvre cette surprenante voiture. Grâce à son moteur transversal installé entre les roues avant, le Lucas CAV mesure près d'un mètre de moins que l'Austin TX4, tout en offrant une habitabilité similaire. Un avantage considérable dans une ville congestionnée comme Londres, où un plus grand nombre de taxis pourrait circuler dans un même espace. Son rayon de braquage, inférieur à 7,62 mètres, respecte les normes imposées dans la capitale britannique.
Lucas Electric Taxi. Copyright Ingénieux, le système de batteries positionnées sur un rack permet un retrait facile après usage et un remplacement immédiat par un autre ensemble fraîchement rechargé, évitant ainsi toute immobilisation du véhicule. Cependant, le marché n'est pas encore mûr pour la voiture électrique, et le prix de vente annoncé constitue rapidement un frein à l'avancement du projet. Lucas voit surtout dans ce prototype un moyen de tester ses propres inventions. Si l'étude d'une production en série avait été envisagée, il aurait alors été nécessaire de faire appel à un sous-traitant. Les deux prototypes assemblés serviront de véhicules laboratoires pour Lucas, et de vitrine technologique pour la firme lors de différents salons.
Lucas Electric Taxi. Copyright Au Salon de Genève 1955, Fiat lance la 600, un coach quatre places à moteur arrière. Elle rejoint alors les rangs des Renault 4 CV et VW Coccinelle, qui sillonnent les routes d'Europe. Le succès est immédiat, car l'Italie accuse un certain retard sur ce segment, et la 600 apparaît comme la voiture que le public attendait. Son dérivé, la Fiat 600 Multipla, présentée au Salon de Bruxelles au début de l'année 1956, peut être considérée comme l'ancêtre des monospaces. Elle est aussi la digne héritière des Burney Streamline et Stout Scarab des années 1930, ou encore des modèles présents lors du concours de taxis de 1945. Son aspect atypique ne manque pas de surprendre le public. Avec ses 3,53 mètres de long, elle peut transporter jusqu'à six personnes, répondant ainsi aux besoins des familles nombreuses. Sa carrosserie est dotée de quatre portes, dont les deux à l'avant sont du type " suicide ". Le moteur de 633 cm3, développant 19,5 ch Din, est installé en position arrière, couplé à une boîte dont le rapport de pont a été raccourci pour compenser l'augmentation de poids. Malgré ses efforts, ce moteur se révèle un peu juste pour entraîner la Multipla, et celle-ci est plus à l'aise dans les agglomérations encombrées que sur les routes de montagne.
Fiat Multipla. Copyright L'implantation du moteur de la Fiat 600 Multipla, à l'arrière, contraint les concepteurs à repousser au maximum l'habitacle vers l'avant, ce qui ne laisse aucune place pour un coffre à bagages. La partie avant, très verticale, contraste avec l'arrière en pente. Certains, avec une pointe d'humour, suggèrent même de rouler en marche arrière pour améliorer l'aérodynamisme. La version taxi, particulièrement appréciée en Italie, offre un siège conducteur, une banquette et deux strapontins. Le train avant, différent de celui du coach, est issu de la Fiat 1100, tandis que la direction est spécifique à ce modèle, en raison de la cabine avancée. Sa consommation étant légèrement supérieure, la Multipla est équipée d'un réservoir de 29 litres. En 1960, la 600 évolue et devient 600 D. Sa cylindrée passe alors à 767 cm3, et avec 25 ch DIN, elle atteint désormais 105 km/h, contre 90 km/h auparavant. Sa carrière honorable s'achève en 1965, quatre ans avant celle du coach 600, avec une production d'environ 150 000 unités. Bernard Carat, dans son essai de la Multipla pour l'Auto Journal du 15 mars 1958, conclut : " Ses places arrière, sa maniabilité, ses faibles dimensions et sa consommation peu élevée devraient tout naturellement la désigner pour être le taxi " européen " de demain. "
Fiat Multipla. Copyright A la fin des années 1960, alors que la circulation urbaine devient un casse-tête dans les grandes villes italiennes, Fiat se penche sur la conception d'un taxi urbain. L'objectif : un véhicule capable d'accueillir passagers et bagages dans un espace restreint. Pour mener à bien cette étude, Fiat fait appel au jeune et talentueux designer Pio Manzu, qui collabore avec le Centro Stile Fiat. Pio Manzu s'est illustré en remportant, en 1963, un concours de carrosserie organisé par " L'Année Automobile ". En 1965, il a conçu l'Autonova, un prototype de 3,50 mètres de long avec quatre portes, basé sur une Glas 1300. Ce projet préfigurait déjà l'intérêt de Manzu pour les solutions innovantes, notamment avec une version taxi à porte coulissante.
Autonova. Copyright La Fiat 850, avec son moteur arrière, apparaît comme la candidate idéale pour ce projet de taxi urbain. Elle bénéficie des recherches menées pour l'Autonova. Le cahier des charges est précis : la voiture doit être compacte, maniable, facilement identifiable, offrir un excellent rapport encombrement/volume utile et une bonne visibilité. Présentée au Salon de Turin en 1968, la Fiat 850 City surprend par son asymétrie. Le côté conducteur reçoit une porte classique, tandis que le côté passager se voit doté d'une large porte coulissante pour faciliter l'accès. À l'intérieur, une multitude d'idées originales sont mises en œuvre pour optimiser l'accueil des passagers et de leurs bagages. Un strapontin escamotable près du conducteur peut être relevé pour agrandir l'espace dédié aux bagages.
Fiat 850 City. Copyright Longue de 3,25 mètres, large de 1,45 mètre et haute de 1,60 mètre, la 850 City affiche un style hésitant entre modernisme (lignes droites) et tradition (phares ronds, planche de bord classique). Pas moins de quinze brevets sont déposés pour ce prototype unique. Malgré son ingéniosité, la Fiat 850 City ne dépassera jamais le stade du prototype. Pio Manzu décède tragiquement en 1969, à seulement 30 ans, au volant de sa voiture, en se rendant sur son lieu de travail.
Fiat 850 City. Copyright Rayton Fissore Taxi pour Turin Londres a son Black Cab et Chicago son Checker. Pourquoi la ville de Turin n'aurait-elle pas son taxi à elle ? C'est dans cette optique que Tom Tjaarda se lance dans ce type d'étude. Le prototype basé sur une mécanique de Fiat Ritmo est présenté aux autorités de la cité. C'est un véhicule court, haut et fonctionnel. Le projet prévoit une séparation entre le conducteur et les passagers. Les formes de la carrosserie et des vitres sont plates. L'outillage à mettre en oeuvre pour une production en petite série serait assez simple. Ce prototype adopte la technique de production brevetée Univis par Rayton Fissore. De nouveau, les efforts du carrossier pour convaincre les autorités restent vaincs.
Rayton Fissore Taxi. Copyright Ce projet de 1993 est le résultat d'une collaboration entre un étudiant de Royal College of Art de Londres et le constructeur japonais Mazda. Outre le conducteur, Il n'est prévu pour accueillir un seul passager, à une époque où l'on évoquait déjà les futures restrictions de circulation dans Londres. Cette automobile n'a jamais eu le privilège d'une présentation sur un Salon.
Mazda London Taxi Concept. Copyright La
Toyota Comfort, berline de taille moyenne produite de 1995 à 2018, a été
spécialement conçue pour les flottes de taxis. C'est un dérivé de la
plate-forme de la Toyota Mark II (X80). Elle a rapidement conquis le
marché japonais grâce à sa fiabilité et son faible coût d'entretien,
devenant un symbole des grandes villes du pays. Sa mécanique est
dimensionnée pour être increvable, et nombreuses sont les Comfort à avoir
dépassé les 400 000 km sans intervention majeure. Disponible en deux
modèles, Comfort et Crown Comfort à empattement long, elle est équipée
d'un moteur 2 litres essence ou diesel, et proposée avec une transmission
manuelle à cinq vitesses ou automatique à quatre vitesses. Bien que
fonctionnelle et spacieuse, la Comfort a vu sa production cesser en 2017
au profit de la Toyota JPN.
Toyota Comfort. Copyright Toyota présente en octobre 2017 au Salon de Tokyo la version définitive du taxi JPN (Comme Japan), dérivée du concept du même nom découvert au Salon de Tokyo en 2013. Ses lignes classiques puisent leurs inspiration auprès de productions britanniques de Carbodies ou LTI, ce qui permet d'identifier d'emblée sa fonction . Trois couleurs sont inscrites au catalogue : noir, blanc et un indigo.
Toyota JPN. Copyright Dans le cadre de l'étude de la Toyota JPN, une équipe d'ingénieur a adopté le principe du " genchi genbutsu ". Cela s'est traduit par une immersion dans le monde des taxis, pour valider des besoins. Ils ont observé les compagnies de taxis, les services sociaux et consulté des experts à travers le Japon. Les enquête ont été menées dans les grandes villes, dans les lieux attirants de nombreux touristes, dans les hôpitaux ... Ces ingénieurs ont même accompagné les chauffeurs pour vivre leur quotidien, tout cela dans le but de développer le meilleur taxi.
Du concept car JPN au modèle de série. Copyright Toyota n'a jamais eu d'ambitions particulières à l'exportation, même si l'on croise quelques JPN à Hong Kong et en Thaïlande. Ceci dit, il ne dépareillerait pas dans les rues de Londres aux côtés des LEVC TX5. Le JPN se veut donc facilement accessible à tous, notamment des personnes âgées ou à mobilité réduite. Il dispose d'une rampe d'accès. Le coffre peut accueillir un fauteuil roulant.
Toyota JPN. Copyright Le plancher bas et plat facilite la montée et la descente du taxi, tout comme la porte arrière latérale coulissante à large ouverture et à commande électrique, à gauche uniquement, donc côté trottoir au Japon. Le JPN Taxi offre au conducteur un champ de vision optimal, grâce à la forme et à la position innovantes des montants de pare-brise, ainsi qu’à l’implantation des rétroviseurs sur les ailes.
Du concept car JPN au modèle de série. Copyright Il est doté d'une motorisation hybride électrique. Toyota visait un objectif mensuel de 1 000 ventes au Japon. En mai 2018, le taxi JPN représente environ 10 % de la flotte des taxis à Tokyo, tandis que le modèle traditionnel Comfort est encore en situation de force avec environ 70 % des taxis en circulation. Avec l'abandon progressifs des Comfort, le paysage automobile des grandes villes japonaise va évoluer au profit du JPN.
Toyota JPN. Copyright
Voir aussi : http://leroux.andre.free.fr/jmpchecker.htm et https://didiertougard.blogspot.com Deux compagnies de taxi tiennent le marché de Chicago dans les années 1910, la Yellow Cab Company fondée en 1907 par John Daniel Hertz (oui, le loueur), et la Checker Taxi of Chicago. Les voitures sont achetées aux grands constructeurs et aménagées pour leur nouvel usage. Mais l'utilisation intensive des véhicules fait souffrir les mécaniques qui s'usent vite. Checker réagit, et signe en 1920 un contrat avec la Commonwealth Motor Co, un petit constructeur implanté à Joilet dans l'Illinois (banlieue de Chicago) depuis 1908. Celui-ci se charge d'assembler un taxi répondant aux besoins de son donneur d'ordres, à partir de caisses fournies par une autre firme de Joilet, la Markin Auto Body Corp, propriété d'un certain Morris Markin. Markin est né en 1893 à Smolensk en Russie. Il a fuit la misère pour rejoindre l'Amérique en 1912. A partir de 1921, Markin rachète peu à peu les actions de Checker, jusqu'à en prendre le contrôle total en 1937. Ainsi naît la Checker Cab Manufacturing Co.
Checker Model G6, 1928. Copyright En peu de temps, Checker devient le spécialiste incontesté de ce type de véhicule aux Etats-Unis. On compte déjà 600 Checker dans les rues de New York en 1923. Checker déménage en avril 1923 dans une nouvelle usine à Kalamazoo dans le Michigan, qui emploie près de 700 personnes, qui produisent chaque année près de 4 000 voitures. D'autres constructeurs émergent, qui aimeraient prendre leur part du gâteau. L'adoption d'un freinage hydraulique sur la série K fin 1928 permet à Checker de surclasser la concurrence. La marque devient omniprésente dans les plus grandes métropoles américaines. Certes, elle n'a pas le monopole, mais ses voitures ont la préférence des autres grandes compagnies de taxis, notamment sa plus ancienne rivale, la fameuse Yellow Cab, que Morris Markin finit par racheter en 1929.
Checker Model A, 1940. Copyright La crise de 1929 épargne Checker, qui en profite pour reprendre deux autres compagnies concurrentes, Parmelee Transportation et Motor Cab Transportation Compound, qui comptent l'une et l'autre plusieurs milliers de taxis. Un peu trop gourmand, Checker se trouve fragilisé à son tour. C'est un petit face à son principal concurrent, la General Motors, qui n'hésite pas à faire du dumping pour s'approprier ce marché. Checker fait le dos rond, et axe son développement sur un service après-vente impeccable. En 1931, Checker est à l'origine de la création de l'Empire Cab Association, dont la vocation est de défendre les professionnels dans un contexte de crise. Cet engagement lui vaut une certaine popularité. La période est difficile, et une réorganisation est menée sous le contrôle d'Errett Lobban Cord, qui prend le contrôle de Checker en août 1933. Cord se retire en 1937, en laissant de nouveau les pleins pouvoirs à Morris Markin. Durant la guerre, l'usine de Kalamazoo est réquisitionnée pour produire des remorques, des citernes, des véhicules de servitude et autres matériels destinés à l'US Army. Checker sort affaibli de la guerre, et il faut attendre 1948 pour voir apparaître une nouvelle génération de taxis aux formes galbées caractéristiques de la période. Le 6 cylindres fourni par Continental est si peu poussé qu'il ne tombe quasiment jamais en panne. Checker, pour se relancer, s'appuie sur la réputation de robustesse, de fiabilité, de confort et de facilité d'entretien de ses taxis.
Checker A5, 1950. Copyright Le Checker A8 est proposé en 1956, plus moderne d'aspect, dans l'esprit des Ford et Chevrolet contemporaines. Aussi fiable que ses prédécesseurs, l'A8 se contente d'un entretien minimum et peut aligner des centaines de milliers de miles. Les suspensions sont renforcées, le freinage et la direction sont assistés, les pare-chocs, identiques à l'avant et à l'arrière, se remplacent facilement.
Checker A8, 1956. Copyright Le tableau de bord ne fait l'objet d'aucun raffinement. Il est juste fonctionnel, la transmission automatique est disponible en option. Le Checker devient indissociable de l'image du taxi new-yorkais. Sa consécration vient en 1976 avec le film Taxi Drivers, dont il est le héros avec Martin Scorcese.
Checker Model A8, 1956. Copyright
Checker Model A8, 1956. Copyright En 1960, Checker tente de s'ouvrir au-delà du seul marché des taxis, forcément limité, et propose une version mieux finie de l'A8, avec un épais catalogue d'options. Le constructeur souhaite intéresser la clientèle des gros rouleurs, attirée par la fiabilité exceptionnelle du Checker, et indifférente aux effets de mode, avec une carrosserie qui restera en effet quasiment inchangée pendant plus d'un quart de siècle. Cette situation est exceptionnelle dans un pays où la frénésie de consommation démode une automobile d'une année sur l'autre. Cette tentative ne rencontre guère de succès. Alors Checker développe des dérivés : limousines, station wagon et Aerobus à six ou huit portes latérales.
Checker Model A8, 1956. Copyright En 1959, les optiques sont dédoublés à l'avant. l'A8 devient l'A9. Checker propose à partir de 1965 des mécaniques Chevrolet, soit un 6 cylindres de 140 ch, soit un V8 de 195 ch. La production atteint son apogée, avec environ 6 000 unités par an. Les moyens manquent pour étudier une nouvelle voiture, qui apparaît pourtant indispensable pour assurer la pérennité de l'affaire. En 1968, c'est Ghia qui prend l'initiative, et propose sa propre interprétation du Checker, fonctionnelle et modernisée, dénommée Centurion. Mais Checker n'a pas les moyens de répondre à l'appel du pied du carrossier italien. David Markin prend la succession de son père à son décès en 1970, mais le constructeur de Kalamazoo est déjà sur le déclin.
Ghia Centurion, 1968. Copyright Ford et General Motors proposent des versions taxis de leurs grandes berlines de série. Ces modèles, bien conçus et vendus à des prix inférieurs à ceux des Checker, sont plus modernes et économiques à l'achat. La popularité de Checker auprès des professionnels et du public s'étiole. Les ventes du taxi Checker, totalement dépassé, deviennent insuffisantes. Son quasi-monopole sur le marché du taxi américain n'est plus qu'un lointain souvenir.
Checker Model A9, 1961. Copyright En 1973, les pare-chocs sont constitués de grossières traverses en aluminium pour répondre aux récentes normes de sécurité. Ils sont certes moins chers à fabriquer que les éléments chromés, mais ils enlaidissent la voiture. Le dernier Checker de type A11 sort de chaîne le 12 juillet 1982. L'usine se reconvertit alors dans des travaux d'emboutissage et d'assemblage pour l'industrie automobile, notamment la General Motors. Environ 250 000 taxis Checker ont été produits en soixante ans. Le 27 juillet 1999, le dernier Checker encore en service à New York est retiré de la circulation. Checker, simple sous-traitant automobile, fait faillite en janvier 2009.
Checker Model A11, 1974. Copyright The Taxi Project, Realistic Solutions For Today L'exposition " The Taxi Project : Realistic Solutions For Today " s'est déroulée au Museum of Modern Art (MoMA) de New York du 16 juin au 7 septembre 1976. Emilio Ambasz, conservateur du département d'architecture du MoMA, en a assuré la coordination. 170 000 taxis sont en service aux États-Unis, assurant près de 2,5 milliards de transports par an. Rien qu'à New York, on enregistre près de 800 000 trajets quotidiens. Les taxi Checker côtoient de grandes berlines, plus adaptées à un usage familial en zones suburbaines ou rurales que dans les rues encombrées des métropoles. Ces berlines sont de plus en plus basses, ce qui complique l'accès à bord, en particulier pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. Le taux d'occupation des taxis est faible : en moyenne 1,5 passager par course, et souvent une seule personne à bord, le conducteur, pendant plus de la moitié du temps de service. Sur le plan économique, ce modèle manque d'efficacité. Les émissions de CO2 sont élevées et ces véhicules occupent de vastes surfaces pour circuler et stationner. C'est à partir de ces constations que le département d'architecture et de design du Moma a suggéré l'organisation de cette exposition. Celle-ci a mis en lumière l'inadéquation entre les besoins de transport urbain et les solutions existantes. Elle a invité à réfléchir à des alternatives plus efficaces, économiques et écologiques pour le futur du transport par taxi. Un cahier des charges a été rédigé en concertation avec les représentants des flottes de taxis avant de solliciter les constructeurs. Les critères de conception des prototypes incluaient la sécurité et le confort des conducteurs, la communication avec les passagers, la facilité de chargement et déchargement des bagages, le confort et l'espace pour les usagers, et l'accessibilité aux poussettes et fauteuils roulants. Ces véhicules devaient contribuer à la réduction de la pollution et optimiser l'habitabilité par rapport à leur taille. Plus qu'un exercice académique, l'objectif a été de concevoir des véhicules pour un usage professionnel quotidien. Le Musée a mis l'accent sur une approche pragmatique : le véhicule doit être produit en série aux États-Unis à un coût raisonnable, tout en respectant le cahier des charges. Cette démarche s'est inscrite dans une initiative du MoMA, débutée en 1936, qui vise à associer industrie, autorités et public, en tenant compte des questions environnementales. Ford, General Motors, Chrysler et AMC ont été contactés dans un premier temps. La consultation a ensuite été étendue à des constructeurs comme Checker et Mack Trucks, et à des sociétés liées de différentes manières (moteurs, tracteurs agricoles ...) à tout ce qui roule : General Electric, Westinghouse Electric, International Harvester, Cummins Engine .... L'accueil de ce projet auprès des industriels a été on ne peut plus mitigé, aucun ne voyant l'intérêt de s'y engager. Evidemment, ses promoteurs étaient déçus, constatant la vision à court terme des Américains, et leur manque d'ambition. Le département des transports a lancé un appel d'offres, et mis des fonds à dispositions des candidats. L'objectif restait de confier à deux sociétés américaines la conception d'un taxi à faible émission. American Machine & Foundry (AMF) et Steam Power Systems Inc (SPS) ont remporté cet appel d'offre. AMF est le propriétaire de Harley Davidson depuis 1969 et produit toutes sortes d'équipements sportifs (tennis, football, golf ...), tandis que SPS a pour vocation l'exploitation de la vapeur. Faute d'intérêt des constructeurs américains, les marques européennes susceptibles de produire un tel taxi aux Etats-Unis ont été contactées. Celles-ci se sont montrées bien plus ouvertes d'esprit, voyant là une opportunité à saisir pour le développement de leurs affaires. Volvo et Volkswagen, qui ont l'un est l'autre des projets d'implantation aux Etats-Unis, ont répondu à l'invitation. Alfa Romeo a aussi manifesté son intérêt, mais il a annoncé qu'en cas de mise en production, celle-ci se ferait en Europe. Le cahier des charges du MoMA étant par ailleurs respecté, la proposition italienne a été présentée " hors concours ". Deux approches ont été envisagées. La première consistait à développer une voiture inédite en partant de zéro, la seconde à partir d'un véhicule déjà existant, en l'adaptant aux contraintes du cahier des charges. AMF, SPS, Volvo et Alfa Romeo ont opté pour la première solution. Volkswagen s'est arrêté à une adaptation de son Combi, avec une refonte des aménagements intérieurs. Les prototypes d'AMF et de SPS fonctionnent à la vapeur. Ces deux sociétés fondent de grands espoirs envers ce type de motorisation. Il reste à vaincre certaines difficultés et non des moindres : économie d'usage incertaine, risque de gel de l'eau, très hautes pressions et températures de fonctionnement élevées. On peut raisonnablement douter que les grands constructeurs s'intéressent un jour à la vapeur, car ils sont bien plus attachés à perfectionner leurs moteurs à explosion.
La proposition à minima de Volkswagen se base sur un modèle déjà existant, le Combi. Copyright Voir aussi : https://www.youtube.com/watch?v=y1rdmbzMr50 Le prototype AMF, assemblé à Goletez en Californie, est un véhicule remarquable à bien des égards. Son moteur deux cylindres de 492 cm3, développant 105 chevaux, fourni par Jay Carter Enterprises, lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 120 km/h. Sa consommation, estimée à 13,7 litres aux 100 km en ville, est d'autant plus intéressante qu'il peut fonctionner avec différents types de carburant : fuel, kérosène, méthanol, etc. Côté dimensions, l'AMF mesure 4,64 mètres de long, 1,83 mètre de large et 1,78 mètre de haut, pour un poids de 1 485 kg. Son habitacle spacieux peut accueillir confortablement cinq personnes. Une rampe d'accès facilite l'installation des personnes en fauteuil roulant. Le compartiment conducteur est séparé de l'habitacle par une cloison inférieure et une vitre supérieure pare-balles, assurant ainsi la sécurité du conducteur. La sécurité des passagers n'a pas été négligée : les zones de déformation ont été conçues pour absorber efficacement les chocs en cas de collision frontale. Une ceinture en élastomère relie les pare-chocs avant et arrière, offrant une protection supplémentaire en cas de choc à faible vitesse et minimisant les risques de blessures pour les piétons. Les portes arrière latérales coulissantes sont à commande électrique, mais peuvent également être déverrouillées manuellement en cas de panne. Le porte-à-faux avant court améliore la visibilité et facilite les manœuvres dans les virages serrés et les parkings.
Le projet d'American Machine & Foundry (AMF). Copyright L'automobile conçue par Steam Power Systems Inc (SPS) à San Diego se distingue par son moteur à 4 cylindres de 2,4 litres, qui développer 66 ch et atteint 105 km/h. À l'instar du modèle AMF, ce véhicule offre la flexibilité d'utiliser différents types de carburant. Avec des dimensions de 4,80 mètres de long, 1,70 mètre de large et 2,10 mètres de haut, et un poids de 1 338 kg, ce véhicule peut accueillir jusqu'à cinq passagers, ou deux personnes accompagnées d'une troisième en fauteuil roulant. Cependant, son apparence et ses caractéristiques le rapprochent davantage d'un minibus, tel que le Volkswagen, que d'une voiture particulière conventionnelle.
La proposition de SPS tient plus du minibus que de l'automobile. Copyright Dans les années 1970, la technologie des batteries électriques, encore balbutiante, présente des limitations majeures. Leur poids excessif et leurs performances modestes ont dissuadé tous les participants du concours du Moma d'opter pour cette motorisation. L'objectif principal du Moma était d'inciter les constructeurs automobiles à explorer de nouvelles voies, même si l'utilisation des taxis, en comparaison avec des modes de transport plus collectifs, n'apparaît pas comme la solution idéale pour résoudre les problèmes de mobilité urbaine. Cependant, toute amélioration, même marginale, dans ce domaine, est perçue comme une contribution positive à la lutte contre la congestion urbaine. L'idée était de progresser, pas à pas, vers des solutions plus durables. Volvo imagine un véhicule dont le châssis, la carrosserie et l'aménagement intérieur sont inédits. Le City Taxi New York, malgré ses 4,37 mètres et son manque d'élégance, offre des solutions originales, notamment la possibilité de monter à bord sans quitter son fauteuil roulant grâce à une hauteur d'entrée de seulement 30 centimètres et une place aménagée à cet effet.
L'habitacle du Volvo City Taxi New York. Copyright Conçu selon le principe des cellules de sécurité, le véhicule intègre de lourds éléments protégeant l'habitacle, des zones avant et arrière déformables pour absorber l'énergie des chocs, et des protections tubulaires en acier dans les portes et les flancs. Le moteur avant offre une protection supplémentaire en cas de collision. Les ceintures de sécurité sont remplacées par une barre de sécurité rembourrée et ajustable, ancrée à la carrosserie, qui se replie contre le toit lorsqu'elle n'est pas utilisée, une solution pour encourager les passagers réticents à se protéger. Le taxi est équipé d'un moteur six cylindres diesel de 70 ch, placé à l'avant et couplé à une boîte automatique. La traction avant permet un plancher plat et un vaste espace intérieur.
Volvo City Taxi New York. Copyright Le conducteur est séparé des passagers par une cloison en verre pare-balles et en acier blindé, et dispose d'un siège réglable, d'une vision panoramique, d'une tablette avec lampe de lecture, d'un coffre-fort et d'un petit réfrigérateur. Long de 4,37 mètres, large de 1,90 mètre et haut de 1,72 mètre, le véhicule pèse environ 1 500 kg, avec une répartition des poids de 50/50 entre l'avant et l'arrière. Les porte-à-faux courts offrent une bonne visibilité et un rayon de braquage serré. Des moulures en caoutchouc sur les flancs réduisent les conséquences des petits chocs, et une lèvre à l'arrière du toit améliore l'aérodynamisme et réduit les projections de saleté sur la lunette arrière. La porte côté trottoir est coulissante et électrique, commandée par le conducteur, qui est averti par un témoin lumineux si elle est mal verrouillée. Un feu rouge intégré aux portes les rend visibles lorsqu'elles sont ouvertes. Le plancher est légèrement convexe et sans seuil pour faciliter le nettoyage. Le moteur diesel permet au taxi d'atteindre 120 km/h, et une version allongée de 80 centimètres, transformable en minibus de neuf places ou en ambulance, a été envisagée. Ce véhicule n'est pas un prototype destiné à la production en série, mais plutôt un laboratoire d'idées pour les futurs services de taxi.
Volvo City Taxi New York. Copyright Alfa Romeo, en réponse à l'invitation du MoMA, a chargé Ital Design de concevoir un taxi à traction avant en utilisant des éléments existants chez le constructeur. Le New York Taxi, destiné au marché européen, est présenté hors concours. Alfa Romeo n'a pas l'intention de le soumettre aux règles de la New York City Taxi and Limousine Commission, contrairement aux autres participants. Le châssis, la transmission, les suspensions et la direction proviennent du petit fourgon type F12. Le moteur est un 4 cylindres à double arbre à cames en tête de 1 290 cm³, présent sur de nombreux modèles de la marque. Il est placé au-dessus des roues avant, ce qui permet de gagner de l'espace. Sa puissance et sa vitesse assurent de bonnes performances dans les conditions de circulation urbaines et suburbaines difficiles. Ce prototype marque un changement dans la philosophie d'Ital Design. Abandonnant momentanément les modèles sportifs, le studio se concentre sur les aspects fonctionnels. L'esthétique passe au second plan, sans pour autant que le New York Taxi soit désagréable à regarder.
Alfa Romeo New York Taxi. Copyright Le véhicule peut accueillir jusqu'à cinq passagers : trois sur la banquette arrière et deux dos à la route, derrière le conducteur. Tous les sièges sont équipés d'appuie-tête et de ceintures de sécurité. L'espace réservé aux passagers est important, près de deux mètres carrés, supérieur à celui du taxi londonien. Les bagages peuvent être placés dans cet espace, ainsi que dans un second compartiment près du conducteur. Ce dernier dispose d'un autre espace de rangement à l'arrière du véhicule, accessible par une porte sous la lunette arrière. Une rampe escamotable intégrée au plancher facilite l'accès aux personnes en fauteuil roulant et aux familles avec poussettes. La porte coulissante côté trottoir permet une ouverture complète même dans les espaces de stationnement restreints. Une large ceinture en caoutchouc protège la carrosserie des chocs mineurs et réduit les coûts de réparation. Les pare-chocs sont conformes aux normes de sécurité américaines. Pour des raisons de sécurité, la zone de conduite est séparée de l'espace passagers par une vitre en verre de sécurité pare-balles. Un interphone bidirectionnel et un guichet permettent la communication entre les deux zones. Le compteur est placé dans le compartiment du conducteur, de manière à être visible des passagers. Le tableau de bord est équipé de voyants de contrôle de fermeture des portes. Un système radio permet au conducteur de contacter sa centrale et d'alerter les secours en cas de besoin. Un dispositif lumineux et sonore signale les urgences.
Alfa Romeo New York Taxi. Copyright Le taxi mesure 4,06 mètres de long, 1,72 mètre de large et 1,78 mètre de haut. Il occupe une surface au sol de 6,98 mètres carrés, contre 9,72 pour le Checker, soit 30 % de moins. En revanche, sa hauteur est supérieure de 30 % à celle du Yellow Cab, ce qui améliore l'habitabilité et l'accès à bord. Le designer italien renoue avec une approche du début du XXe siècle, où l'on montait à bord d'une automobile comme dans un carrosse du XIXe siècle. La position de conduite, surélevée d'environ 35 centimètres par rapport à une berline traditionnelle, offre une bonne visibilité sur la circulation. Ital Design a travaillé sur le confort du conducteur, avec un siège ergonomique et des commandes facilement accessibles, même avec la ceinture de sécurité attachée. L'espace pour les jambes et les bras a été optimisé. Un accoudoir sur le panneau de porte et un autre support à droite du conducteur complètent l'équipement. Les grandes vitres et le toit en verre teinté améliorent la visibilité pour les passagers. Après sa présentation à New York, ce concept-car a été exposé lors de l'exposition itinérante Carrozzeria Italiana, à Turin en 1978, Moscou en 1979 et Pasadena en 1981. Giugiaro a continué à travailler sur l'optimisation de l'habitabilité dans les années suivantes, avec les concepts cars Megagamma (1978) et Capsula (1982), sans pour autant produire de taxis.
Alfa Romeo New York Taxi. Copyright Alfa Romeo a aussi présenté à Paris son taxi en décembre 1977. Voici un extrait du dossier de presse : Après son succès à New York, le Taxi Alfa Romeo prototype, dessiné par Ital Design, vient à Paris ou il est invité en raison de ses caractéristiques peu communes, au Salon dédié aux moyens de réinsertion des handicapés physiques dans la vie sociale normale. Il sera exposé au Grand Palais des Champs Elysées du 14 au 18 décembre 1977 dans le cadre de la manifestation organisée par Réadapt sous le nom de Salon International des Matériels, des Techniques Modernes et de l'Environnement Social pour l'Aide à la réadaptation.
Alfa Romeo New York Taxi. Copyright Ses caractéristiques peu communes font de ce Taxi Alfa Romeo prototype le premier véhicule du genre adapté au transport des passagers normaux et handicapés, ce qui a motivé l'intérêt des Organisateurs du Salon de Paris, et confirme bien que nous nous trouvons devant un prototype d'avant-garde qui tient compte des nombreuses exigences de la mobilité individuelle. La Readapt française, organisation à caractère national, oeuvre, entre autres, pour que les moyens de transport en général soient progressivement conçus en vue d'apporter une aide réelle et utile aux mouvements des personnes handicapées de quelle façon que ce soit.
Alfa Romeo New York Taxi. Copyright En 2007, la Ville de New York lance un concours pour remplacer sa flotte emblématique de Ford Crown Victoria, qui sillonnent les rues de la ville depuis le début des années 1990, et qui ont progressivement remplacé les Checker.
Taxi Ford Crown Victoria (1979/1991). Copyright
Taxi Ford Crown Victoria (1991/1998). Copyright
Taxi Ford Crown Victoria (1999/2011). Copyright Le choix du gagnant est annoncé en 2011. Plusieurs constructeurs automobiles participent à ce concours, en proposant des modèles de véhicules qui répondent aux critères établis par la ville. Les trois finalistes sont Nissan avec le NV200, Ford avec le Transit Connect, et Karsan avec le V1. Finalement, c'est Nissan qui remporte le contrat avec son NV200, un véhicule utilitaire compact qui remplit la plupart des exigences de la ville.
Ford Transit Connect Taxi Concept 2008. Copyright
Ford Transit Connect Taxi 2010/2013. Copyright
Ford Transit Connect Taxi 2014/2018. Copyright Le remplacement des taxis Ford Crown Victoria se déroule progressivement. Bien que le Nissan NV200 ait été désigné comme le modèle principal, d'autres véhicules sont également autorisés à circuler comme taxis à New York. Cette diversité permet de mieux répondre aux besoins spécifiques des différents types de passagers. Le choix du Nissan NV200 n'a pas fait l'unanimité et a suscité des controverses, certains regrettant l'esthétique et le confort de l'ancien modèle Crown Victoria. Aujourd'hui, la flotte de taxis de New York se compose d'une variété de modèles, allant des berlines aux SUV, en passant par les véhicules hybrides et électriques.
Nissan NV200 Vantte Taxi, 2013/2018. Copyright Alors
que les projets NV200 et Ford Transit Connect sont réalisés à partir de
modèles déjà existants, mais simplement adaptés à leur nouvelle fonction,
le Karsan Concept V1 est un véhicule spécifique développé pour l'appel
d'offres new-yorkais. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş., ou Karsan,
est un constructeur automobile turc basé à Bursa, fondé en 1966.
Initialement spécialisée dans la fabrication de véhicules utilitaires
légers, de camions et d'autobus, Karsan a élargi sa gamme de produits au
fil des ans et s'est lancé dans la conception de véhicules innovants, en
particulier dans le domaine des taxis. Le Karsan Concept V1 répond au
cahier des charges émis par la ville de New York. Polyvalent, il peut être
utilisé comme taxi, mais aussi comme véhicule de transport personnel ou
familial. Malgré la non-obtention de ce contrat, ce modèle met en lumière
le savoir-faire du constructeur turc. Pour en savoir plus :
Karsan Concept V1. Copyright
Karsan Concept V1. Copyright
Karsan V1, projet pour New York. Copyright Le Citycab, une interprétation moderne du taxi londonien, a été dévoilé en 2006 par une équipe suédoise, avec l'objectif d'inciter les décideurs des grandes villes européennes à repenser l'avenir du taxi en tant que service communautaire. Ce véhicule se distingue par ses portes coulissantes à assistance électrique et sa suspension pneumatique, qui peut s'abaisser de 8 centimètres pour faciliter l'accès aux personnes en fauteuil roulant.
CityCab. Copyright Il est équipé de trains roulants et d'une motorisation hybride issus de la Toyota Prius, et sa boîte automatique ainsi que ses quatre roues directrices lui confèrent une maniabilité exceptionnelle, lui permettant de réaliser des demi-tours sans difficulté en milieu urbain. Le projet de taxi électrique Eva a été conçu par Tum Create à Singapour, un centre de recherche collaboratif entre l'Université Technique de Munich et l'Université Technologique de Nanyang. En partant de zéro, le projet a été mené en seulement deux ans. Soutenu par la National Research Foundation de Singapour, le prototype a été présenté au Salon de l'automobile de Tokyo en novembre 2013. L'Eva se distingue par son système de charge ultra-rapide, permettant de récupérer 200 km d'autonomie en seulement 15 minutes, une réponse aux longs temps de recharge des véhicules électriques traditionnels.
Tum Create Eva. Copyright Avec une autonomie totale de 330 km et une vitesse de pointe de 111 km/h, ce taxi est conçu pour un usage intensif, à l'image des taxis de Singapour qui, bien que représentant moins de 3 % du parc automobile, effectuent 15 % de la distance totale parcourue par les véhicules dans la ville. De nombreux taxis fonctionnent en rotation avec deux équipes jusqu'à 24 heures par jour, parcourant en moyenne 520 km chacun. L'Eva est spécialement adaptée aux conditions climatiques tropicales, avec un système de climatisation individuel pour les passagers et une gestion optimisée de la chaleur des batteries. Bien que sa commercialisation n'ait jamais été prévue, l'Eva sert de plateforme pour présenter les innovations de Tum Create dans le domaine des véhicules électriques.
Tum Create Eva. Copyright L'histoire du Volkswagen Taxi Concept remonte à 2007 avec le concept up, un véhicule compact, d'abord proposé avec un moteur arrière à essence à deux ou trois cylindres. Ce projet de voiture urbaine préfigure la VW Up, produite en série de 2011 à 2023. Volkswagen up! concept, 2007. Copyright La up évolue peu après en concept Space up, une version allongée conservant la même configuration mécanique. Le space up dispose de portes " suicide " facilitant l'accès à l'habitacle.
Volkswagen space up! Concept 2007. CopyrightLa Volkswagen Taxi Concept, dévoilée en décembre 2010, reprend les lignes de la space up. En 2010, les voitures électriques sont encore balbutiantes. La Nissan Leaf a été annoncée en 2009, et sa commercialisation débute en décembre 2010 au Japon et aux Etats-Unis. La Mitsubishi i-MiEV, et ses cousines Peugeot iOn et Citroën C-ZERO souffrent d'un manque d'autonomie. Ainsi, l'idée d'un petit taxi londonien alimenté par une batterie lithium-ion est à la fois audacieuse et novatrice. L'autonomie annoncée de 300 km par Volkswagen est peut-être optimiste, mais témoigne d'une réelle ambition. Le Taxi Concept atteint une vitesse de pointe de 120 km/h. Alors que Londres s'apprête à accueillir les Jeux olympiques d'été de 2012, Volkswagen profite de l'occasion pour parer son Taxi Concept d'un drapeau argenté sur le toit et d'armoiries de la ville de Londres sur les flancs et le tableau de bord. Malgré sa taille réduite, comparable à celle d'une Fiat 500, le Taxi Concept offre un espace intérieur surprenant. Son long empattement et ses porte-à-faux courts permettent à deux passagers de s'asseoir confortablement avec leurs bagages. L'écran tactile central regroupe les principales fonctions du véhicule, telles que la climatisation, le divertissement et les informations tarifaires.
Volkswagen London Taxi Concept 2010. Copyright Le traditionnel feu " Taxi " sur le toit indique la disponibilité du véhicule (vert) ou son occupation (rouge). Volkswagen abandonne les portes suicide du concept Space Up au profit de portes coulissantes plus pratiques. Le toit vitré offre aux passagers une vue panoramique sur les monuments de Londres. Avec un poids de 1 500 kg, le concept de taxi Volkswagen n'est pas un poids plume, mais il répond à une préoccupation majeure du maire de Londres en 2010, Boris Johnson : la nécessité de taxis à zéro émission.
Volkswagen London Taxi Concept 2010. Copyright Ce concept de taxi Volkswagen n'a jamais dépassé le stade de prototype, malgré des déclinaisons similaires pour Hong Kong, Berlin et Milan.
Volkswagen Milano Taxi Concept 2010. Copyright Malgré de nombreuses propositions de constructeurs, de carrossiers et de designers pour créer des véhicules spécifiquement conçus pour le taxi, seuls les États-Unis avec le Checker et le Royaume-Uni avec le FX4 et ses successeurs ont véritablement développé ce concept. Dans le reste du monde, les autorités politiques n'ont pas soutenu cette idée et ont laissé libre cours à la concurrence. Par conséquent, la plupart des taxis du 21ème siècle sont de simples berlines ou monospaces de grande diffusion, plus ou moins adaptés à cette activité. Présenté au Salon de l'automobile de Genève 2018, le Renault EZ-GO est un concept-car de robot-véhicule électrique, autonome et partagé. Il a été conçu dans le but d'explorer les possibilités de transformation de la mobilité urbaine. Le véhicule se présente comme une alternative potentielle aux véhicules particuliers et aux transports en commun traditionnels.
Renault EZ-GO, 2018. Copyright L'EZ-GO est conçu à la fois comme un véhicule et un service, pouvant être appelé via une application ou depuis des points de prise en charge désignés. Il offre une capacité d'accueil de six passagers et une vitesse maximale de 50 km/h. L'intérieur comprend des sièges modulables et un écran tactile pour l'information et le divertissement des passagers.
Renault EZ-GO, 2018. Copyright L'accès à l'habitacle se fait par une porte avant, et une rampe d'accès est prévue pour les personnes à mobilité réduite. L'architecture du véhicule, avec son toit panoramique en verre, vise à favoriser l'entrée de lumière naturelle. Dépourvu de volant et de poste de conduite, l'EZ-GO mesure 5,20 mètres de longueur, 2,20 mètres de largeur et 1,60 mètre de hauteur.
Renault EZ-GO, 2018. Copyright L'EZ-GO est doté d'une capacité de conduite autonome de niveau 4, lui permettant de maintenir sa trajectoire, de changer de voie, de tourner aux intersections et de se mettre en sécurité en cas d'incident, soit de manière autonome, soit via un centre de contrôle. Le groupe Renault envisage de développer des solutions de mobilité partagée basées sur ce type de véhicule, en partenariat avec des entreprises privées et des entités publiques.
Renault EZ-GO, 2018. Copyright Zoox, entreprise basée à Foster City dans la Silicon Valley, a été fondée en 2014. Employant actuellement près de 2 000 salariés, elle a été rachetée en 2020 par Amazon pour plus d'un milliard de dollars, et fonctionne comme une filiale indépendante. Conçue dans le même esprit que la Renault EZ-GO, l'Amazon Zoox présentée en décembre 2020 est un véhicule autonome, pensé pour intégrer une flotte de taxis sans chauffeur.
Amazon Zoox. Copyright Elle est dotée de capteurs permettant de surveiller son environnement dans un rayon de 150 mètres. D'un dessin asymétrique, longue de 3,60 mètres, elle peut rouler indifféremment dans les deux sens, avec une autonomie annoncée de 16 heures et une vitesse maximum de 120 km/h suffisante pour circuler sur les axes rapides des grandes villes. Sa direction fonctionne sur les quatre roues, ce qui facilite les manœuvres en milieu encombré ou pour le stationnement. La Zoox accueille quatre passagers qui se font face deux par deux.
Amazon Zoox. Copyright Elle a subi avec succès les crash-tests réglementaires aux Etats-Unis. La Zoox doit inspirer confiance pour convaincre le public qui devra s'en remettre à une intelligence artificielle pour se déplacer dans un environnement urbain qui peut s'avérer chaotique, voire agressif. À bord, il est prévu de l'équiper d'un panneau de commande pour régler la musique et la climatisation, et pour connaître en temps réel l'heure d'arrivée et l'itinéraire. Amazon a obtenu l'autorisation des autorités américaines pour expérimenter la Zoox à Foster City, Las Vegas et San Francisco. L'utilisation de la Zoox se ferait par le biais d'une application dédiée. L'actionnaire Amazon pourrait même utiliser la Zoox pour livrer des colis à ses clients, et ainsi réaliser de sérieuses économies en dépenses salariales. Cruise, filiale de la General Motors depuis 2016, est une entreprise américaine basée à San Francisco, spécialisée dans le développement de véhicules autonomes pour la mobilité urbaine. Fondée en 2013, elle a d'abord travaillé sur des prototypes basés sur la Chevrolet Bolt avant de concevoir la navette Cruise Origin, 100 % dédiée à un usage autonome. En 2020, la California Public Utilities Commission a autorisé Cruise à développer des services de taxis sans chauffeur de sécurité à San Francisco. En 2022, Cruise a lancé ce service de robotaxis, mais la municipalité a rapidement considéré la technologie peu fiable et a tenté de limiter son expansion. En août 2023, les autorités californiennes ont demandé à Cruise de réduire sa flotte de taxis autonomes de moitié après quelques accidents. La circulation des véhicules autonomes Cruise est désormais limitée à 50 véhicules en journée et à 150 la nuit.
General Motors Cruise Origin. Copyright Cruise a prévu de lancer une première flotte de véhicules autonomes à Dubaï, avec l'objectif d'atteindre 4 000 véhicules d'ici 2030. Une nouvelle société installée dans l'Émirat sera en charge du déploiement, de l'exploitation et de la maintenance des véhicules. Les autorités locales espèrent qu'à cette date, au moins un quart des déplacements sur son territoire se feront à bord de ce type d'automobile. La GM continue de se renforcer dans la voiture autonome, en rachetant des start-up ayant développé des technologies avancées. L'objectif est de rattraper son retard sur Google et d'autres concurrents dans ce domaine. D'autres constructeurs automobiles, comme Ford, travaillent également sur le développement de véhicules autonomes et de services liés à la mobilité.
General Motors Cruise Origin. Copyright National Electric Vehicles Sweden National Electric Vehicles Sweden (NEVS) est un constructeur automobile suédois, mais sa maison mère est chinoise. En effet, NEVS a été fondée en 2012 par un groupe d'investisseurs chinois qui ont racheté les actifs de Saab Automobile, alors en faillite. Cependant, NEVS n'a pas été autorisé à utiliser le nom de Saab pour ses véhicules. Dans un premier temps, NEVS a tenté de relancer la production de l'ancienne Saab 9-3, mais en version électrique. Cette tentative n'a pas été couronnée de succès et NEVS a ensuite été intégré au groupe chinois Evergrande, un géant de l'immobilier.
National Electric Vehicles Sweden. Copyright Désormais, NEVS se concentre sur le développement de véhicules électriques autonomes. Son modèle phare est la NEVS Sango, une voiture électrique conçue pour être utilisée dans les services de covoiturage. L'entreprise chinoise possède toujours l'ancienne usine Saab de Trollhättan, en Suède, où elle assemble ses véhicules électriques. Malgré les difficultés rencontrées par sa maison mère, Evergrande, NEVS poursuit ses activités et continue de développer de nouvelles technologies dans le domaine des véhicules électriques et autonomes.
National Electric Vehicles Sweden. Copyright Le taxi de Korben Dallas (Bruce Willis), le héros du film de science-fiction Le Cinquième Élément, sorti en 1997, est devenu un objet culte, au même titre que le film. Il faut dire qu'il a une histoire particulière. Le réalisateur français Luc Besson a eu l'idée de ce taxi en lisant la bande dessinée Valérian et Laureline, de Jean-Claude Mézières. Un taxi futuriste apparaît dans l'album Les Cercles du pouvoir, sorti en 1994. Le réalisateur est immédiatement séduit et décide de s'en inspirer pour son film. Il ira même jusqu'à modifier le scénario pour que le personnage principal, Korben Dallas, devienne chauffeur de taxi, et non pas employé d’usine de fabrication de fusées. Ce taxi mesure 5 mètres de long, et est reconnaissable à ses couleurs vives et à ses nombreux impacts de balles sur le côté droit. Il a été fabriqué en plusieurs exemplaires pour les besoins du tournage. Il s'agit en réalité d'une coque en résine de polyester fixée sur un châssis. Pour les besoins du tournage, un vérin a été installé sous ce châssis pour simuler les mouvements du taxi. Les effets spéciaux numériques ont fait le reste pour donner l'illusion d'un véhicule volant.
Le taxi de Korben Dallas dans " Le cinquième élément ", 1997. Copyright Sources : L'Automobile numéro 366, décembre 1976
|