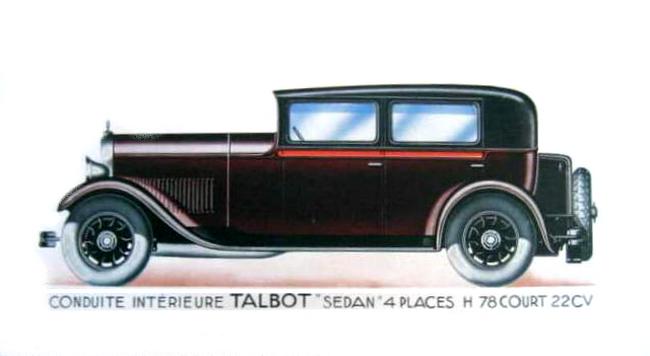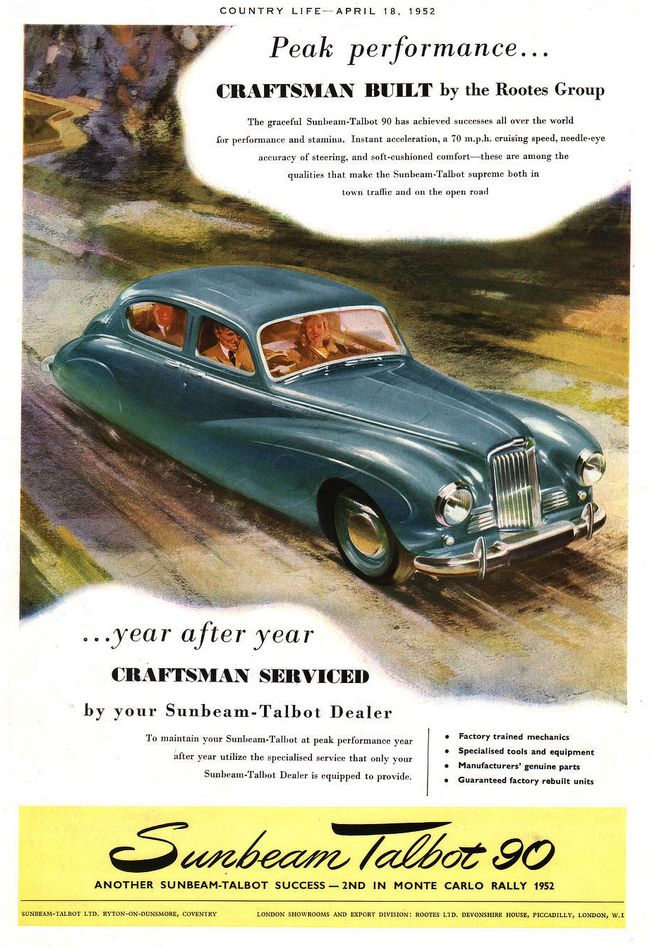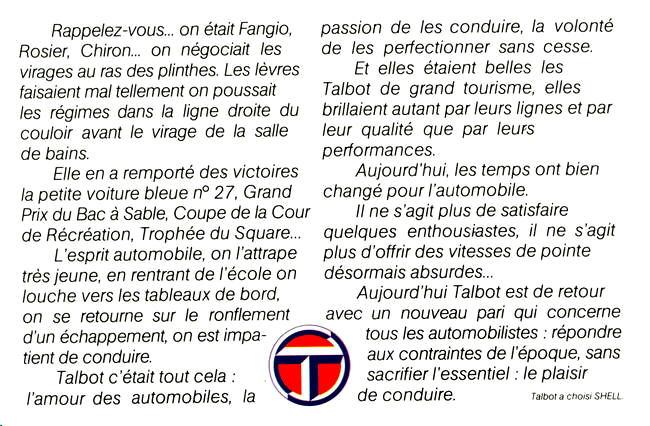|
Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. Talbot est certainement l'une des marques automobiles dont la généalogie est la plus complexe à définir, en raison de sa double existence, d'une part en Angleterre, d'autre part en France. En 1979, le nom Talbot réapparaissait pour sept ans. 1878 - 1934 : Une histoire tortueuse Adolphe Clément
- 1878 : Adolphe Clément débute la
construction de vélocipèdes à Paris Adolphe Clément voyait le jour le 22 septembre 1855 à Pierrefonds dans l'Oise. Son père était serrurier. Très tôt, il devint orphelin. Dès son enfance, la mécanique l'intéressait. Bientôt, son souhait était de faire les Arts et Métiers. Mais son tuteur ne l'entendait pas de cette oreille. Il voulait le faire travailler dans l'épicerie, et le plaçait chez un commerçant de Compiègne, où à force de maladresses il fut mis à la porte. A dix-sept ans, il partait en vélo faire son " Tour de France ". Il parvenait à se faire embaucher à Tours dans une entreprise de construction mécanique. Econome, il amassait minutieusement un pécule. Il rejoignait ensuite Angers, Bordeaux, Marseille et Lyon, toujours sur sa fidèle bicyclette. Devenu entre-temps un excellent cycliste, il s'intéressa à la compétition. En 1876, il s'engageait dans l'épreuve Angers - Tours, dans laquelle il terminait sixième. Il travaillait alors à Bordeaux durant l'hiver, où il réparait des bicyclettes et se familiarisait avec les affaires. Adolphe Clément fondait en 1877 son premier atelier de fabrication de cycles à Lyon. L'année suivante, il ouvrait à Paris, rue Brunel dans le 17ème arrondissement, un nouvel atelier. Plus légers que ceux de ses concurrents, ses engins connurent rapidement le succès. Les commandes affluaient et il devint nécessaire pour Clément de trouver des fonds extérieurs. Cela lui fut relativement facile. Régulier, fournissant des produits de qualité, les Cycles Clément commençaient à être très favorablement connus. S'étant lui même essayé à la course cycliste, il se rendait compte de la nécessité de faire courir ses machines afin d'en parfaire la réputation. En 1880, ses ateliers parisiens s'étendaient, ses bicyclettes s'affinaient, et il occupait déjà 150 ouvriers et employés.
Adolphe Clément. Copyright Clément se rendait régulièrement aux Etats Unis, où il constata le développement des outillages. Il tirait parti de ces visites, ce qui lui permettait de conserver sur ses concurrents une avance technique et commerciale. Grâce à ses investissements, Clément était devenu en 1886 le plus important constructeur de cycles français. Attentif aux progrès de son époque, Adolphe Clément comprenait rapidement que le pneumatique naissant était promis à un bel avenir. Il visitait en 1889 l'exposition du cycle qui se tenait au Crystal Palace à Londres. Alors que la bandage en caoutchouc plein, succédant au fer, était le seul utilisé, il eut la bonne fortune d'assister à une démonstration du tout nouveau pneumatique Dunlop, monté, pour la toute première fois, sur une bicyclette. Après maints pourparlers cette licence lui fut accordée à condition que Clément se rende acquéreur de 2000 actions Dunlop. Contraint, il réalisa cette opération à contrecoeur. Il considérait ces actions comme sans valeur. Mais celles ci, grâce à la généralisation du pneumatique, atteignirent très rapidement dix fois leur prix initiale, constituant par cette hausse en flèche le départ de la fortune d'Adolphe Clément. Durant les années 1890, une vague de prospérité déferlait sur l'industrie du cycle et du pneumatique, principalement en Angleterre où se créaient trusts et consortiums. Celui qui englobait déjà les firmes Gladiator et Humber proposait à Clément de s'adjoindre à eux, en échange d'une somme conséquente.
En 1896, Clément et Gladiator fusionnaient. Ce denier était installé au Pré Saint-Gervais. Copyright Ayant à l'époque d'autres projets, Clément n'hésitait pas à se laisser absorber par le nouveau consortium qui portait désormais le nom de " Clément Gladiator Humber ". Clément était devenu un homme riche. Cela ne l'empêchait pas de poursuivre la production de vélos en pièces détachées. Clément, en homme d'affaire avisé, investissait une partie de sa fortune dans des terrains situés près de la porte d'Ivry, autour des usines Panhard et Levassor, société avec laquelle il entretenait d'excellentes relations. En mai 1897, consécutivement au décès de Levassor, des changements d'organisation intervenaient au sein de cette société. Clément prenait part au capital du constructeur automobile. Il rejoignait enfin un secteur d'activité auquel il aspirait tant. En 1898, Adolphe Clément édifiait une nouvelle usine à Levallois Perret. Il s'agissait de l'une des premières usines de construction automobile du monde conçue en tant que telle. Cette usine donnait sur le quai Michelet qui longe la Seine. Clément produisait d'abord des vélocipèdes et des motocycles, puis des tricycles et des quadricycles à pétrole. Les premières voitures sortaient en 1900, d'après des brevets Panhard et Levassor.
Clément, fabricant de cycles et d 'automobiles. Copyright En 1903, Clément qui n'était plus propriétaire de la marque qui portait son nom, dut se résoudre sous la pression de ceux qui lui avaient racheté son affaire de cycle de modifier le nom de ses automobiles. Il adoptait le nom de Clément Bayard, en l'honneur du Chevalier Bayard, réputé sans peur et sans reproche, qui avait en 1521 délivré la ville de Mézières dans les Ardennes, où Clément venait d'installer une usine. Cette appellation Bayard était utilisée par Clément depuis 1901 pour désigner les carburateurs de son invention qu'il fabriquait. Adolphe Clément insérait dans la presse des avis dans lesquels il précisait que désormais tous les véhicules portant la marque Clément n'étaient plus de sa fabrication. Seules les Clément Bayard sortaient du quai Michelet. Pour développer son activité, Clément, conscient de l'importance du marché anglais, entreprenait des démarches afin d'y exporter ses produits. C'est dans ce cadre qu'il rencontrait en 1903 le duc de Shrewsbury of Talbot. C'est dans le même esprit qu'en 1904 Clément se rendait en Italie où il entrait en pourparlers avec la carrosserie Diatto de Turin. Les discussions furent laborieuses, puisqu'il fallut attendre plusieurs années la sortie des Diatto Clément, construites parcimonieusement sur un modèle peu conforme aux idées de Clément. Albert Clément, le fils d'Adolphe, défendait les couleurs de la marque en prenant part, parfois victorieusement, aux courses automobiles de l'époque. En 1907, il se tuait lors d'essais en vue du Grand Prix de l'ACF. Il n'avait que 24 ans. A partir de 1908 Adolphe Clément s'intéressa aux dirigeables. Cette année là sortait des ateliers du quai Michelet le premier engin de sa construction. Il s'agissait d'un spécimen fort différent de ceux connus jusque là, répondant aux caractéristiques édictées par son inventeur, l'ingénieur Capazza.
Adolphe Clément, à gauche dans la nacelle. Copyright Malgré la mort de son fils, Adolphe Clément maintenait son engagement en compétition. La production d'automobiles de qualité, fiables, simples et au fonctionnement économique se poursuivait à Levallois jusqu'en 1922. C'est alors qu'il vendait son usine à André Citroën. La rosace qui surmontait le hall d'entrée portait les initiales AC ... qui étaient commune aux deux industriels. La 2 CV y fut construite à partir de 1948, et ce jusqu'en 1988. L'usine fut alors démolie et remplacée par des immeubles neufs. Grand Industriel, grand patriote, Adolphe Clément fut autorisé par le Conseil d'Etat à adjoindre le nom de Bayard à son nom patronymique, pour lui-même et pour ses descendants. Il se retirait dans son village natal, où il s'était fait construire une magnifique propriété. En 1928, circulant en voiture dans Paris, alors qu'il se rendait à un conseil d'administration, il fut pris d'une syncope et mourait.
- 1903 : Rencontre entre Clément et le
duc Shrewsbury and Talbot Cet aristocrate anglais était passionné d'automobile. Il utilisa une partie de sa fortune pour assouvir sa passion, en se lançant dans cette industrie naissante. Dans ses affaires, le duc avait un associé du nom de Weigel, son futur directeur commercial. C'est Weigel qui fit rentrer en contact Adolphe Clément et le duc Shrewsbury and Talbot, qui parlait couramment le français, ce qui facilita les contacts.
Lord Shrewsbury and Talbot. Copyright Les deux hommes étaient bien différents. Clément dégageait par son physique de la puissance et une force de caractère, tandis que le duc était un homme plus raffiné, à l'élégance désuète typiquement britannique. C'est le fils du duc, dénommé Ingestre, qui suggéra tout simplement le nom de Talbot. Weigel prenait la direction de la nouvelle société Clément Talbot Ltd. Le duc fit l'acquisition de terrains dans la banlieue de Londres. Il voulait faire de son usine la plus belle et la plus moderne de son époque. Pour cela, il fit appel aux meilleurs architectes. Les premières Talbot de la nouvelle société Clément Talbot Ltd étaient exposées au Salon de Londres en 1903. Il s'agissait dans un premier temps de voitures en provenance de Levallois. Une fois l'usine Talbot terminée en novembre 1904, la production pouvait enfin commencer. L'usine fut inaugurée lors d'une fastueuse réception qui réunissait entre autres le duc Shrewsbury and Talbot, son fils Ingestre, Adolple Clément, son fils Albert, et le directeur Weigel. La première Talbot 100 % britannique était présentée en 1906. Elle était encore étroitement dérivée des productions françaises, mais se singularisait déjà par quelques trouvailles. Les Talbot britanniques se forgèrent une solide image, grâce notamment à un slogan bien inspiré : " Invincible Talbot ".
All British Invincible Talbot. Copyright A partir de 1907, les Talbot britanniques participaient à des courses de vitesse à Brooklands et à des courses de cote. Ingestre, le jeune vicomte de Shrewsbury & Talbot, trouvait la mort durant la première guerre. Dès lors, son père abattu par le peine, renonçait à son intérêt pour l'automobile, que son fils aimait tant. Il se retirait du conseil d'administration de Talbot. En 1919, Clément Talbot était racheté par le groupe britannique A. Darracq and Co Ltd. Ce rachat allait donner naissance au groupe Talbot Darracq. Alexandre Darracq
- 1891 : Alexandre Darracq produit des
cycles sous la marque Gladiator L'autre personnage clef à l'origine du succès de la marque Talbot fut Alexandre Darracq, né à Bordeaux, en 1855, la même année qu'Adolphe Clément. En 1891, associé à un certain Jean Aucoc, il créait son entreprise, spécialisée dans la production de matériel pour les caves (casiers ...), avant de se lancer dans la fabrication de cycles sous la marque Gladiator.
Cycles Gladiator. Copyright Darracq avait fondé à cette époque l'une des plus belles équipes de course cycliste et de vitesse. Ses nombreux succès et records contribuèrent à accroître la notoriété de la marque Gladiator. Les britanniques qui voyaient d'un mauvais oeil cette concurrence française en Europe faisaient l'acquisition des cycles Gladiator en 1896. Cela n'empêcha pas Alexandre Darracq de poursuivre la production de cycles en pièces détachées sous la marque Perfecta, dans une nouvelle usine qu'il venait de faire construire à Suresnes, grâce à l'argent obtenu lors de la cession de Gladiator. Dès lors, ils vendait ses pièces à des assembleurs sans enfreindre les termes du contrat passé avec les britanniques.
Cycles Perfecta. Copyright Equipé des outillages les plus modernes, Darracq, tout comme Clément, s'intéressait à la construction automobile, en plein développement. En 1897, il présentait son premier tricycle électrique. Quelques entrepreneurs sensibles à ce projet lui apportèrent une aide financière. Il fondait en 1898 une nouvelle société, Automobiles Darracq SA, à Suresnes, pour y produire des engins motorisés. En 1902, Darracq dont l'idée était de fabriquer en grande série des voitures économiques se mit à la recherche de capitaux. C'est à Londres qu'il trouva des bailleurs de fonds. Il créait sur place la société A. Darracq & Co Ltd qui diffusait des modèles dérivés de ceux construits à Suresnes. Parallèlement, il vendait des licences de production à de jeunes constructeurs, comme Fritz Opel en Allemagne, qui allait produire des Opel Darracq, et Nicola Romeo en Italie. En 1904, la production de Darracq représentait environ 10 % du marché français.
Darracq sur Broadway. Copyright En 1906, Darracq décidait de fournir le marché italien en assemblant à Milan des voitures à partir d'éléments en provenance de Suresnes. Peu attractives face aux productions italiennes, les voitures françaises ne se vendaient pas bien. L'affaire fut mise en faillite en 1909, et cédée à un groupe financier milanais. Les 250 salariés de Darracq furent repris dans la nouvelle société dénommée Alfa (Anonyme Lombarde pour la Fabrication des Automobiles). En 1915, l'ingénieur Nicolas Romeo prenait une forte participation dans le capital d'Alfa, et fondait Alfa Romeo. Darracq était un précurseur. Il fut l'un des premiers à étudier les besoins de sa clientèle en l'interrogeant par le biais de concours. Ses voitures étaient visibles dans les plus grandes villes du monde, grâce à la vente en quantité aux compagnies de taxi. Le compétition était déjà un passage obligatoire pour développer une notoriété, et c'est ainsi que Darracq, qui ne savait pas conduire, recruta les meilleurs pilotes du moment. Ses voiture battaient des records de vitesse en 1904 et 1905. La victoire à la Coupe Vanderbilt aux Etats Unis en 1905 et 1906 renforçait une image déjà bien établie.
Circuit de la Sarthe 1906, Hémery vainqueur en 1905 au Circuit des Ardennes et à la Coupe Vanderbilt sur Darracq. Copyright A partir de 1909, Darracq peinait à équilibrer ses comptes en France. Il devait faire face à des difficultés suite au lancement raté d'un moteur sans soupape. La société Automobiles Darracq SA fut vendue en 1912 aux actionnaires qui contrôlaient A. Darracq and Co Limited. Après la reprise de son affaire par les britanniques, Darracq se retira sur la Côte d'Azur. Il y investissait une partie de sa fortune dans diverses affaires immobilières. Il y mourait en 1931. L'usine de Suresnes sous le contrôle de A. Darracq and Co Limited Après le départ de Darracq, l'usine de Suresnes poursuivit sa production. Elle était désormais dirigée par Owen Clegg. Au sortir de la guerre, la société britannique A. Darracq and Co Ltd, grâce à ses contrats pour l'industrie de la défense, se trouvait dans une situation financière saine. En 1919, elle se portait acquéreur de la la firme Clément Talbot de Londres. Ce rachat donnait naissance au groupe Talbot Darracq.
Suresnes, la rentrée des Usines Darracq. Copyright 1920, création de Sunbeam Talbot Darracq (STD) En août 1920, Talbot Darracq s'associait avec Sunbeam, firme prospère qui produisait des automobiles depuis 1899, et créait ainsi le groupe britannique Sunbeam Talbot Darracq (STD). Au sein de ce groupe, Sunbeam et Talbot assuraient leurs fabrications en Angleterre, tandis que Darracq poursuivait ses productions à Suresnes. Les voitures de Suresnes étaient vendues sous la marque Talbot Darracq jusqu'en 1922, puis simplement Talbot à partir de cette date, bien que le nom de Darracq demeura associé à la raison sociale de Talbot jusqu'à la fin des années 50. STD prévoyait pour l'épreuve mancelle de 1921 sept voitures, deux Sunbeam, deux Talbot et trois Talbot Darracq. En fait, les voitures des trois marques étaient identiques, et ne se différenciaient que par leur teinte, verte pour les Sunbeam et Talbot, bleu pour les Talbot Darracq. Un vrai groupe automobile était né. Talbot à Suresnes sous contrôle britannique En 1920, l'usine de Suresnes lançait la production d'un modèle V8 de 4,6 litres. Mais sur le marché difficile de l'après guerre, ce V8 ne parvenait pas à s'imposer. Trop coûteux à fabriquer, Owen Clegg renonçait à cette voiture en 1923. Bien qu'il en regretta l'abandon, il avait dû composer avec une direction britannique qui donnait ses ordres. Talbot se concentrait désormais sur la production de plusieurs 4 cylindres à tendance sportive.
Publicité de 1924 pour la Talbot DC, le modèle à succès de Talbot, produit à 6754 exemplaires. Copyright Toutefois, à partir de l'automne 1925, la firme de Suresnes abordait la fabrication de confortables 6 cylindres, techniquement simples, légères, efficaces et confortables. Construites avec beaucoup de soins, les Talbot avaient acquis en quelques années la réputation de voitures fiables et de qualité. Ce nouvel élan donné à la marque devait beaucoup à Georges Roesch (paragraphe suivant).
Portfolio des carrosseries Talbot 4/6 cylindres, environ 1929. Copyright Au salon de Paris 1929, Talbot exposait encore trois 6 cylindres. La crise de 1929 n'avait pas encore fait ses ravages en Europe. Une clientèle restreinte aimait se faire plaisir en achetant des automobiles de grande classe. Talbot avait désormais sur ce créneau une certaine légitimité, grâce au confort unanimement reconnu de ses modèles.
Ces publicités de presse de la période 1929/1931 sont signées des meilleurs illustrateurs de l'époque. Copyright Mais le salon de Paris de 1929 voyait aussi le retour d'une nouvelle et imposante 8 cylindres, qui constituait la grande surprise du stand. Ce nouveau modèle permettait au constructeur de Suresnes de se positionner de nouveau dans la catégorie du très haut de gamme, créneau du marché qu'il avait abandonné six ans plus tôt. La 8 cylindres Talbot eut durant son existence à souffrir d'une image de mécanique fragile. Ce moteur était plus à leur aise dans les concours d'élégance que mené à la cravache sur les nationales. Le constructeur tenta de remédier à ce désavantage en abaissant le régime moteur et la puissance à partir de 1931. Néanmoins, les voitures 8 cylindres étaient appréciées pour leur silence, leur souplesse de fonctionnement, et leurs performances ... à condition de ne pas les piloter à la limite. Ces modèles furent surtout connus sous le nom de Pacific, en hommage aux célèbres locomotives à vapeur utilisées pour la traction des trains de voyageurs.
Portfolio des carrosseries Talbot 8 cylindres, environ 1929. Copyright Malgré ses atouts, la grosse Talbot subissait à partir du début des années 30 les effets d'une concurrence plus vive, qu'elle provienne des marques françaises mieux établies et à la légitimité indiscutable sur ce créneau (Voisin, Delage, Bugatti ...), ou de constructeurs étrangers, principalement américain (Duesenberg, Cadillac ...). Affichée très, trop chère, la série Pacific s'éclipsait fin 1932, après que les services commerciaux aient consenti des rabais substantiels.
Publicité Talbot 1931 - © : L'Illustration (www.lillustration.com) - reproduction interdite L'Atlantic succédait à la Pacific lors du Salon de 1932. Elle en reprenait plusieurs éléments, mais pour abaisser le prix de revient, les ingénieurs avaient opté pour un moteur plus petit, plus simple de conception. Owen Clegg voulait afficher l'Atlantic un tiers moins chère que la Pacific, ce qu'il parvint à faire. Les hommes de Talbot Georges Roesch, né en Suisse (1891-1969), avait fait ses premières armes chez Delaunay Belleville puis chez Renault à partir de 1911. En 1916, il était recruté chez Talbot en Angleterre. Roesch y dessina des voitures pleines d'astuces, en protégeant ses idées par de nombreux brevets déposés sous son nom. Son employeur, agacé, l'incita à déposer ses trouvailles sous le nom de Talbot. Roesch, contraint et forcé accepta. Mais il conserva toujours son indépendances d'esprit, n'acceptant aucun apport étranger à ses créations. Roesch n'était pas vraiment employé à la hauteur de ses talents en Angleterre. Louis Coatalen (paragraphe suivant) le fit venir à Suresnes, où il fut occupé jusqu'en 1924. C'est alors qu'il fut rappelé à Londres pour donner un peu plus de pétillant et de glamour aux trop sérieuses Talbot britanniques. Grâce à Roesch, les Talbot d'outre Manche de la seconde moitié des années 20 et des années 30 étaient devenues des voitures chics, moins coûteuses à l'achat que les Rolls Royce, et pourtant bien plus rapides. Owen Clegg était assisté à Suresnes par le responsable technique du groupe STD, Louis Coatalen, un ingénieur breton né à Concarneau en 1889. C'est cet homme qui contribua à donner aux Talbot l'image de voitures sportives.
Louis Coatelen, au volant d'une Sunbeam. Copyright A cette époque, deux ingénieurs transfuges de chez Fiat furent recrutés par Caotalen : Vincenzo Bertarione et Walter Becchia. Ce dernier fut à l'origine des plus belles voitures de courses Talbot. Durant cette période, le personnel de Suresnes s'habitua aux incessants voyages des britanniques dans leur usine. Les patrons du groupe visitaient régulièrement l'usine et son bureau d'étude, en compagnie d'Owen Clegg, de Louis Coatalen, des ingénieurs Bertarione et Becchia. Henry Roesch, ingénieur en chef de l'usine Talbot anglaise, étaient aussi régulièrement du voyage. Une politique commerciale innovante Le service commercial de Suresnes était particulièrement bien organisé. Grâce aux qualités des automobiles proposées, celles ci pouvaient tout aussi bien convenir à une clientèle soucieuse de luxe et de confort que de conduite sportive. Les essayeurs adaptaient lors des essais leur pilotage selon la catégorie de leur interlocuteur : jeune, chic, sportif, ou plutôt vieux, snob ... Mais quand c'est le chauffeur qu'il fallait convaincre, plutôt que le propriétaire, les vendeurs de chez Talbot savaient aussi " graisser la patte ". La clientèle de Talbot était essentiellement constituée de vedettes du cinéma ou de la chanson, d'épouses fortunées, d'industriels, d'aristocrates ou de bourgeois de province. La politique commerciale de Talbot était en avance sur son temps. Certains concessionnaires organisaient des rallyes de propriétaires, offraient des réductions importantes sur les pneumatiques, savaient parfois ne pas facturer de petites réparations ... Des courriers étaient adressés aux propriétaires pour s'enquérir du devenir de leur auto, sur son état de fonctionnement, son kilométrage, etc ... Les termes " mailing " et " base de données " n'étaient pas encore de ce monde, mais cela y ressemblait fortement. La presse était régulièrement alimentée en publicités pour les productions de Suresnes. Le constructeur Talbot savait se plier aux exigences de sa riche clientèle, grâce à tout une gamme d'accessoires plus ou moins utiles. Les demandes spéciales étaient aussi prises en compte. La concurrence était rude. La compétition Lors des 24 Heures du Mans 1930, deux Talbot se classaient troisième et quatrième. Il s'agissait pourtant de voitures strictement de série, avec une carrosserie quatre places. Les voitures avaient tourné pendant 24 heures sans un seul problème mécanique, grâce à la simplicité de leur conception. Les Talbot se manifestaient de nouveau lors du Rallye des Alpes en 1932 et 1934. Cette épreuve était alors considérée comme le test le plus difficile auquel pouvait être soumise une voiture. En 1934, l'épreuve comptait 3170 kilomètres à parcourir en six jours, sur les routes alpines de six pays, avec plus de cinquante cols à franchir. Il était interdit de réparer les voitures durant l'épreuve. Le règlement était impitoyable. Les plus grands constructeurs français et étranger s'affichaient sur cette prestigieuse compétition : Alfa Romeo, BMW, Bugatti, Delahaye, Hotchkiss, etc ... Le démantèlement de STD en 1934 Au début des années 30, Talbot était de nouveau à la peine. Les effets de la crise de 1929 se ressentaient sur le vieux continent, en particulier sur les voitures de prestige. Par ailleurs, les changements réguliers de gamme avaient nécessité des investissements répétés, ce qui avait grevé la rentabilité de l'usine de Suresnes. Outre Manche, la situation n'était guère plus florissante. Le groupe Rootes, propriétaire des marques Hillman et Humber, prenait en 1934 la majorité des parts de Sunbeam Talbot Darracq. La marque Sunbeam était provisoirement mise entre parenthèses.
Sunbeam Talbot Ten. Copyright Le nom de Talbot étant utilisé par Rootes, et afin d'éviter toute confusion avec les productions de Suresnes, il fut décidé que les Talbot produites en France et vendues dans les pays du Commonwealth et dans certains pays d'Europe du nord ne porteraient que le nom de Darracq.
Les Talbot françaises deviennent des Darracq sur certains marchés étrangers. Copyright En 1938, Sunbeam Talbot Darracq prenait le nom de Sunbeam Talbot. La marque Sunbeam vivait de nouveau. La nouvelle direction de la firme, dès le début de sa gestion, favorisa la production de voitures plus économiques et moins élaborées. En 1954, le nom de Talbot disparaissait complètement du marché britannique.
Plutôt Sunbeam que Talbot, mais le nom de Talbot est toujours présent sur cette publicité de 1952. Copyright 1934 - 1959 : Epoque Talbot Lago Anthony Lago, l'homme providentiel Un homme providentiel allait reprendre en main l'usine de Suresnes. Anthonio Lago (qui se faisait appeler Anthony en France) allait donner une nouvelle vie à cette filiale. Anthony Lago est né le 28 mars 1893 à Venise. Après des études à l'Ecole Polytechnique de Milan, il fut appelé en 1915 sous les drapeaux de l'armée italienne, où il occupa le grade de Major. Après la guerre, il s'expatriait à Londres et obtenait la concession exclusive pour la distribution des automobiles Isotta Fraschini. Notre homme possédait toutes les qualités requises pour son métier : prestance, charme, intelligence, habileté commerciale et technique. Lago, bien qu'italien, n'était pas spécialement fougueux. Au contraire, au contact de la haute société britannique qu'il côtoyait avec son épouse londonienne, il en avait adopté les moeurs.
Anthony Lago. Copyright Il fut ensuite recruté par la Wilson Preselective Gearbox Co qui produisait la boîte de vitesses semi automatique sélective du même nom. En 1928, Armstrong Siddeley fut le premier constructeur à employer ce type de boîte, suivi par d'autres marques britanniques, souvent influencées par Anthony Lago : Alvis, Daimler, Lanchester, MG, Talbot ... En 1931, Anthony Lago devenait directeur général de Wilson. Le principe de la boîte présélective Wilson consistait à choisir d'avance sa vitesse. Le conducteur plaçait une manette située à droite du volant sur la position 3 ou la position 4, il débrayait et la troisième ou la quatrième s'engageaient automatiquement. L'usine Talbot de Londres s'intéressa à la boîte Wilson. C'est dans ce contexte qu'eurent lieu les premiers contacts entre Anthony Lago et le groupe STD. Dès 1933, Anthony Lago entrait chez Sunbeam au poste de sous directeur. Maintenant intégré au staff de STD, Anthony Lago apprenait à quel sombre avenir - la mise en liquidation - était vouée l'usine Talbot de Suresnes. Anthony lago estimait que Talbot pouvait être sauvegardé à condition de réorganiser techniquement et commercialement l'usine, tout en redonnant de l'espoir au personnel et en renouvelant l'offre. Séduit notamment par l'oeuvre de William Lyons qui fabriquait depuis 1931 les voitures surbaissées de marque SS (les futures Jaguar), il entendait pouvoir réussir le même parcours dans l'hexagone. Notre homme qui venait juste de dépasser la quarantaine décidait de traverser la Manche. Après avoir levé les dernières réticences au sein du groupe STD, il devenait au début de 1934 le directeur général des Automobiles Talbot à Suresnes. Il remplaçait à ce poste Owen Clegg, et obtenait de STD un sursis de six mois avant la dissolution de l'affaire. Lago s'installa à ses débuts dans un hôtel de Suresnes. Loin des fastes de la capitale, de ses grands restaurants, Lago préférait une vie plus modeste près de son usine. Pour l'instant, son épouse Pepita était restée à Londres. Quand celle ci s'installa en France, Anthony Lago loua un luxueux appartement à Paris avec vue sur la Seine. Mais Pepita ne s'y sentait pas à l'aise. Elle s'ennuyait toute seule, loin de ses amis de Londres. Ce que pouvait lui raconter Anthony Lago au sujet de la vie de l'usine le soir après sa journée de travail ne l'intéressait pas. En 1936, elle décidait de revenir s'installer définitivement dans la capitale britannique. Anthony Lago fit la connaissance d'une autre femme à Paris. Piniata était, contrairement à Pepita, passionnée par la vie de l'usine, et avait une oreille attentive aux propos de son mari. Ils achetèrent une maison en Vallée de Chevreuse pour s'y installer. Pepita se tuait en Suisse en 1964 au volant d'une Talbot alors qu'elle venait d'aborder un virage à trop vive allure. Un véritable plan de bataille pour Suresnes Pour le moment, à l'usine, la situation était catastrophique. Le service de garantie était débordé de réclamations, les voitures neuves tombaient régulièrement en panne et cela coûtait une fortune à Talbot. Rapidement, Anthony Lago marqua de son emprunte l'organisation de la maison. Il se séparait d'anciens cadres auxquels il attribuait les errements du passé. Le directeur de l'usine, M. Cheval, était congédié, tout comme l'ingénieur Bertarione. Un plan de bataille fut élaboré pour remettre de l'ordre dans la production et la vente des Talbot françaises. Un contrôle qualité stricte était mis en place avant toute livraison, même ci celui ci pouvait froisser les commerciaux en raison de l'incidence sur les délais de livraison, ou les contremaîtres dont le travail était régulièrement remis en cause. Mais à court terme les effets bénéfiques furent rapidement ressentis, avec une baisse des retours sous garantie. L'implantation des services et la gestion des flux furent réétudiés au sein de l'usine. Le hall d'accueil qui semblait dater de l'époque d'Alexandre Darracq avec son vieux mobilier fut transformé en salle d'exposition permettant d'examiner les belles Talbot. Le bureau d'Anthony Logo était désormais tout proche du bureau d'études toujours dirigé par Bechhia. Dans la nouvelle cantine, Anthony Lago pouvait rencontrer plus facilement ses collaborateurs. Le patron était plus proche de ses salariés que ne l'était Owen Clegg. Anthony Lago dès son arrivée à Suresnes eut une préoccupation majeure : s'affranchir du groupe STD qui conservait un droit de regard sur l'usine française tout en se trouvant dans un état de décomposition de l'autre côté du Channel. Prévoyant cette issue fatale, Anthony Lago avait eu le temps de trouver des capitaux. C'est ainsi qu'il rachetait l'usine de Suresnes. Talbot de Suresnes prenait le nom de Talbot Lago, et allait enfin pourvoir vivre et se développer de manière autonome sous l'autorité d'Anthony Lago. D'une gamme de voitures cossues et sages, mais dépassées en 1934, Anthony Lago entreprenait de produire des voitures à tendance sportive, ayant le plus possible de pièces en commun avec de vraies voitures de compétition. Anthony Lago était un administrateur très habile mais aussi un technicien de valeur. Il était surtout vital de donner un nouvel élan au service commercial. Il s'agissait d'une opération de la dernière chance car la situation était si dramatique qu'elle ne laissait aucune place à l'erreur. Avec l'aide de l'ingénieur Becchia, toute la gamme fut reconsidérée en s'appuyant sur un atout majeur, la connaissance de Lago de la boîte Wilson dont il était un éminent spécialiste et dont il allait équiper les Talbot.
Publicité pour les Talbot équipées de la transmission Wilson, environ 1934. Copyright Anthony Lago entreprit aussi de moderniser l'aspect des voitures de Suresnes. Celles ci étaient jusqu'alors hautes sur pattes, très dignes, mais pas vraiment glamours. Il demanda à ses stylistes de travailler sur des lignes basses et dépouillées. Sur le plan esthétique, Talbot prenait d'un seul coup une longueur d'avance sur ses concurrents. Lago fit venir de Londres une SS Standard Roadster. Ses ingénieurs décortiquèrent la voiture. En quelques semaines, l'équipe Talbot concevait le roadster Talbot T 150 Super Sport, présenté en 1934 en trois exemplaires (bleu, blanc et rouge) au concours d'élégance du Bois de Boulogne. Le succès fut considérable, et après cette manifestation les trois voitures furent exposées dans le magasin des Champs Elysées.
Roadster Talbot T 150 Super Sport. Copyright Promouvoir Talbot par la compétition Anthony Lago s'intéressait depuis toujours à la course automobile. Il considérait celle ci comme un vecteur indispensable de publicité et surtout comme un banc d'essai sans pitié pour ses automobiles de série. Peu après sa prise de fonction, il embarquait ses ingénieurs dans l'étude de voitures destinées à la compétition.
Walter Becchia est à gauche d'Anthony Lago. Le pilote au premier plan est Philippe Etancelin. Copyright Bientôt, toute sa publicité reposait sur le fait que ses voitures de tourisme dérivaient de ses bolides de course. Becchia ne se fit pas prier pour mettre en oeuvre un programme destiné à faire gagner les Talbot. Il était pour un ingénieur de ce calibre certes plus palpitant d'animer un programme sportif d'envergure que de créer des voitures de série.
Louis Rosier en 1938 avec sa Talbot T 150 SS. Copyright Bechhia imaginait à partir d'un budget réduit une voiture de course complète. Celle ci était présentée au Salon de l'Automobile en 1936. Les succès escomptés n'allaient hélas pas être au rendez vous pour le moment. Face à Talbot, les Bugatti ou les Delahaye étaient plus compétitives. L'intervention de Lucien Girard, metteur au point de talent chez Zenith Stromberg, allait remettre à flot Talbot. La rencontre entre ce dernier et Walter Becchia fut décisive. Girard était séduit par le talent et la modestie de l'ingénieur italien, mais surtout sensible à la situation désespérée dans laquelle il se débattait avec ses voitures. Durant la journée, Girard se préoccupait des voitures destinées à des clients importants dans le cadre de sa mission. Mais le soir, il prenait sur son temps pour s'occuper des voitures de courses Talbot. Celles ci furent impitoyablement testées au banc plein gaz. Des appareils de mesures enregistraient les paramètres. Les tests étaient ensuite poursuivis à Montlhéry où Girard pilotait lui même les voitures. Les succès ne se firent pas attendre. En 1937, Sommer remportait le Grand Prix de Tunis devant Wimille sur sa Bugatti, mais aussi le Grand Prix de Marseille. Louis Chiron était sur la plus haute marche du podium à l'issue du Grand Prix de l'ACF. En septembre 1937, à la demande insistante de Becchia, Girard était recruté par Anthony Lago au poste de chef des essais et de directeur du service des courses. Talbot était enfin capable de faire face à ses adversaires. La multiplication des victoires renforçait le prestige de Talbot à travers le monde. Si les voitures de Suresnes ne jouissaient pas encore de la notoriété des Bugatti ou des Delahaye sur les circuits, elles s'en rapprochaient. Pour lutter contre ses concurrents français, mais aussi contre les redoutables Mercedes et Auto Union allemandes, Becchia et Girard décidaient de travailler sur une mécanique 4,5 litres dérivée du moteur 4 litre de la saison précédente. Les ingénieurs avaient auparavant envisagé un moteur 16 cylindres et dessiné une voiture dans ce sens. Finalement, le 4,5 litres rentrait sans peine dans la carrosserie de la monoplace prévue pour le 16 cylindres. Evidemment, le coût de cette solution plus économique était mieux adapté aux finances précaires de l'usine. Cette monoplace fit une courte apparition avant guerre lors du Grand Prix de Reims. Elle fut contrainte à l'abandon consécutif à un problème de conception du réservoir à essence. On la revit en 1946 lors de la Coupe des Prisonniers à Saint Cloud, neuve comme au premier jour. Elle y termina deuxième aux mains de Sommer derrière la Bugatti de Wimille. Paradoxalement, Anthony Lago n'était pas un fou de vitesse. Il était aussi conscient des dangers que courraient ses pilotes. C'est la raison pour laquelle il ne les poussa jamais à prendre des risques inconsidérés, ce qui ne manquait pas de frustrer les techniciens de son service course qui se démenaient pour conduire les Talbot sur la plus haute marche du podium. Une autre préoccupation d'Anthony Lago était de conjuguer ses capacités financières et ses ambitions sportives. Lors de l'édition 1939 des 24 Heures du Mans, contre l'avis de Becchia et Girard, il céda le volant d'une 4,5 litres à un pilote inconnu du milieu de la compétition, en fait un jeune banquier qui voulait se faire plaisir, mais sans aucune compétence en course. Le résultat fut catastrophique. Le pilote amateur après avoir em ... Becchia et Girard avec ses caprices abandonna la course au premier arrêt. Les ambitions d'Anthony Lago allaient surtout porter leurs fruits après guerre. 1934/1939, une offre abondante Entre temps, les voitures de série étaient devenues plus séduisantes sur un marché du luxe déjà encombré. Au prix d'efforts acceptés à tous les niveaux, l'usine tournait mieux. Malgré tout, l'équilibre financier demeurait précaire. Il fut mis à mal à mal en particulier par les acquis sociaux des ouvriers et des employés décidés en 1936.
Publicité parue dans La Vie Automobile en 1939. Copyright La gamme Talbot n'avait jamais été aussi riche que durant ces années d'avant guerre. Elle comptait onze modèles à la veille du conflit. Les ventes étaient stimulées par les victoires en compétition. La firme de Suresnes semblait avoir retrouvé une excellente santé et les Talbot étaient redevenues des voitures luxueuses et sportives très appréciées, dont la plupart étaient carrossées par l'usine. Le constructeur ne retrouva jamais ce niveau après guerre.
L'ensemble des modèles du catalogue 1939. Copyright Durant la guerre Pendant la guerre, l'usine qui avait échappé à la réquisition (Lago était de nationalité italienne) s'était endormie. Anthony Lago n'était cependant pas resté inactif. Il avait lancé l'étude d'un nouveau moteur capable d'être utilisé à la fois sur une voiture de course et de série. Le redémarrage Dans l'immédiat après guerre, l'entreprise survivait grâce à l'entretien et la réparation de moteurs et de transmissions automatiques provenant des véhicules de l'armée américaine. Mais en 1945, les caisses étaient une fois de plus presque vides. Le plan Pons établi au lendemain de la guerre définissait notamment l'attribution des matières premières entre les constructeurs automobiles. L'usine Talbot fut quasiment ignorée dans ce plan, et ce n'est qu'après plusieurs mois de négociation que Lago obtenait les moyens et le droit de produire une première série de voitures de luxe destinées à l'exportation uniquement. Pour faciliter un nouveau départ de la production à Suresnes, une modernisation des équipements s'imposait. Des achats de matériels américains auraient permis d'abaisser les prix de revient. Mais les autorités françaises ne laissaient pas Talbot agir à sa guise. On répétait en haut lieu que la fabrication de voitures de sport et de luxe appartenait désormais au passé. Pourtant, de l'autre côté de la Manche, Jaguar qui fabriquait " en série " des voitures " hors série " peinait à répondre à la demande en provenance des Etats Unis, mais surtout rapportait à la Grande Bretagne les devises tant convoitées et si nécessaires au redémarrage de l'activité économique. Talbot Lago Record Grâce aux études menées durant la guerre, Anthony Lago n'eut pas trop de peine à présenter sa nouvelle Talbot Lago Record dès mai 1946. Les lignes de la Record étaient au goût du jour. Par contre le châssis, excessivement lourd, était encore dérivé des modèles d'avant guerre. La fabrication de la carrosserie faisait toujours appel aux anciennes méthodes. Des panneaux tôlés recouvraient une armature en bois. Les autres éléments mécaniques (boîte de vitesse, suspensions ...) commençaient aussi à dater. Heureusement, la puissance du nouveau moteur compensait cette lourdeur.
Du rêve à la réalité, Talbot Lago Record. Copyright La plupart des châssis étaient habillées directement par Talbot qui disposait d'un atelier de carrosserie bien équipé. Le style maison avait cependant du mal à se renouveler, et quelques clients préféraient faire appel à des carrossiers indépendants. La Talbot Lago Record fut fabriquée à 600 exemplaires, performance honorable, et plus jamais atteinte par aucune autre Talbot par la suite.
Cabriolet Talbot Lago Record par Saoutchik. Copyright Dans le numéro 22 du 15 janvier 1951, André Costa essayait la voiture : " La Talbot Lago Record représente depuis la disparition quasi totale de la 175 Delahaye, la seule voiture " luxe et sport " française de très grosse cylindrée. C'est en partant du moteur 4482 cm3 qui équipe ce châssis que Antony Lago a créé la 4,5 litres Lago de course qui défend nos couleurs dans les grandes épreuves sportives de la formule 1 ... Par beau temps et sur route droite, les possibilités de cette voiture sont pratiquement illimitées pour un amateur et pour ne donner qu'un exemple, nous enregistrâmes des portes d'Auxerre à l'entrée de Joigny, la moyenne assez vertigineuse de 134 km/h ... La tenue en côte efface littéralement les rampes de quelque importance ... La consommation est étroitement fonction de la vitesse et peut osciller entre 18 et 25 litres .... Lorsque l'on atteint 150/160 km/h, c'est ensuite une véritable clameur jointe au déplacement d'air le long de la caisse qui s'élève peu à peu et atteint rapidement des proportions réellement importantes. Agréable peut être aux oreilles d'un sportif, ce bruit n'en sera pas moins désagréable pour l'utilisateur moyen qui se déclarera assurément assourdi après quelques dizaines de kilomètres ... Sur une route glissante, bombée et sous une pluie battante agrémentée de rafales de vent, la voiture ne manifeste aucune tendance à se dérober à 160 km/h ... La Record n'a que modérément sacrifié à la mode et nous laisserons à chacun le soin de se faire une opinion. Il est infiniment dommage qu'une fabrication en petite série contraigne les usines Talbot à des méthodes de travail que d'aucun jugeront surannées et qui imposent des caisses tôlées à armature de bois d'un poids nettement excessif. Quand à la finition et à l'assemblage, les deux paraissent réalisés avec grand soin .... D'un point de vue général, la Talbot Lago Record peut donc être considérée comme une réussite ... Quel dommage qu'une caisse plus légère de 250 kg ne soit pas offerte aux usagers, augmentant encore sensiblement les possibilités de la voiture .... Notons pour conclure qu'il sera intéressant de comparer les résultats de ce banc d'essai à ceux que nous obtiendrons avec la Jaguar que nous devons essayer prochainement ". Talbot Lago Grand Sport Après la Record, la gamme se développait en 1948 avec une version plus aboutie, plus courte de 47 centimètres, et allégée en 400 kg, la Talbot Grand Sport. Cette voiture fut quasi exclusivement livrée en châssis nu, et fit la joie de plusieurs carrossiers. Sa fabrication demeura toutefois confidentielle, tout au plus une dizaine de châssis en 1948 puis en 1949, et au total 46 châssis jusqu'en 1953.
La confidentielle Talbot Lago Grand Sport telle qu'elle était présentée dans le catalogue d'octobre 1951. Elle ne fut quasiment livrée qu'en châssis nu, et en tout cas jamais produite sous cette forme. Copyright Talbot Lago Baby La Talbot Lago Baby, dotée d'un petit 4 cylindres, était dévoilée au salon de Paris en 1949. Ce modèle plus économique allait d'une part permettre de renouer avec la clientèle d'avant guerre fidèle à ces mécaniques plus modestes, d'autre part de séduire un public moins âgé qui n'avait pas les moyens d'acquérir une grosse Talbot. Son prix était tout de même deux fois plus élevé que celui d'un Citroën Traction 15 CV. La Baby reposait hélas sur l'ancien châssis raccourci mais encore trop lourd de la Record. Malgré son manque d'élégance, la " petite " Talbot connut un succès d'estime, avec 520 exemplaires fabriqués.
Talbot Lago Baby, dépliant 4 pages, format 275 x 126 - Anthony Lago fit appel à Géo Ham en 1950 pour illustrer le catalogue de la nouvelle 15 CV Baby. Copyright André Costa passait la Talbot Lago Baby au banc d'essai de l'Auto Journal, numéro 18 du 15 novembre 1950 : Talbot reste aujourd'hui l'une des très rares survivances du groupe de marques françaises spécialisées dans les voitures de sport et de luxe qui firent jadis le renom de notre industrie automobile. La firme de Suresnes parvient, en dépit d'une époque qui se prête de moins en moins à ce genre de fabrication en petite série, à conserver intact son standing et s'offre même le luxe (coûteux) d'entretenir sans aucun appui extérieur une écurie de course sans laquelle nous aurions, dans la formule n° 1, perdu toute possibilité de voir nos couleurs s'aligner. La Talbot Lago Baby qui unit le nom de la marque à celui de l'ingénieur en chef de la firme est née voici un an et cette voiture aura, plus qu'une autre, ses partisans et ses détracteurs selon que ses possesseurs s'écarteront au non du but que s'est vraisemblablement fixé le constructeur ... Le moteur de la Baby est le plus gros 4 cylindres que nous connaissions et mérite à ce titre d'être apprécié pour son bon équilibrage aux bas régimes .... Le moteurs atteint les hauts régimes et s'y maintient avec facilité ; il vrombit alors allègrement, ajoutant par là même un agrément pour le conducteur sportif qui aime " sentir " son moulin ... et un désagrément pour celui qui recherche avant tout le silence ... Il faut déplorer nettement le poids de cette voiture (1500 kg) que deux cent kilos privent d'une grande partie des qualités qu'on aurait aimé lui trouver sans discussion .... Il est naturel, dans le cas d'une voiture de luxe, d'attacher une importance plus grande encore à l'esthétique que pour une voiture de série. Talbot demeure l'un des derniers représentants de cette école dite traditionaliste dont on ne trouve guère plus trace qu'en Grande Bretagne et en France. Pour notre compte personnel, nous avons être assez sensibles à l'équilibre des lignes de la Baby. La sobriété de cette interprétation moderne des lignes classiques Talbot ne présente guère de défauts, mais en fait, la discussion est impossible : ce style plaît ou ne plaît pas. Il n'y a pas lieu d'hésiter à porter au crédit de la voiture une qualité de finition qu'il est rare de rencontrer de nos jours ainsi qu'un assemblage paraissant être réalisé avec soin ... En guise de conclusion, nous terminerons ce compte rendu d'essais par un conseil tout désintéressé : La Talbot Lago Baby n'est pas une voiture pour tout le monde (nous ne voulons pas parler seulement de son prix) et l'homme d'affaires qui cherche avant tout un moyen de transport fera mieux de diriger son choix vers un autre modèle. Cette voiture est, à notre avis, réservée au véritables amateurs qui savent apprécier une machine réellement vivante, répondant à la moindre sollicitation et transmettant fidèlement à son conducteur les sensations fugitives nées de la vitesse et de la route. En un mot, la Baby est faite pour ceux qui désirent une voiture qui, sans être soumise à toutes les servitudes des modèles Sport, n'en est pas moins sportive "
L'Auto Journal qui revendiquait son indépendance pouvait difficilement se passer de publicité. Celle ci vantait les mérites du système de changement de vitesse automatique Wilson, et figurait en bonne place sur la page du banc d'essai de la Talbot Lago Baby, seule marque française à équiper ses voitures d'une boîte pré sélective Wilson. Copyright Les carrossiers Comme ceux de Delage ou Delahaye, les châssis Talbot étaient des incontournables pour les grands carrossiers qui vivaient à la fin des années 30 et dans l'immédiat après guerre leurs dernières belles années. Aucun ne manquait à l'appel : Antem, Chapron, Figoni, Franay, Graber, Letourneur et Marchand, Pourtout, Saoutchik, etc ... Enumérer les travaux de ces carrossiers serait une tâche bien trop fastidieuse. A défaut, voici quelques réalisations d'avant et d'après guerre.
Talbot-Lago T23 Coupe par Figoni & Falaschi, 1938. Copyright
Talbot-Lago T26 GS Cabriolet par Saoutchik, 1948. Copyright
Talbot-Lago T26 Record Cabriolet par Saoutchik, 1947. Copyright
Talbot-Lago T26 GS Coupé par Saoutchik, 1948. Copyright
Talbot-Lago T26 GS Cabriolet par Franay, 1949. Copyright
Talbot-Lago T26 GS Coupé par Figoni et Falaschi, 1949. Copyright
Talbot-Lago T26 GS Coupé par Saoutchik, 1950. Copyright
Talbot-Lago T26 GS Coupé par Graber, 1951. Copyright
Talbot Lago T26 GS Coupé par Pennock, 1951. CopyrightLe retour des Talbot sur les circuits Anthony Lago ne perdit jamais de vue la compétition automobile qui lui permettait d'asseoir sa notoriété. Il savait que la clientèle sur ce marché du haut de gamme était sensible aux victoires dans les plus grandes courses. Dans son numéro d'octobre 1949, le mensuel L'Action Automobile et Touristique présentait ainsi Talbot : " Lorsqu'on dit Talbot, on pense immédiatement course. Depuis toujours, Talbot a sacrifié à la compétition sportive. La France lui doit d'être encore présente dans les grandes épreuves internationales, mais aussi et surtout d'y briller parfois d'un vif éclat. Grâce en soit rendue à Talbot, l'un des rares parmi les constructeurs qui s'emploie, avec une constance admirable, à façonner chaque jour un outil meilleur aux mains de nos champions ... La victoire d'une Talbot de course a une signification pour l'usager d'une Talbot de série, car n'importe quel possesseur de Lago Record ou de Lago Grand Sport qui se penchera sur le capot ouvert d'une Talbot de course reconnaîtra son propre moteur " Le génial Becchia quittait Talbot pour Citroën où il dessina le moteur de la 2 CV. Un nouvel ingénieur, Carlo Marchetti, mettait au point une nouvelle version du fameux 6 cylindres de 4,5 litres. Talbot en fabriquait une vingtaine d'exemplaires en trois ans.
L'atelier de montage des voitures de compétition monoplace 4,5 litres à Suresnes vers 1948. Copyright Une belle série de victoires marquait l'existence de la marque entre 1947 et 1951, malgré des moyens toujours limités. En dehors de l'équipe d'usine, plusieurs pilotes indépendants de renom et propriétaires de leur voiture faisaient des merveilles au volant des Talbot : Louis Chiron, Raymond Sommer, Juan Manuel Fangio, Philippe Etancelin, Pierre Levegh, Charles Pozzi, Louis Rosier, Harry Schell, etc ...
A. Lago et R. Sommer, après la victoire d'une Talbot lors du GP du Salon à Montlhéry en 1949. Copyright L'ATT saluait le travail accompli par Anthony Lago lors de la victoire au GP de Reims de 1949 : " Une des conséquences les plus heureuses du Grand Prix de France, fut de mettre en lumière le splendide effort de Talbot, puisque sur 8 voitures de cette marque au départ, 4 passèrent la ligne d'arrivée, l'une d'elles, on le sait, triomphant aisément de ses concurrentes les plus qualifiées, nées des industries britannique et italienne. Un tel résultat, au moment où l'on pouvait désespérer de nos couleurs, fait honneur à la construction française. Le mérite en revient à M. Lago, animateur de la marque, et à son fidèle second, l'ingénieur Marchetti qui, tous deux, depuis quatre ans, ont travaillé avec une foi et un enthousiasme qui ne se sont jamais relâchés ".
Dans le même numéro de l'AAT d'août 1949, croqués par Pavil, Chiron se voyait remettre la coupe sous l'oeil bienveillant de Lago et Fangio. Copyright 1950 fut l'année de la consécration en compétition avec entre autres la victoire au Mans. Talbot avait déjà participé à la course mancelle, avec un abonnement à la troisième place en 1930, 1931, 1932 et 1938. Cette fois, à l'issue d'une course épuisante, Louis Rosier remportait la victoire face aux Aston Martin, Jaguar, Delahaye, Ferrari ...
Page de couverture du numéro 9 du tout jeune Auto Journal. Copyright Louis Rosier, garagiste à Clermont Ferrand, était une force de la nature. Après treize heures de pilotage entièrement seul, il s'arrêta au stand en raison d'un problème mécanique. Après quarante minutes d'arrêt, il reprenait le volant et retrouvait la première place en trois heures. La légende raconte que son fils Jean Louis ne le remplaça que pendant deux tours, ce qui lui permis de manger deux bananes. Une autre Talbot pilotée par Meyrat et Mairesse se classait en deuxième position à seulement 25 kilomètres de distance.
France Illustration, octobre 1950 - © : L'Illustration (www.lillustration.com) Presque tous les organes des voitures de courses étaient communs à ceux des modèles de tourisme, ce qui conférait leur pleine valeur aux performances obtenues en compétition. Autre avantage, la consommation des Talbot de course était plus de deux fois moindre (moins de 30 litres au 100 km) que celle des Ferrari ou Maserati. L'avantage était évident, car il permettait aux Talbot de réduire les ravitaillements.
Dans les stands en 1951, Louis Rosier au volant est en pleine discussion avec son équipier Juan Manuel Fangio. Copyright
Anthony Lago en discussion avec un de ses pilotes en 1950. L'homme en imposait avec sa grande taille et son embonpoint. Copyright
De gauche à droite, Antony Lago, Louis Rosier, et deux représentant de la maison Bisquit, supporter de Rosier, à l'issue d'une réception donnée dans les locaux de l'AAT après la Panaméricaine de 1953. Copyright L'écurie officielle Talbot était dissoute en 1951. Mais les voitures Talbot demeuraient présentes en course, grâce aux pilotes indépendants. Au Mans, en 1952, à deux heures de la fin de la course, Pierre Levegh qui n'avait pas encore cédé le volant à son coéquipier Marchand menait la ronde avec une confortable avance sur l'équipe officielle Mercedes. Mais le pilote, fatigué par 22 heures de pilotage, cassait son moteur, laissant à ses rivaux une victoire qu'ils n'espéraient plus.
Le nom de Darracq demeura associé à la raison sociale de Talbot jusqu'à la fin des années 50, extrait d'un dépliant publicitaire de 1955. Copyright Anthony Talbot se débat dans d'interminables difficultés Depuis trop longtemps, Talbot Lago ne cessait de perdre de l'argent. Les coûts de production étaient supérieurs aux prix de ventes, en raison d'une fabrication demeurée artisanale. 155 voitures furent fabriquées en 1947, puis 233 en 1948 et 225 en 1949. Le développement des voitures de courses représentait une dépense faramineuse. Au final, les succès sur les circuits coûtaient plus d'argent qu'ils n'en rapportaient. Et il ne fallait pas compter sur les pouvoirs publics, mêmes si les victoires des Talbot permettaient de faire retentir la " Marseillaise " à l'arrivée des Grand Prix. La production Talbot culminait toutefois à 433 voitures en 1950, le meilleur score d'après guerre. A titre de comparaison, Il fut produit cette année là 83109 Renault, 64761 Citroën, 48177 Peugeot, 28995 Simca, 18223 Ford SAF, 10014 Panhard, 1787 Hotchkiss, 1162 Panhard, 395 Rovin et 235 Delahaye. A cours de trésorerie, et faute d'une remise en cause conséquente de son organisation, Talbot Lago déposait le bilan en janvier 1951. Les ouvriers de Suresnes allaient t'ils être réduits au chômage ?
Publicité parue dans la presse en 1950. Copyright Anthony Lago fit face aux bruits qui annonçaient l'arrivée de la grande aciérie Pont à Mousson aux commandes de Talbot. De lui même, il rompit les pourparlers, soucieux avant tout de conserver sa liberté. Le patron s'estimait encore suffisamment vaillant pour poursuivre ses activités. Un plan était présenté à l'administrateur judiciaire qui prévoyait à la fois la suppression du ruineux service de course et la simplification de la gamme grâce à l'utilisation de carrosseries et de châssis semblables pour ses gammes Baby (4 cylindres, 15 CV fiscaux) et Record (6 cylindres, 26 CV fiscaux). L'usine de Suresnes était de nouveau en mouvement, après avoir réduit ses effectifs à 220 personnes. Un nouveau style pour les Talbot Les nouvelles Talbot apparaissaient en juin 1951. Le plan de relance prévoyait d'atteindre un rythme annuel de 1000 voitures, réparti entre 700 Baby et 300 Record.
Talbot Lago Record à partir du printemps 1951, la rupture de style était violente. La nouvelle Record est ici photographié sur la bretelle d'accès au premier tronçon français d'autoroute à l'Ouest de Paris, signe de modernisme. Copyright
L'annonce de l'arrive de la nouvelle Lago Baby fit la " une " de l'Auto Journal en juin 1951. Copyright Encore une fois, les nouvelles Talbot ne séduisaient pas vraiment la clientèle traditionnelle de la marque, décontenancée par ces voitures aux lignes épaisses et lourdes, moins viriles que celles de la précédente génération. Leur dessin semblait en contradiction avec l'image sportive de la marque. Paradoxalement, Talbot s'était depuis la fin de la guerre attaché une clientèle assez traditionnelle, que le style démodé de ses voitures n'indisposait pas outre mesure. Seuls quelques clients estimaient que les nouvelles Talbot ne manquaient pas d'élégance, et jugeaient favorablement le grand volume habitable offert.
Le stand Talbot au Salon de l'Automobile en octobre 1952. Copyright La nouvelle gamme Baby et Record ne trouvait décidemment pas sa place sur le marché. A force de rebondissement, l'image de Talbot était désormais gravement atteinte. Cette série de berline fut la dernière pour Talbot, qui à partir de 1955 se cantonna à la production de coupés à deux portes. Les conséquences étaient terribles : Talbot vendait 80 voitures en 1951, 34 en 1954 et 17 en 1955. Le paradoxe était total pour Talbot. Pendant que la marque glanait les succès sur les circuits, que le prestige de la marque en bénéficiait, au contraire, la production des automobiles de tourisme déclinait inexorablement. Talbot devait encore se serrer un peu plus la ceinture. La cause semblait pourtant perdue pour le prestigieux constructeur de Suresnes, qui ne survivait plus que grâce à la sous-traitance et à l'aide du pétrolier BP. La presse spécialisée parle de Talbot Dans le numéro 74 du 15 mars 1953, Roger Couderc rendait visite à Antony Lago au 33 Quai du Général Gallièni. Extraits : " Si j'avais rencontré ailleurs que dans une usine cet homme grand, épais, à la démarche pesante, visage ouvert et sympathique, j'aurais sans doute pensé " Tien, voilà un gentleman, ". M. Lago est un mélange de Victor Mac Lenglen et de Raimu, une synthèse de force et de bonhomie. " J'ai horreur des manifestations officielles ", me confie t'il, " et l'on ne me voit nulle part, sinon à l'usine, et je ne suis heureux que lorsque mes moteurs tournent rond. Pour faire du bon travail dans l'automobile, pour être un " animateur ", il faut avoir le feu sacré et être du bâtiment. J'ai trente quatre ans de métier derrière moi et pourtant j'apprend encore chaque jour quelque chose ". M. Lago se lève et enfonce sa casquette. " Elle ne me quitte pas, dit-il en souriant. J'ai adopté cette coiffure lorsque je travaillais en Angleterre, chez Sunbeam, en 1934. Venez, nous allons faire un tour dans l'usine. " Nous traversons une salle immense où s'alignent plus de 700 machines. Au fond, il y a un atelier grillagé avec un important cadenas sur la porte qui interdit aux curieux l'entrée de ce sanctuaire. Car c'est là que sont rangés, côte à côte, les châssis et les carrosseries des trois voitures qui prendront le départ des 24 Heures du Mans ... " " ... il n'est plus question de vendre les voitures aux conducteurs. Cette année, Talbot défendra directement son pavillon. Il y aura donc une " écurie Talbot " qui aura une tactique à suivre " ... " à combien peut revenir pour une année une écurie de course ? Je suis persuadé que Mercedes et Alfa dépensent de quatre à cinq cents millions. Il faut à peu près ça, d'ailleurs ... Et c'est là que commence la tragédie de la course française. Car nous manquons d'argent et nous sommes accablés de difficultés et de soucis " ... je ne crois pas aux subventions et, par exemple, à l'aide fournie par les " fonds de course " ... Je n'ai jamais songé un seul instant à cette solution qui me paraît boiteuse et insuffisante. En ce qui concerne Talbot, si la crise que traverse actuellement la voiture de luxe pouvait s'atténuer et si nous pouvions obtenir quelques commandes du ministère de la Guerre - et nous sommes très bien placés - le problème de la course serait résolu pour moi. Au sein d'une usine qui tourne bien, une équipe de course est un élément de prestige et de publicité indiscutable, donc les frais qu'elle représente sont justifiés. C'est là où est la solution et pas ailleurs ". M. Lago a remis sa casquette. Notre entretien est terminé. Sa poignée de main est franche, solide. Il me dit " A bientôt ... sur les pistes ". Et l'homme tranquille s'éloigne à pas lents dans l'usine, dans cette usine qui est sa vie ... " Extrait de l'Action Automobile et Touristique de février 1955 : " Présentement, l'activité de cette société consiste essentiellement dans la fabrications de moteurs Talbot qui équipent les chenillettes Hotchkiss. Accessoirement, M. Lago sous-loue à d'autres industriels la partie inemployée de ses ateliers du Quai Gallieni à Suresnes. C'est ainsi que la Société Velam, qui entreprend en France la fabrication des " Isetta " installe sa chaîne chez Talbot. En ce qui concerne la voiture automobile proprement dite, on n'a pas oublié que le nom de Talbot a figuré maintes fois, et encore ces dernières années, au palmarès des grandes épreuves sportives. On lui doit cet hommage et on le lui rend bien volontiers. Il n'en reste pas moins que dans la dernière statistique officielle du Ministère de la Production Industrielle, le nom de Talbot ne figure plus dans la rubrique " voitures particulières ". On nous affirme d'autre part, que la marque a quand même, construit et livré quelque vingt voitures en 1954. Quant aux projets, M. Lago n'en manque pas. Il a presque tout prêt, un moteur 2500 cmc qu'il destine à la compétition en " formule 1 " ou en sport. On est prêt à lui faire confiance, tout en notant qu'on parle de ce moteur depuis deux ans déjà. Qu'en conclure ? Tout simplement au manque de moyens pour achever une réalisation sans doute pleine de promesses. Nous retombons au fond du drame ... " Coupé Lago Grand Sport, un dessin moderne, mais qui ne séduit plus En octobre 1953 au Salon de Paris, la Grand Sport recevait une toute nouvelle robe. Anthony Lago espérait attirer une clientèle plus large avec cette carrosserie moderne fabriquée dans son usine, donc moins coûteuse que les habillages réalisés à l'unité par les carrossiers. Le dessin de l'auto était l'oeuvre de Carlo Delaisse de chez Letourneur et Marchand. Il signait là une création totalement différente de ce qu'il faisait alors pour le carrossier de Neuilly. Les lignes tendues prenaient le meilleur des tendances stylistiques italiennes et anglaises du moment. La célèbre calandre verticale était remplacée pour la première fois par une face avant basse et large. Le mouvement des ailes arrière dynamisait l'ensemble. Le traitement des surfaces vitrées, avec une lunette arrière panoramique, donnait une impression de vitesse, même à l'arrêt.
Talbot Lago Grand Sport. Copyright La Lago Grand Sport offrait quatre places assez confortables. Elle était capable d'atteindre 190 km/h. Néanmoins, elle demeurait lourde (1610 kg) et très encombrante pour sa catégorie (485 cm de long, 185 de large). Son prix élevé et sa consommation de carburant (19 litres à 110 km/h, 34 litres à 170 km/h) ne la mettaient pas en situation favorable vis à vis de la concurrence. Sa production fut suspendue dès 1955, après qu'une quinzaine de voitures aient été fabriquées. Bernard Carat essayait la Talbot Grand Sport dans le numéro 107 de l'Auto Journal d'août 1954. Il précisait que la Talbot était inconditionnellement la plus rapide des automobiles françaises, et aussi, de l'avis à peu près général, la plus élégante. Nerveuse, tenant bien la route, elle pouvait combler l'homme d'affaires ayant à parcourir de longs trajets rapidement, malgré son manque de souplesse, son poids et son encombrement. Un programme sportif moribond La victoire au Mans en 1950 n'était plus qu'un lointain souvenir. Pour participer à l'épreuve Mancelle de 1955, Anthony Lago, avec l'appui financier du pétrolier BP, équipait ses voitures de moteurs Maserati, sans succès. Anthony Lago rêvait encore d'imposer ses voitures en 1957. La première Talbot Maserati ne prenait pas le départ, tandis que la seconde abandonnait après quelques minutes de course. Ce fut la dernière apparition d'une Talbot sur un circuit. Coupé Lago Sport, des derniers espoirs Anthony Lago ne désespérait pas pour autant, et dévoilait dans l'adversité en mai 1955 la Lago Sport, une réduction au pantographe de la Grand Sport. S'aligner sur l'offre des concurrents était une nécessité pour le constructeur. La Sport était techniquement très différente de la Grand Sport. Elle ne disposait que de deux places. Sa longueur avait été réduite de 65 centimètres et elle était plus légère de 600 kg. La boîte présélective Wilson qui avait jusqu'alors fait les beaux jours de Talbot cédait sa place à une boîte plus classique Pont-à-Mousson. Le 6 cylindres 4,5 litres de 26 CV fiscaux était remplacé par un nouveau 4 cylindres de 2,5 litres (2491 cm3) et 120 ch (14 CV fiscaux).
La Lago Sport ressemblait à la Grand Sport, elle était pourtant plus courte de 65 centimètres. Copyright L'Action Automobile et Touristique dans son numéro de juin 1955 commentait ainsi la présentation de cette nouvelle Talbot : " La ligne générale de la carrosserie est séduisante et semble avoir été traitée de manière à offrir une moindre résistance à l'air et à donner aux passagers une excellente visibilité. La performance de 200 à l'heure en vitesse de pointe, annoncée par le constructeur, place d'ailleurs cette voiture parmi les plus rapides de la catégorie, où l'on trouve notamment la Lancia Aurelia 2500, la Salmson 2300, l'Alfa Romeo Super Sprint 1900 C, l'Aston Martin DB 2-4 et la Austin Healey 100 ". Faute de moyens suffisant, la fabrication régulière de la Sport fut longue à se mettre en place. La production ne commençait qu'au cours de l'hiver 1955/56. Désormais, la survie de la firme de Suresnes était suspendue à la réussite commerciale de ce modèle.
Dépliant publicitaire de la Talbot Lago Sport. Copyright Hélas, seulement 54 exemplaires furent fabriqués jusqu'en 1957. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce manque de réussite. Par rapport à des concurrentes produites industriellement, la Talbot Lago Sport demeurait coûteuse à l'achat. Par ailleurs, depuis quelques années, la clientèle hésitait à acheter une voiture chez Talbot que l'on disait en grande difficulté. Le 4 cylindres de la Lago Sport supportait mal les hauts régimes. Il avait été poussé dans ses derniers retranchements, et des doutes subsistaient quant à sa fiabilité. Enfin, Talbot devait composer avec une quasi absence de réseau après vente capable de rassurer l'usager.
Talbot Lago bénéficiait en 1955 du soutien financier du pétrolier BP. Copyright Le constructeur ne parvenait pas à amortir le coût du développement de sa Lago Sport sur le peu de modèles fabriqués. Il les vendait encore à perte. Pour survire, Anthony Lago fut contraint de produire des moteurs de chenillettes pour Hotchkiss, et louait une partie de ses installations à Velam, qui préparait le lancement de sa petite Isetta.
Présentation de presse, le sponsor BP est toujours au rendez vous. Copyright Coupé America, Talbot se tourne vers BMW Le moteur 14 CV ayant déçu, Talbot à l'agonie faisait appel à BMW pour la fourniture de mécaniques, dans le secret (mais vain) espoir de vendre ses voitures aux Etats Unis. Le V8 de la BMW 502, modifié pour Talbot - la cylindrée fut ramenée à 2476 cm3 pour ne pas dépasser la catégorie fiscale des 14 CV -, équipait ainsi les dernières voitures, rebaptisées Lago America. Le miracle n'eut pas lieu. Douze exemplaires furent produits au total. Les ultimes voitures étaient écoulées en 1958 et 1959.
Talbot Lago America. Copyright Talbot Lago s'abandonne à Simca 1958 sonnait le glas. L'image de l'entreprise était désormais trop détériorée pour qu'un quelconque redressement commercial puisse être envisagé. Talbot se mourait. L'entreprise n'avait plus les moyens d'assurer son quotidien. Après 24 ans passés à soutenir Talbot, en évitant toujours le pire, Anthony Lago n'avait pas d'autre choix que d'abandonner sa marque et son entreprise à l'entreprenant Henri Théodore Pigozzi, fondateur et PDG de Simca. Le constructeur de Poissy se retrouvait à la tête d'un petit stock d'une dizaine de coupés Talbot dans lesquels il n'était pas question de monter les V8 de chez BMW. D'ailleurs, l'autorisation d'importation du moteur BMW fut suspendue par les pouvoirs publics. Il fut décidé d'équiper les Talbot d'un moteur puisé dans la gamme Simca. C'est ainsi que cinq voitures furent animées par l'anémique V8 (95 ch) de la Simca Chambord. Il s'agissait d'un outrage à l'histoire, dans la mesure où ce moteur déjà ancien ne fut jamais conçu pour une voiture de tourisme rapide. Talbot Star Six, à en pleurer La dernière Talbot à être exposée au Salon de Paris fut en 1959 le concept car d'inspiration américaine dénommé Star Six dessiné par Virgil Exner Junior. Le communiqué de presse précisait : " La Talbot Star Six est l'oeuvre d'un jeune styliste américain, Virgil M. Exner Jr., qui, appliquant les techniques les plus avancées en matière de design et de construction automobile, avec notamment l'emploi de la fibre de verre pour la carrosserie super aérodynamique, a choisi la base mécanique de notre dernier modèle Simca Etoile Six, pour réaliser dès aujourd'hui la Talbot de sport de demain ".
Virgil Exner Junior aux commandes de la Talbot Star Six. Copyright En vérité, c'est un châssis de Simca 8 de 1950 qui fut utilisé. Cette voiture du futur n'était en fait que le fruit de la thèse de fin d'étude dans la section de design automobile de l'Université de South Bend dans l'Indiana du jeune Exner. Elle fut fut ensuite exposée au Henry Ford Museum de Détroit. C'est là que des responsables de Simca en voyage d'étude aux Etats Unis eurent une surprise en découvrant ce concept car portant le nom de la marque qu'ils représentaient. Contact fut pris avec Virgil Exner père, alors responsable du style chez Chrysler, qui accompagna la voiture en France, dans le cadre des relations en cours entre Chrysler et Simca. Sans état d'âme, Simca présenta l'oeuvre d'Exner Junior comme un prototype de Talbot capable d'atteindre 200 km/h ! Une fois exposée, la voiture fut rapatriée aux Etats Unis à destination de son concepteur, sans les écussons Talbot, avec pour récompense et en remerciement un exemplaire du nouveau cabriolet Fiat 1500 à moteur Osca. L'Auto Journal, dans son numéro 233 du 1er novembre, n'y allait pas de main morte : " Que dire aussi de l'exhibition sur un stand appelé Talbot, d'une " Star-Six ", sorte de monstre, construite par un étudiant américain pour laquelle on a placé les écussons Talbot ! Un moteur 6 CV se cache, paraît il, sous son capot et Simca annonce tranquillement que, grâce à une simple augmentation du taux de compression, la puissance du 1100 est passée de 40 à 80 CV. Tout cela manque de sérieux et nous ne comprenons pas comment M. Lago, dépositaire du nom d'une marque française, se soit prêté à cette pantalonnade " .
Le jeu des 7 familles est un jeu qui se joue avec 42 cartes, réparties en 7 familles de 6 cartes . Copyright Epilogue En Europe, la seconde guerre mondiale avait mis l'industrie automobile à genou. Durant les années 50, l'heure n'était plus aux voitures de luxe produites à la main, mais aux modèles de grande série. Le gouvernement avait assigné les firmes de luxe à ne construire que pour l'exportation, afin de faire rentrer quelques devises étrangères. Les prestigieux constructeurs français s'étaient empêtrés dans des modes de construction traditionnels. Ils avaient peiné à renouveler l'apparence de leur voitures. Pendant ce temps là, l'école italienne, avec un style nouveau, plus moderne, mais aussi l'Amérique, avec ses premiers show cars, enterraient définitivement la vieille école française. Talbot Lago fut pourtant le dernier grand constructeur de prestige d'avant guerre à survivre jusqu'à l'aube des années soixante. Avant lui, Delage, Delahaye, Bugatti, Salmson et Hotchkiss avaient périclité. La longue agonie de la marque Talbot fut extrêmement douloureuse. Anthony Lago ne résista pas à la disparition de son empire. Il mourait en 1960 à l'âge de 67 ans. Il repose dans le caveau de famille de Prédore, sur les bords du lac de Côme qu'il aimait tant.
Anthony Lago. Copyright En 1959, Georges Grignard, pilote sur Talbot, rachetait tout le stock de pièces et de documentations de Talbot Lago en liquidation. Il se retrouvait par la force des évènements fournisseur pour les collectionneurs des voitures de Suresnes à travers le monde. Un recensement des Talbot encore existantes fut mené par deux passionnés de la marque, Dominique et Marc Dupont, qui avaient récupéré le stock de Georges Grignard à sa mort en 1977. Ce travail de fourmi permettait à l'issu de deux ans de recherches de répertorier 540 propriétaires de Talbot fabriquées à Suresnes, équivalent à 750 voitures, réparties à travers le monde. Evidemment, une grande majorité, 580 voitures, résidaient encore en France. 1959 - 1979 : La traversée du désert Une traversée du désert de vingt ans Au cours des années 60, le groupe Chrysler avait acquis par étape une position dominante dans le groupe Rootes en Angleterre et chez Simca en France, avant de prendre intégralement le contrôle de ces deux entités. Chrysler propriétaire du nom Talbot n'eut pas l'occasion de s'en servir. Pourtant, en septembre 1965, le mensuel " L'Automobile " évoquait le retour possible de Talbot dans un article intitulé " où en est la voiture de prestige française " : " En novembre 1964, lors d'une conférence de presse, Georges Héreil, le patron de Simca, laissait entrevoir la création d'une voiture de prestige portant le nom de Talbot. En mai 1965, il annonçait la création d'une " grosse voiture " qui serait assemblée dans l'usine de La Rochelle et vendue à moins de 200 000 F. Le moteur serait un Chrysler, 6 cylindres, 2,8 litres de 16 CV. En fait, il semble bien que la Talbot et cette " grosse voiture " ne forment qu'un seul et même modèle c'est à dire une Plymouth Valiant munie d'une calandre Talbot. Nous espérons nous tromper, mais si c'est là la future voiture de prestige et si la calandre très française de Talbot se trouve placée sur une voiture américaine, qui est de surcroît considérée comme une " compact " aux USA, il y a là de quoi scandaliser les fanatiques (et il en reste) de l'écusson Talbot. Etant donné les accords Simca Chrysler, le choix aurait au moins pu être porté sur un très gros moteur, le V8 de la Chrysler 300 L qui, avec 6,7 litres développe quelques 365 ch SAE à 4800 tr/mn. Espérons que Georges Héreil, à qui l'on a donné le titre de premier voyageur représentant de France, ne laissera pas faire une chose pareille ... " En décembre 1966, une brève dans le même mensuel revenait sur la renaissance éventuelle de la marque Talbot : " Lors de sa récente conférence de presse, M. Georges Héreil, président directeur général de Simca, a répondu à un certain nombre de questions intéressantes. Il nous paraît opportun de donner in extenso le texte de sa réponse à la question " 0ù en est le projet Talbot ? ". " Le projet Talbot est un peu dans le puit. Il n'est pas certain qu'il en sorte. Je ne voudrais pas qu'il y ait un malentendu à cet égard, entre la presse et moi-même. Je n'ai pas exactement parlé d'un projet Talbot, j'ai dit que le nom de Talbot nous appartient en propre et que nous essaierons de garder à ce nom prestigieux une valeur de rayonnement pour notre pays, dans le monde entier. Ceci étant, il y a deux utilisations possibles du nom de Talbot. Une première utilisation nous fait remonter aux origines de Talbot, c'est à dire à la voiture de luxe, de confort et de prestige. Par conséquent, il conviendrait de réserver le nom de Talbot à une telle voiture. Je n'exclus pas cette éventualité car il y aura, un jour, incontestablement, une voiture de prestige Simca, du fait de l'élargissement futur de notre gamme. Il faudra qu'un tel modèle existe et il pourrait recevoir l'appellation de Talbot. Une seconde utilisation : certains ont pu croire que je pensais à Talbot Lago, voiture de compétition. En fait, ce n'était pas le cas. Mais nous sommes prêts à examiner les possibilités de coopération dans le domaine de la voiture de course avec d'autres constructeurs français ou étrangers, car l'entreprise est d'une dimension telle qu'on ne peut pas s'y engager seul. Je n'écarte pas la possibilité que, dans ce domaine, le mot Talbot soit utilisé, puisqu'une telle aventure, si elle se produisait, résulterait nécessairement de la coopération de plusieurs marques, de plusieurs sociétés et qu'elle procéderait d'une oeuvre commune à laquelle nous nous associerions ... " 1979 - 1986 : Revival Talbot Revival Chronologie
- Automne 1976 : François Gautier,
président de Peugeot, est contacté par John Day, président de Chrysler France. Pendant deux décennies, le nom de Talbot avait quasiment disparu. Il réapparaissait aux yeux du grand public le 10 juillet 1979 pour désigner la nouvelle raison sociale de Simca Chrysler France, de Chrysler en Angleterre (ex Rootes) et de Chrysler Barreiros en Espagne. Auto Hebdo N° 176 du 9 août 1979 : " ... Talbot c'était pour la (petite) série, le luxe, le prestige, la puissance, le rêve. Qui s'en souvient ? Les acheteurs potentiels des défuntes Simca ? Nous, on veut bien et de toutes façons les sondages, enquêtes, études en tout genre ont du être effectués pour rassurer ceux qui ont finalement opté pour ce changement de dénomination ... " Mais revenons au contexte de la fin des années 70. Chrysler subissait de plein fouet les conséquences d'un ralentissement du marché automobile aux Etats Unis. Ses filiales européennes n'étaient pas en meilleure forme : Chrysler UK, né de la reprise du groupe Rootes en 1967 (Sunbeam, Humber et Hillman) n'était pas mieux loti que la British Leyland dans la lente agonie que traversait l'industrie automobile outre Manche. Sa part de marché était tombée en 1975 à 4 %, contre 12 % dix ans plus tôt. Chrysler Espagne survivait. Simca devenu Chrysler France semblait au bout du rouleau avec une gamme vieillissante. La marque ne représentait plus en France que 11 % des immatriculations en 1978. Cela représentait tout de même 206094 voitures. Plus jamais le constructeur n'allait atteindre ce score dans notre pays. En face, Renault caracolait à 35 % de part de marché et PSA à 34 %. Chrysler avait peu investi depuis le rachat de Simca qui s'était déroulé par étapes successives entre 1958 et 1968. La 1000 était complètement dépassée en face de la pimpante Renault 5, la 1100 avait déjà plus de dix ans, et les Chrysler 160/180/2 litres n'avaient jamais vraiment percé avec leurs lignes ingrates et peu adaptées au marché français. Seules les Simca 1307/1308 et Simca Horizon élues " voiture de l'année " respectivement en 1976 et 1979 parvenaient encore à faire bonne figure. Enfin, l'absence de moteur diesel dans la gamme se faisait cruellement ressentir.
Simca 1307/1308. Copyright Le troisième constructeur américain n'avait plus qu'une solution pour s'en sortir : vendre ses installations en Europe, afin de reconstituer une trésorerie. Les premiers contacts entre PSA et Chrysler datent de l'automne 1976. Les négociations furent complexes. C'est finalement PSA qui rachetait toutes les filiales européennes de Chrysler le 10 août 1978, deux ans après avoir avalé Citroën. Le morceau était consistant. Chrysler Europe, c'était alors 75 000 personnes, réparties dans 17 usines. Le financement de l'opération passait par l'émission d'actions PSA remises à Chrysler, qui entrait ainsi dans le capital du constructeur français à hauteur de 15,5 %. La stabilité du capital n'était pas entamée. Les installations britanniques et espagnoles étaient payées cash. Les marchés financiers saluaient cette opération. La valeur de l'action PSA avait plus que doublé entre le printemps 1977 et le mois d'août 1978. Une nouvelle équipe pilotée par François Perrin Pelletier prenait en main les destinées de Chrysler Europe. Elle avait pour mission de rééquilibrer les comptes des unités Chrysler, en commençant par rationaliser l'outil industriel. Elle devait par ailleurs sous un an rebaptiser le nouvel ensemble, car le nom de Chrysler appartenait de manière exclusive au groupe américain. Jean Peronnin, entré chez Simca en 1958, était nommé directeur général de Chrysler France, tandis que Dominique Savey, ancien directeur des plans et produits de PSA, prenait en charge la politique commerciale. Georges Héreil, ancien président de Simca, siégeait au conseil de surveillance. Au yeux des nouveaux dirigeants, il apparaissait que le label Simca sonnait trop français, et qu'il était mal perçu ou inconnu au niveau européen, en particulier chez notre voisin britannique. De plus, il était trop lié dans l'esprit du public à Chrysler. Des noms comme Delage, Delahaye ou Sunbeam furent envisagés. Finalement, c'est celui de Talbot qui fut retenu, une large majorité des personnes interrogées estimant en France que cette marque était typiquement française, et en Grande Bretagne qu'elle était typiquement britannique, ce qui était au demeurant assez vrai dans les deux cas. La marque Talbot faisait partie de patrimoine Simca depuis 1958, et du patrimoine Rootes depuis le rachat de STD en 1934. Elle se présentait comme un nom européen facile à prononcer dans toutes les langues et chargé de gloire sportive et d'une image de qualité. PSA souhaitait donner un nom suffisamment fort à cette nouvelle marque, dont la vocation était de posséder sa propre gamme et son propre réseau de distribution. Le nom de Talbot devait aux yeux du repreneur peser autant que celui de Peugeot ou de Citroën. C'est à l'agence de communication Young et Rubicam que fut confiée la communication autour de cette " nouvelle " marque. Objectivement, la notoriété de Talbot demeurait limitée aux amateurs éclairés - et d'un certain âge - ayant gardé la nostalgie des voitures françaises de grand tourisme. Les jeunes générations ignoraient tout du passé de Talbot, et ce nom leur était le plus souvent totalement inconnu. L'enjeu était pourtant de taille, puisque la nouvelle marque devait être lancée simultanément dans onze pays européens. En 1979, Simca Chrysler, en passe de devenir Talbot Simca, vendait encore 171993 voitures en France, soit 9 % de part de marché (2 % de moins que l'année précédente). Rien ne semblait pouvoir ralentir cette lente mais régulière érosion. L'usine de Poissy, lieu de production unique des Simca, perdait de l'argent. Le lancement officiel de la nouvelle marque Talbot intervenait le 10 juillet 1979, au début des vacances d'été. L'intérêt de cette date était double. D'une part, le public en congés pouvait être plus attentif aux campagnes de communication presse, télévision et radio. D'autre part, les tarifs sur ces médias sont traditionnellement plus économiques durant cette période. Le 27 décembre, Chrysler France devenait Automobiles Talbot, Chrysler UK devenait Talbot Motor Company Ltd, et Chrysler Espana devenait Automoviles Talbot SA. Ces deux dernières entités passaient sous le contrôle d'Automobiles Talbot.
Publicités parue dans la presse en 1980 pour expliquer la nouvelle appellation Talbot. Copyright Ce changement de nom fut onéreux pour les finances de PSA : environ 120 millions de francs. Il s'agissait de créer et de faire connaître une nouvelle division automobile au sein du groupe. Chez Talbot, on s'employait à remplacer le papier à lettre, les enveloppes, les prospectus, les manuels, les tarifs, etc ... anciennement marqués Simca Chrysler. Le nouveau panneau Talbot remplaçait l'enseigne Simca au fronton des 7000 concessionnaires et agents de la marque.
Adieux Chrysler Simca, bonjour Talbot ! Copyright Pour le millésime 1980, les Chrysler Simca devenaient donc des Talbot Simca et les Chrysler Sunbeam des Talbot Sunbeam. Certains historiens de l'automobile crièrent au scandale. Comment pouvait on ainsi galvauder une marque aussi prestigieuse, en apposant ce blason sur une Simca 1100 née à Poissy en 1967, ou sur l'insignifiante Sunbeam LS britannique. Accessoirement, il restait à donner un nouveau statut à Matra. En novembre 1979, Matra, Talbot et Peugeot ratifiaient un nouvel accord de coopération qui permettait la création d'une nouvelle société, Matra automobiles, détenue à 55% par Matra, 35% par Talbot et 10% par Peugeot. Les deux modèles fabriqués par Matra, la Bagheera et la Rancho, prenaient alors le nom de Talbot Matra. Désormais, la stratégie ambitieuse de PSA était la suivante concernant l'orientation que devait prendre les trois marques du groupe : à Peugeot les voitures sérieuses et classiques, à Citroën les propositions innovantes, et à Talbot le dynamisme, la jeunesse, l'actualité, l'adaptation permanente et rapide aux goûts de la clientèle. Cette image s'appuyait sur les titres de " voiture de l'année " récemment obtenus avec l'Horizon est les 1307/1308, et sur la coopération avec Matra. Chacune des trois marques visait des segments de marché différents. Le développement s'appuyait sur le maintien de trois réseaux de distribution indépendants, et de taille équivalente à l'échelle européenne, de nature à maintenir à chaque constructeur son identité et ses volumes. Le mensuel " L'automobile " évoquait un lourd héritage dans son numéro 398 d'août 1979. Extraits: " On ne savait plus très bien comment les nommer ces 1307/1308 et autre Horizon. S'agissait-il encore de Chrysler, de Simca, se devait-on par précaution de spécifier chaque fois que ces modèles appartenaient au groupe PSA, bref tout cela n'était pas très clair et ne pouvait continuer ainsi. C'est pourquoi, depuis le 10 juillet c'est tout Chrysler Europe qui change d'état civil et devient par la magie des regroupements de sociétés automobiles le groupe Talbot. Pourquoi ce nom ? Et bien, vous allez voir comme le hasard fait bien les choses. Tout d'abord il était évident que le groupe PSA devait rétrocéder le nom de Chrysler à ses légitimes propriétaires américains, au plus tard l'an prochain. Et puis de toutes façons, il était impossible de conserver cette appellation qui entretenait l'ambiguïté sur la véritable nationalité de la société et sur son autonomie. Bien entendu, on aurait pu en revenir au nom de Simca honorablement connu mais, ce que veulent les dirigeants du groupe c'est créer une politique nouvelle en matière d'identité afin de " dynamiser le réseau des concessionnaires et agents ". Comme la nouvelle branche du groupe PSA a des structures européennes issues du regroupement de Rootes en Grande Bretagne et Barreiros en Espagne, il lui fallait un nom européen, bien connu, facile à prononcer quelque soient les langues, synonyme de qualité, etc ... Outre Simca, la société PSA avait à sa disposition les noms de Darracq, Delahaye et Talbot qui tous avaient été rachetés par Simca. Mais c'est Talbot qui a fait l'unanimité pour la bonne raison que cette marque avait déjà vocation européenne il y a 50 ans puisqu'elle était utilisée par deux sociétés soeurs Clement Talbot LTD en Grande Bretagne et Automobiles Talbot SA en France. De plus, la marque Talbot était conjointement détenue par Chrysler UK et Chrysler France, depuis 1935 par la Rootes, depuis 1958 par Simca. Bien entendu ces deux raisons n'étaient pas suffisantes, l'argument qui permet " d'enlever le morceau " c'est que dans l'esprit du grand public, Talbot demeure comme un marque d'exception qui construisait des voitures de grand tourisme rapides et racées et qui notamment remportèrent les 24 Heures du Mans 1950 aux mains des Rosier père et fils ... Voilà, maintenant, si ce nouveau nom valorise dans un premier temps les voitures de la marque, il faut impérativement que celles ci ne viennent pas ensuite le dévaloriser. " La nouvelle marque tente de s'installer La gamme française était relativement étendue. En bas de gamme, la 1100 vivait ses derniers mois, les antédiluviennes 1610 et 2 litres faisaient de la figuration, les Horizon et 1510 (ancienne 1307/1308 restylées en juillet 1979) assuraient l'essentiel de volumes, et les Matra Bagheera et Rancho apportaient un touche de modernité. Côté britannique, Chrysler avait laissé en héritage une Avenger d'un autre âge et une plus moderne Sunbeam, qui remplaçait des deux côtés de la Manche l'ancienne 1000 disparue en 1978. La 1510 fut la première voiture Talbot à recevoir une calandre avec un " T " cerclé. En janvier 1980, pour rassurer la clientèle sur la qualité des automobiles proposées, et grâce aux investissements réalisés à Poissy, Talbot garantissait ses voitures contre la corrosion pour une durée de six ans, une première en France. En 1980, Talbot Simca vendait 120874 voitures dans l'hexagone, soit une chute de 30 % par rapport à l'année précédente, et de 42 % par rapport à 1978. La presse et la télévision qui rendaient compte des troubles sociaux naissants au sein de l'usine de Poissy contribuaient à ternir l'image nouvelle de Talbot. En France comme en Grande Bretagne, l'adoption du nom Talbot sur d'anciennes et très populaires Simca, Hillman et Sunbeam paraissait bien incongru. La clientèle semblait déroutée par ce grand chambardement. Cette profusion de sigles, même après la grande opération promotionnelle pour la marque Talbot, contribuait un peu plus au désarroi du public, plus rassuré - en France - par une vraie Peugeot de Sochaux ou - en Angleterre - par une banale Morris Marina.
Difficile de justifier auprès du public britannique l'appellation Talbot sur ce break Chrysler Avenger ... Copyright En juillet 1980, Simca était définitivement mort. L'ancien monogramme de la Simca (Société Industrielle de Mécanique et Carrosserie Automobile) laissait sa place au T cerclé de Talbot sur toutes les voitures. 1980 aurait pu être une année faste pour Talbot, qui présentait en mars la Solara, une 1510 à quatre portes. Mais plutôt que d'étoffer la gamme, la Solara eut tendance à cannibaliser les ventes de la 1510.
Couverture du mensuel L'Automobile de septembre 1979 annonçant la nouvelle Talbot. Copyright Le puzzle hérité de Chrysler s'avérait complexe à gérer. PSA venait de prendre en main un groupe mal structuré, aux coûts de production trop importants. Pour une même opération, quand il fallait un homme chez Simca ou Peugeot, et 0,9 chez Citroën, il en fallait 1,22 chez Chrysler en Espagne et 1,34 en Grande Bretagne. Ainsi, il était moins coûteux pour PSA d'exporter ses Talbot de France (même avec le coût de transport), que de les produire en Angleterre. En septembre 1980, la morosité ambiante sur le marché automobile décidait Peugeot et Talbot à entamer un processus de fusion des deux sociétés. Celui ci aboutissait le 20 décembre 1980 à l'absorption de Talbot par Peugeot, avec effet rétroactif le 1er janvier 1980. Contrairement à Citroën qui avait gardé une certaine autonomie, Talbot passait sous l'autorité directe de Peugeot, tant en France qu'en Grande Bretagne et en Espagne. Afin de mieux protéger PSA en cas de défaillance, l'usine de Poissy était intégrée dans une nouvelle société, la SNC Talbot et Cie, seule responsable de ses profits ou de ses pertes, dont la vocation était de fournir à Peugeot les voitures qu'elle produisait. Pour le millésime 1981, Matra remplaçait la Bagheera par la Murena. Celle ci ne connut qu'un succès d'estime avec 10680 voitures fabriquées en quatre ans. Ce type de coupé sportif à la mode durant la décennie précédente perdait alors du terrain au profit des sportives type VW Golf GTI. Et quand bien même, le petit 4 cylindres 1,6 litre de 68 ch, ou le 2,2 litres de 84 ch n'effrayaient pas la concurrence allemande ou italienne mieux armée.
Page de couverture du catalogue publicitaire Talbot Matra Murena pour 1983. Copyright Le bide de la Tagora La Tagora faisait son apparition en octobre 1980 au Salon de Paris. Son étude avait débuté chez Chrysler en 1976 (80 % du programme avait été financé par les américains), mais c'est le groupe PSA qui finalisait sa mise au point, après l'avoir trouvé dans la corbeille du mariage. La presse et le public s'interrogèrent sur l'intérêt de la présence de cette voiture, ni vraiment laide, ni vraiment belle, mais qui manquait de légitimité face à la Renault 30 et autres Peugeot 505 et 604 installées depuis déjà quelques années. La Tagora ressemblait à une grosse Solara. Il aurait été aussi dommageable d'abandonner de tels investissements, même si l'on savait que la Tagora n'était sans doute pas le bon produit à ce moment là. Talbot la commercialisait dans un premier temps dans la version la moins intéressante, la 2,2 litres essence. Ce n'est que pour le millésime 1982 que furent disponibles les Turbo D et V6. Cette dernière dénommée SX disposait de 165 ch Din (contre 136 ch Din pour la 604) et frôlait les 200 km/h.
Talbot Tagora. Copyright L'hebdomadaire Auto Hebdo (numéro 235 du 2 octobre 1980) qui parlait de la BM française s'étonnait que le premier véritable produit Talbot, destiné à étoffer une gamme squelettique, soit une quatre portes de haut de gamme. Le journaliste Gilles Dupré faisait remarquer que la berline française la plus puissante ne pouvait proposer qu'environ 170 ch avec son V6 PRV par ailleurs réputé pour sa consommation démesurée. Cela en disait long sur la pauvreté de notre production. Il ne fallait pas s'attendre à des chiffres de ventes démesurés, mais, pour l'image de marque, l'opération ne pouvait être que bénéfique, du moins le souhaitait t'il. Le niveau des ventes allait donner raison aux prévisionnistes. Les effets du second choc pétrolier de 1979 rendaient difficiles la commercialisation des voitures gourmandes en carburant. Les concessionnaires Peugeot Talbot n'aimaient pas la Tagora, et préféraient se battre pour la 604, une marque que la plupart d'entre eux défendaient de longue date. Par ailleurs, la Tagora, bien que généreuse dans ses prestations, ne pouvait se prévaloir d'aucun pedigree sérieux malgré son appellation Talbot. Son image était floue : Chrysler, Simca, Talbot ? Sur les 20133 voitures construites de 1980 à 1983 (dont 15687 en 1981), seulement 1083 furent équipées du V6. La commercialisation de la Tagora fut suspendue en France en juillet 1983, mais sa production continua quelques mois encore pour alimenter le marché britannique, un peu plus demandeur. Les dernières voitures furent écoulées discrètement en Espagne. La Tagora venait d'inscrire son nom au palmarès des plus grands bides commerciaux automobiles de tous les temps. Talbot Ligier en F1 Pour conquérir les marchés européens, PSA décidait de donner à Talbot une image sportive. Talbot, une marque au glorieux passé en compétition, se devait d'être présente en Formule 1 et en rallye, les deux disciplines les plus populaires et les plus suivies par les médias du monde entier. En janvier 1980, Talbot annonçait son engagement au championnat du monde. Des contacts furent établis avec BMW qui mettait au point un moteur 1500 turbo. Mais un différent survint concernant l'exclusivité de l'utilisation de cette mécanique. L'accord fut dénoncé. BMW se tournait alors vers Brabham. Extrait de l'éditorial d'Auto Hebdo du 17 janvier 1980 : " C'est le 8 janvier qu'a été rendue officielle la décision de Talbot ... de se lancer dans la formule 1, et ce dès 1981. ... Après donc une gigantesque campagne de publicité destinée à imposer le nom de Talbot : la légende Talbot, l'esprit Talbot, le plaisir de conduire, etc., un grand constructeur, un de plus, utilise comme vecteur porteur pour son image de marque la compétition au plus haut niveau actuel, c'est à dire la F1 ... On attendait Matra, voilà que c'est BMW qui se profile, Talbot n'ayant pas caché qu'il utiliserait un moteur turbo compressé ... Matra paraissait pourtant toute désignée pour développer, au moins, le moteur ... Talbot s'est donné entre deux et quatre saisons pour réussir dans une tâche, certes ardue mais ô combien bénéfique en cas de réussite. Les budgets seront à la hauteur des espérances mais tout reste à faire, le service " Talbot Sport " n'étant né pour l'instant que dans les esprits ... L'histoire de Talbot comporte ses heures de gloire et de désillusion mais n'oublions pas qu'avant d'avoir terminé sa carrière avec un V8 Ford Poissy, le coupé Lago utilisa, en 1957, déjà un V8 BMW 2,6 L, groupe qui équipait alors le magnifique coupé 507 de la marque allemande. Le pari est lancé, reste à le gagner car, à ce " top niveau ", l'essentiel n'est plus de participer ... " Extrait de l'éditorial d'Auto Hebdo du 1er mai 1980 : " Talbot annonce que les négociations engagées depuis le début de cette année avec BMW pour le développement d'un moteur turbo destiné à la F1 Talbot ne seront pas poursuivies. Cette décision a été prise après avoir eu connaissance de l'intention de BMW de ne plus accorder l'exclusivité à Talbot ... Quand à ce que le pilote de la future ... Talbot trouvera derrière son siège l'an prochain, ou dans deux ans, on l'ignore encore ! " Le 23 juin 1980, un nouveau communiqué précisait que Talbot prenait une participation dans la société Ligier et que, pour la saison 1981, une nouvelle monoplace Talbot Ligier, propulsée par un moteur Matra V12, défendrait les couleurs françaises en F1 (avec Renault). Une nouvelle entité Talbot Ligier SA voyait le jour. Elle était détenue à 50 % par Peugeot, 49 % par Guy Ligier, et 1 % par Matra. La nouvelle Formule 1 Talbot JS17 prenait la dénomination exacte de Talbot Ligier JS17. Jacques Lafitte remportait le Grand Prix d'Autriche, du Canada, et terminait la saison à la quatrième place du championnat. L'équipe prenait la même place, au pied du podium.
Talbot Ligier JS17. Copyright En 1982, les Talbot Ligier JS 17 puis JS 19 utilisaient toujours le V12 Matra. Jacques Lafitte et Eddie Cheever pilotaient les deux monoplaces. Le bilan de la saison fut décevant, avec pour meilleur résultat une deuxième place au Grand Prix des USA pour Cheever. Ce manque de réussite fut à l'origine de la disparition de l'écurie Talbot Ligier. Talbot Sunbeam en rallye En rallye, le choix de Talbot s'était porté sur la Talbot Sunbeam Lotus, une voiture anglaise pilotée par des équipages français. Talbot remportait le titre de Champion du Monde des Rallyes en 1981 avec le binôme Guy Frequelin / Jean Todt. Paradoxalement, Talbot annonçait à la même époque l'arrêt de la production de ce modèle en Ecosse.
Publicité presse diffusée dans Auto Hebdo 299 du 7 janvier 1982. Copyright La fusion des réseaux Peugeot Talbot Tout ces efforts n'empêchaient pas la descente aux enfers de se poursuivre avec seulement près de 90000 ventes pour le millésime 1981, soit encore un recul de plus de 25 % par rapport à 1980. Pour l'heure, Talbot, ce n'était plus que 6 % du marché français. Même l'Horizon sur laquelle avait longtemps reposé de nombreux espoirs piétinait. Le rival le plus sérieux, Renault, écrasait Talbot avec 40 % de part de marché, et la seule Renault 5 représentait 16 % des ventes de voitures en France, presque trois fois les ventes de toutes les Talbot réunies. Une restructuration semblait inévitable. Début 1980, des négociations étaient engagées avec les concessionnaires Peugeot et Talbot pour préparer l'unification et la concentration du réseau. Certains arboraient désormais les deux marques. Les Talbot étaient vendues dans les mêmes show room que les Peugeot, et s'y retrouvaient un peu parachutées. Les anciens garages Peugeot continuaient de favoriser les ventes de leur marque, dont ils connaissaient mieux les produits, plutôt que des Talbot. A la fin de 1981, les concessions arboraient désormais de nouveaux panonceaux Peugeot Talbot. Le pire fut qu'un nombre important de concessionnaires, ex Simca, ex Chrysler, décidèrent de sortir du réseau. Les partants signaient avec des marques étrangères : Volkswagen, Ford, Fiat ... et entraînaient avec eux une partie de leur clientèle. De 1981 à 1983, 488 concessions fermaient ou passaient à la concurrence. Cette situation, en dehors d'accroître le niveau des importations, avec désormais près d'1/3 du marché français, portait atteinte à l'image et aux vente de Talbot.
Automobiles Peugeot, un constructeur sort ses griffes. Copyright Les conflits sociaux tuent l'image de marque La baisse d'activité à Poissy incita PSA à avoir recours aux jours chômés. Peu nombreux en 1979, ils étaient de 31 en 1980 et de 59 en 1981. Dans plusieurs ateliers, des équipes étaient supprimées. Début 1980, la direction engageait un plan de départs volontaires pour quelques centaines de cadres, techniciens et agents de maîtrise parmi les plus âgés. Les effectifs ouvriers ne subissaient que l'érosion des mouvements naturels, départs volontaires et mise en retraite. Mais le plus dur restait à venir. En novembre 1980, la direction de Poissy obtenait l'autorisation de licencier 1414 salariés pour raisons économiques. Une seconde vague concernait 1705 salariés fin janvier 1981. En quelques mois, l'usine Talbot de Poissy avait perdu près de 25 % de ses effectifs. En 1981, les ventes totales de PSA diminuaient encore, et parmi elles, celles de Talbot s'effondraient. En parallèle, les marques étrangères poursuivaient leur progression. Les salariés se plaignaient de la charge de travail sous l'effet de la réduction du personnel et de la reprise des chronométrages, des bas salaires, et manifestaient leur colère après les vagues de licenciements massifs. Les variations d'activité entraînaient chaque mois des changements des programmes de fabrication. De nombreux ouvriers passaient d'un type d'horaire à un autre, ou d'un atelier à un autre. Ces mouvements incessants étaient de plus en plus mal supportés par les hommes. Le 2 juin 1982, des conflits éclataient dans l'usine Talbot de Poissy. Des heurts violents eurent lieu les jours suivants entre grévistes (principalement des ouvriers) et non grévistes (agents de maîtrise, cadres), à l'origine de plusieurs blessés. L'usine devenait le théâtre de meetings et de défilés que les syndicats organisaient pour entretenir la mobilisation des troupes. Après un mois de conflit, et des concessions de la direction, les ouvriers reprenaient le travail le 3 juillet. Mais l'ambiance demeurait tendue dans les ateliers, et les accrochages demeurèrent nombreux pendant plusieurs mois, avec des arrêts de chaîne ou des ralentissements de la production. Le nom de Talbot était présent à la une de tous les médias. Il était désormais associé aux images d'affrontements et de blessés. En dehors du coup dur porté à l'image, l'usine était dans l'impossibilité de livrer les voitures déjà commandées. Les concurrents de Talbot n'étaient pas mieux logés. Quelque mois après l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, Renault à Flins et Citroën à Aulnay connaissaient le même type de grèves. Mais ces usines et leurs constructeurs avaient les reins plus solides. En Angleterre, c'était pire. L'usine écossaise de Linwood qui produisait les Avenger et Sunbeam fermait purement et simplement ses portes en mai 1981, entraînant la mise au chômage de près de 5000 salariés. Une nouvelle vague de licenciements - 2905 personnes touchées - était annoncée à Poissy en juillet 1983, avec pour conséquence de nouvelles grèves et de violentes manifestations qui ne faisaient au final que condamner un peu plus le nom de Talbot aux yeux du public. Un bras de fer s'engageait entre syndicats, PSA, et le gouvernement. Les forces de l'ordre intervenaient pour libérer l'usine occupée début janvier 1984. Pour les concessionnaires, vendre une Talbot relevait désormais de la mission impossible, même à des clients ayant déjà versé un acompte. La Samba pour s'en sortir PSA, bien conscient des dommages que créaient l'absence d'une petite citadine depuis la disparition de la Simca 1000 planifiait rapidement l'étude d'un modèle de cette catégorie. C'est à l'automne 1981 que la Samba voyait le jour. Après la LN de Citroën commercialisée en 1976, PSA puisait de nouveau chez Peugeot les éléments nécessaires à la production de la " nouvelle " Samba. Celle ci ne trompait personne avec son look de coupé 104 allongé et légèrement remis au goût du jour. Il y avait de quoi demeurer perplexe en se demandant si ce bricolage était ce qu'il fallait pour Talbot ... Cette automobile au nom de fête pouvait elle sauver Talbot au bord du gouffre ? Si les avantages industriels étaient évidents, le public allait il être séduit par cette voiture âgée de dix ans ? La Samba présentait néanmoins quelques atouts : elle était économique à l'usage, en affichant une consommation théorique de seulement 4,6 litres au 100 km, et elle bénéficiait d'un espace intérieur intéressant. La Samba Cabriolet habillée et renforcée chez Pininfarina intéressait une clientèle avide d'originalité à prix modéré. Son relatif succès, avec 13 062 exemplaires produits de 1982 à 1986, s'opposait à l'échec commercial rencontré par la Citroën Visa Cabriolet assemblée chez Heuliez, à seulement 2633 unités entre 1983 et 1985.
Talbot Samba Cabriolet. Copyright Pour les nostalgiques de la Simca 1000 du même nom, Talbot osait en 1983 une Samba Rallye " à traction avant ". Il n'était évidemment pas question de déplacer le moteur à l'arrière, mais Talbot affichait la volonté d'offrir un peu de puissance, 90 ch Din, et de sensations pour un prix réduit. Les différentes versions de la Samba permettaient à Talbot de bénéficier d'un léger (et dernier) sursaut de ses ventes dans l'Hexagone avec 111 610 unités pour 1982. Après les premiers mois prometteurs - la Samba représentait à ses débuts la moitié des ventes de la marque - et malgré le développement d'un gamme avec le Cabriolet, la Rallye, et les séries spéciales Sympa (1983/86) et Bahia (1984/86), la Samba sombrait elle aussi dans les abîmes du classement des ventes jusqu'à son retrait en 1986, année de l'abandon de la marque Talbot. Réduction draconienne de la voilure Sur le plan de l'offre produit, une Horizon diesel était enfin disponible en juillet 1982. Ce modèle arrivait bien tard. Mais le coup qui fit le plus mal à Talbot fut porté par la présentation de la nouvelle et séduisante Peugeot 205 en février 1983. Face à elle, les Samba et Horizon pouvaient aller se rhabiller. En 1983, Talbot vendait 89785 voitures. PSA qui de son côté commençait tout juste à profiter du succès de la 205 se lassait de devoir gérer une situation de conflit social latent, et de soutenir financièrement une marque dont l'avenir semblait de plus en plus incertain. En 1982, PSA avec Talbot, Peugeot et Citroën ne représentait plus que 30,3 % du marché français, contre 42,6 % en 1979. Au niveau européen, la part était passée en trois ans de 17,2 % à 12 %. Des choix stratégiques majeurs s'imposaient sans tarder. L'arrivée de Jacques Calvet à la tête du conseil de surveillance d'Automobiles Peugeot en novembre 1982 coïncidait avec la prise de mesures radicales, qui concernaient surtout Talbot. Le grand ménage débutait avec l'arrêt de la commercialisation de la 1510 en juillet 1982, puis l'année suivante de l'éphémère Tagora. Talbot qui avait misé sur des modèles de gamme moyenne ou inférieure, sur un marché encombré, fortement concurrentielle, avec des marges réduites, était incapable de lutter à arme égale avec ses concurrents. Le constructeur manquait de notoriété, ne disposait dans sa gamme d'aucun modèle vraiment nouveau ou attractif. Trois marques, Talbot, Peugeot et Citroën, c'était au moins une de trop. Le programme F1 était arrêté, de même que la collaboration avec Matra. PSA bloquait aussi les études des déclinaisons de l'Horizon (trois portes, utilitaire, version sportive). Enfin, une meilleure rationalisation des moyens industriels passait par la production de certains modèles Peugeot à Poissy, en particulier la 205. Les derniers mois En 1984, Talbot ne vendait que 40 895 voitures en France, soit près de cinq fois moins qu'en 1978. Avec 2,5 % de part de marché, l'agonie de la marque - un triste renouvellement de l'histoire pour ce blason - paraissait interminable. PSA poursuivait l'étude de celle qui devait remplacer l'Horizon. Mais le groupe se trouvait face à un dilemme. La nouvelle venue pouvait elle encore s'appeler Talbot, un nom synonyme de conflit social à répétition, ou devait on envisager d'abandonner complètement cette dénomination ? Après plusieurs mois d'hésitations, la sanction tombait. Celle qui fut étudiée pour devenir la future Talbot allait être vendue sous la marque Peugeot. (paragraphe suivant). Le second arrêt de mort de la marque Talbot venait d'être signé. Plus aucun nouveau modèle portant ce nom historique n'était à l'étude. Sur 1985, Talbot totalisait 21 125 ventes, soit moins de 80 voitures par jour ouvrable sur la France, moins d'une voiture par département et par jour, ce qui équivalait à 10 % des performances de 1978. En juillet 1985, l'Horizon disparaissait du catalogue. Elle était remplacée à Poissy et à Ryton par la 309. Seules la Solara fabriquée en Espagne et la Samba étaient maintenues au catalogue français. Les dernières Samba sortaient de l'usine de Poissy au printemps 1986. 4600 voitures étaient immatriculées en France cette dernière année. Le rideau tombait. L'Espagne conservait jusqu'à la fin de 1987 la production de l'Horizon. La marque Talbot avait mieux résisté sur le marché Espagnol, peu concerné par les troubles sociaux de Poissy. Désormais, PSA se concentrait uniquement sur ses deux marques, Peugeot et Citroën. La Talbot Arizona, devenue Peugeot 309 En 1984, la production de la Solara était tombée à 7000 unités, celle de l'Horizon à 22000. Pour la première fois, il fut produit à Poissy plus de Peugeot que de Talbot, 81000 contre 79000. L'usine de Poissy, en dehors des Talbot, ne servait que de site d'appoint pour les productions de Peugeot : 104 en fin de carrière, et 205 en phase de démarrage. A ce titre, son avenir demeurait fragile. Le projet C28 avait donc une importance capitale, car cette nouvelle voiture étudiée pour Poissy était la seule capable d'apporter au site un regain de production durable. Voiture de milieu de gamme, elle visait le segment qui assurait 30 % des immatriculations en Europe. Elle possédait déjà un nom de baptême pour le grand jour : Talbot Arizona. La direction de Peugeot, pour prouver sa confiance en l'avenir de la marque Talbot, avait confirmé ce choix. La clientèle doutait de la capacité de Talbot à fabriquer une voiture sans souci. Désigner le projet C28 comme une Talbot, c'était en effet donner une dernière chance à la marque. La dénommer Peugeot revenait à tuer une seconde fois Talbot, mais procurait à la voiture plus de chance de connaître une carrière honorable. Depuis les promesses, la dégradation de l'image de Talbot sur le plan commercial était devenue irrémédiable. Au final, il y eu peu de protestations, tant au niveau du personnel que des syndicats, bien conscients que des emplois sauvegardés avaient plus de valeur que la pérennité d'une marque. A un mois du lancement, PSA annonçait la naissance de la 309. Ce numéro qui ne s'inscrivait alors dans aucune suite numérique logique montrait à quel point cette auto arrivait en concession comme un cheveux sur la soupe. La 309 était présentée en octobre 1985. PSA pensa un temps la commercialiser sous la marque Talbot en Grande Bretagne et en Espagne. Mais le succès de la 205 incita le constructeur à la distribuer partout en Europe sous la marque du Lion.
Peugeot 309. Copyright En 1988, PSA retirait le panneau bleu Talbot du fronton de l'usine. Le portrait en bronze d'Henri Théodore Pigozzi était également enlevé. En Grande Bretagne, le nom de Talbot faisait de la résistance jusqu'au milieu des années 90, en désignant un utilitaire qui n'était en fait qu'un Peugeot J5 rebadgé. |