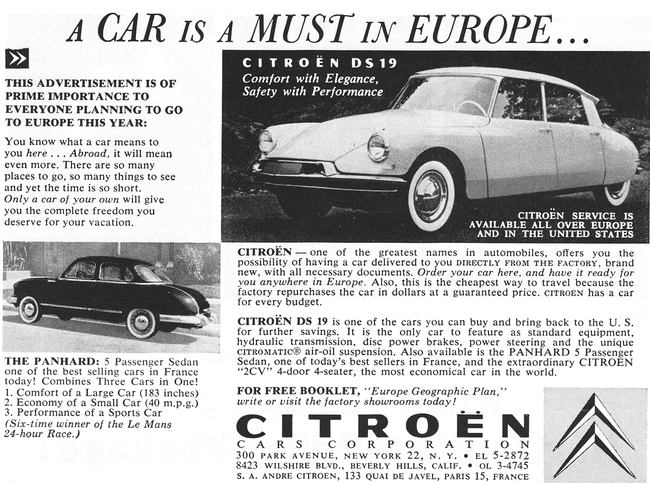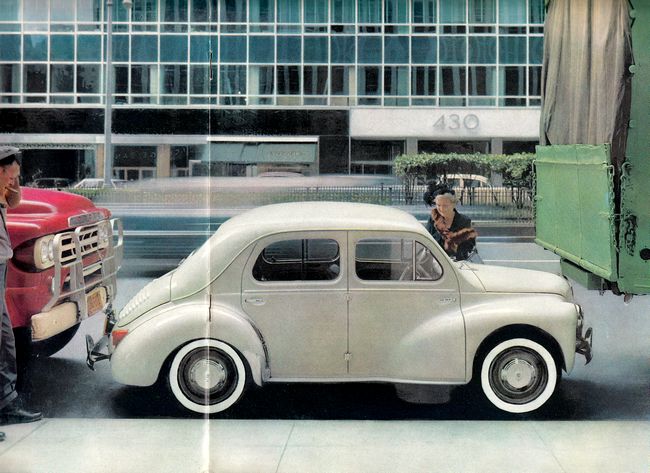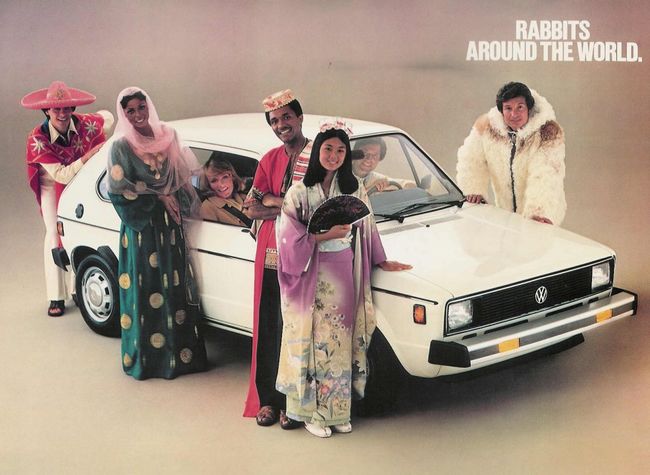|
Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. L'histoire des automobiles françaises aux Etats-Unis France / USA
L'immédiat après guerre Citroën
Préambule Peugeot
Préambule Renault
Les années 50' Simca
Simca 5,
Simca 6, Simca 8 Conclusion France / USA L'immédiat après guerre Après la seconde guerre, chez les différents constructeurs français, on considérait l'hexagone comme étant " le " marché de base. Dans un pays en reconstruction, la demande était plus forte que l'offre, et peinait à être satisfaite. Dans ce contexte, l'exportation ne constituait pas une priorité. Elle n'était pas pour autant totalement négligée. Les Etats-Unis représentaient un débouché potentiel important. Renault par le biais de sa filiale " Renault of France " s'y installa au début des années 50. La " Citroën Cars Corporation " voyait le jour en 1952. Jusqu'à ces dates, la diffusion aux USA des voitures françaises avait été l'affaire de distributeurs indépendants, et les véhicules vendus sur place ne bénéficiaient d'aucune garantie constructeur. La revue mensuelle " Motoring Life " paraissant à Dublin établissait un constat amer en 1953 concernant l'attitude des constructeurs français aux Etats-Unis :
Howard Darrin livrait dans l'Auto Journal N° 93 du 1er janvier 1954 ses observations concernant notamment le style des voitures françaises commercialisées aux Etats-Unis :
Exporter devient une priorité nationale Dès le milieu des années 50, le niveau de production des voitures françaises et la demande intérieure étaient revenus à l'équilibre. Un tassement des ventes se faisait sentir dans l'hexagone. Les constructeurs furent contraints d'adopter une politique commerciale plus agressive, tant dans notre pays qu'à l'étranger, afin de stabiliser leurs volumes. Envisager des débouchés en dehors de la France n'était plus une option, mais une obligation. La crise de Suez durant l'automne 1956 freina encore un peu plus un marché atone. Pierre Dreyfus, PDG de Renault après la mort accidentelle de Pierre Lefaucheux en mars 1955, ancien directeur de cabinet du Ministre de l'Industrie et du Commerce, était convaincu de cette nécessité d'exporter massivement. Il exposa son projet à son état-major. Selon lui, à court terme, la Régie devait vendre la moitié de ses voitures en dehors de ses frontières. Henri Théodore Pigozzi, PDG de Simca, européen dans l'âme, tantôt un pied à Paris, tantôt proche de Turin, partageait la même vision de l'avenir.
Pierre Dreyfus (1907-1994) vit rapidement l'énorme potentiel du marché américain. Copyright Pigozzi et Dreyfus allaient lancer leur entreprise dans une véritable politique de développement international. Ils étaient résolument décidés à rompre la spirale de l'échec qui voulait que l'on n'exporte pas parce que cela ne rapporte pas suffisamment, et comme cela ne rapporte pas, il ne servait à rien d'exporter. La volonté de ces deux patrons allait prendre une toute autre forme quand les pouvoirs publics demandèrent clairement à partir de 1957 aux industriels français d'accroître leurs exportations. La guerre d'Algérie était coûteuse pour le pays. Le déficit budgétaire était très important. L'apport de devises étrangères devenait une nécessité pour l'équilibre financier du pays. Le deal avec les industriels de l'automobile était simple : soit vous exportez plus, soit l'Etat sera contraint d'accroître la pression fiscale (vignette, TVA, prix de l'essence, carte grise) sur les automobiles vendues en France. Cette seconde solution si elle était adoptée serait catastrophique, car elle asphyxierait le marché intérieur. Dans les faits, il s'agissait d'un chantage, mais celui-ci allait fonctionner. A la Régie, on était satisfait d'aligner sa propre stratégie sur les intérêts des pouvoirs publics. Seule contrainte, le ministère chargea Pierre Dreyfus d'en convaincre ses confrères. Simca n'opposa aucune réticence. Par contre, chez Citroën et chez Peugeot, on était mis devant le fait accompli. Finalement, Peugeot se déclara disposé à relever ce défi, bien que du côté de Sochaux, on doutât de la rentabilité de l'opération. Chez Citroën, on était choqué à l'idée d'une intrusion de l'état dans la politique commerciale et industrielle de la maison. Mais les choses devaient avancer. En mars 1957, cinq constructeurs (Panhard était aussi de la partie), concurrents depuis toujours, mais rassemblés par leur devoir national, signèrent un accord en présence de Paul Ramadier, qui précisait qu'ils s'engageaient à vendre à l'étranger les deux tiers de leur augmentation de production. Dans un contexte d'économie mondiale encore très protégée, Renault et Simca pressentirent rapidement qu'il convenait de concentrer leurs efforts vers les pays à la fois libres d'accès et à fort potentiel. Il n'était en effet pas question de se heurter à des contingentements ou à des taxes à l'importation. L'immense territoire nord-américain répondait à ces critères. Peugeot allait prendre le train en marche vers les Etats-Unis, en partenariat avec Renault.
Image surprenante d'une autre époque, quand Peugeot écoulait ses modèles aux Etats-Unis par l'intermédiaire du réseau commercial Renault. Notez sur cette photo la présence de la principale concurrente des petites françaises aux States, la Volkswagen Coccinelle - Source : AJ N° 278 du 10 août 1961 Volkswagen était l'exemple à suivre. Ce cas d'école fut soigneusement étudié par les Français, mais pas assez hélas comme nous allons le voir plus tard. Volkswagen avait su imposer une image, un produit et un réseau. Il s'agissait pour l'instant d'essayer de faire aussi bien, sinon mieux que lui. Construire un réseau La construction d'un réseau était une priorité. Le plus simple semblait être de faire alliance avec les constructeurs américains, en leur proposant de diffuser à travers leur canal des voitures que de toute façon ils ne savaient pas construire. Renault fut reçu avec une certaine condescendance chez Chrysler, qui par ailleurs n'avait pas attendu l'arrivée de la Régie pour se poser les bonnes questions. En effet, le troisième constructeur américain était déjà en négociation depuis quelque temps avec plusieurs marques européennes : Borgward, le groupe Rootes, et même les Français de chez Simca. Ce dernier venait d'ailleurs d'être éconduit par Ford, pourtant propriétaire de 15 % de son capital depuis le rachat par Simca de l'usine Ford de Poissy en 1954. Ford préférait avec une certaine logique vendre des voitures anglaises fabriquées à Dagenham ou allemandes produites à Cologne. A défaut, Renault se tourna vers des constructeurs de seconde catégorie. American Motors (AMC) et Studebaker furent approchés. Le premier n'était pas intéressé. L'histoire allait en décider autrement quelques années plus tard, mais nous n'en sommes pas encore là. Chez Studebaker, les émissaires de la Régie furent reçus de haut. Il faut préciser qu'en interne, ce choix du constructeur de South Bend ne convainquait pas vraiment. Nombreux étaient ceux qui doutaient des capacités de cette vieille entreprise déjà en situation de faiblesse à assumer un tel partenariat, tandis que d'autres y voyaient très ouvertement la possibilité au cas où elle ferait faillite d'hériter d'un réseau complet de distribution. Un monde vraiment sans pitié ! Cela n'empêcha pas les dirigeants de Studebaker de faire monter les enchères concernant les coûts de distribution. Il n'était pas question pour le petit constructeur de passer pour un looser. Pour Simca et Renault, l'idée d'un partenariat était pour l'instant vouée à l'échec. Les constructeurs français n'avaient pas le temps d'attendre l'éventuelle issue positive des négociations avec les constructeurs nationaux. Il allait falloir se débrouiller seul pour constituer un réseau, et recruter des garagistes indépendants. Imposer ses produits Imposer ses produits n'était pas non plus une mince affaire. A la Régie, on se montrait confiant concernant la Dauphine produite à Flins depuis mars 1956. Aux yeux des Français, elle se montrait infiniment plus séduisante que la Volkswagen.
Le charme parisien de la Dauphine by Renault. Copyright
La Volkswagen se sentait vraiment chez elle aux States. Copyright Simca espérait s'appuyer sur l'image du V8 Ford qui équipait ses hauts de gamme. Mais les dirigeants de Ford à Détroit s'y opposèrent. Le constructeur de Poissy abandonnait rapidement cette idée, qui n'aurait pas forcément été gagnante par ailleurs. En effet, la Vedette était chère à produire, et son prix de vente aurait été trop élevé aux Etats-Unis pour se faire une place. Il fut alors décidé de se replier sur la plus économique Aronde, modèle familial fabriqué depuis 1951. La Vedette (la Versailles était une de ses finitions) ne fut diffusée qu'à dose homéopathique quelques années plus tard.
Extrait de l'AJ N° 166 du 15/01/1957, quelques Versailles furent diffusées aux Etats-Unis. Copyright Disposer d'un réseau et proposer des produits attrayants étaient deux étapes majeures. Se faire connaître du grand public en était une autre. La Régie prenait les devants. Le 5 septembre 1956, elle créait l'évènement en lançant l'Etoile Filante sur le lac salé de Bonneville à 309 km/h. C'est ainsi que l'Amérique découvrit la marque au losange.
L'Etoile Filante de Renault sur la lac salé de Bonneville en 1956. Copyright Pas de demi-mesure A la Régie, on avait décidé de ne pas faire dans la demi-mesure. En 1959, jusqu'à 500 Dauphine étaient expédiées quotidiennement vers les Etats-Unis, soit environ 25 % de la production. Pour assurer ces transports, Renault acheta plusieurs bateaux d'occasion, des " liberty ships " construits aux Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avaient servi à transporter le matériel de guerre allié, voir des troupes de débarquement. La Compagnie d'Affrètement et de Transport (CAT) fut d'ailleurs créée à cette occasion pour financer ces investissements. Le voyage selon la destination finale, la côte Est ou la côte Ouest, durait de dix à trente-cinq jours. Il fallait encore quelques jours pour assurer sur place le montage des pièces spécifiques au marché américain. Les banques furent largement sollicitées pour financer ces stocks " flottants ".
Renault et Simca ne lésinèrent pas sur les moyens. Copyright A une époque où l'exportation des voitures françaises apparaissait comme une entreprise hardie, la direction du port du Havre n'hésita pas à installer de vastes parcs à voitures pour permettre à celles-ci d'attendre les cargos qui devaient les emmener aux Etats-Unis, mais aussi vers de nombreuses autres destinations exotiques : Brésil, Mexique, Argentine, Uruguay ...
L'embarquement ou de débarquement de voitures depuis des navires non conçus pour cet usage demeurait une opération délicate. Copyright L'extension constante du trafic incita une seconde compagnie à effectuer des expéditions de voitures à travers les océans. Il s'agissait de la SCAC, Société Commerciale d'Affrètement et de Commission, qui travaillait essentiellement pour Simca, Peugeot et Citroën (mais par pour Renault). Cette société fut intégrée au Groupe Bolloré en 1986. En 1958, Renault venait en tête des constructeurs qui exportaient via le Havre. La firme de Billancourt expédiait cette années-là 56 700 voitures, contre 23 685 Simca, 7000 Peugeot et 3000 Citroën. L'Amérique du Nord n'était pas la seule destination, mais elle absorbait la majeure partie de ces volumes. Le Salon de New York en décembre 1959 marqua l'apothéose pour Renault aux States. Le constructeur y exposait son cabriolet Floride baptisé Caravelle là-bas, sur un stand aux couleurs bleu blanc rouge. Renault tablait sur le " styled in Paris " et sur l'image de Brigitte Bardot qui assurait en personne la promotion de ce cabriolet.
Brigitte Bardot fut mise à contribution pour promouvoir la Renault Caravelle aux Etats-Unis. Copyright Les raisons du succès Il convient de s'interroger sur les raisons de ce succès inattendu des petites françaises aux Etats-Unis. Les premiers problèmes de croissance perçus à la fin des années 50 incitèrent de nombreux acheteurs à choisir une voiture plus économique. Le charme français opérait. Renault affirmait ainsi qu'une proportion importante des acheteurs de Dauphine était séduite d'une part par sa ligne, d'autre part par son coût d'entretien réduit. Certains clients étaient sensibles à la faible consommation en carburant, même si le prix à la pompe était aux USA nettement moins élevé qu'en France. Mais celui-ci avait augmenté à la fin des années 50. Chez Peugeot au contraire, on avançait que l'économie d'achat et d'utilisation n'avait qu'un faible impact. On achetait surtout français par snobisme, pour montrer aux autres son bon goût. Les voitures françaises présentaient l'avantage d'une faible décote d'une année sur l'autre. En effet, en conservant sur une longue période la même carrosserie, elles se démodaient moins vite que les américaines, qui elles changeaient de robe à chaque millésime, ou presque. La dimension des voitures européennes jouait en leur faveur. Les Américains, surtout ceux qui habitaient en ville, en avaient assez de leurs paquebots sur roues. La conduite dans New York d'une Dauphine n'avait rien de comparable avec celle d'une Chevrolet Impala. Si conduire était une chose, trouver une place de parking dans une rue d'un centre-ville relevait de la mission impossible. Les garagistes américains étaient dans l'ensemble jugés chers et pas toujours très compétents. La moindre réparation atteignait souvent des montants insupportables. Les carrossiers étaient tout aussi coûteux. Les automobilistes traînaient des pieds pour entreprendre de gros travaux. Les petites voitures européennes simples, économiques et fiables leur permettaient le plus souvent d'échapper partiellement à ces inconvénients. Fin de la partie Aux Etats-Unis, jusqu'en 1949, deux marques étrangères seulement se partageaient un marché annuel de 12 000 voitures : Austin et Ford UK. En 1952, 44 marques étaient présentes, et en 1958 on en comptait 60, avec plus de 375 000 voitures importées. On pouvait s'étonner de l'absence de réaction des " big three " (GM, Ford, Chrysler) face à cette invasion des constructeurs européens. Pour l'instant, leur présence demeurait minime. Ces voitures ne captaient en 1958 que 8,1 % du marché. Le PDG de la General Motors avait prévenu Pierre Dreyfus, et lui indiquant qu'il pouvait vendre ce qu'il voulait, mais que le jour où cela commencerait à les inquiéter, les constructeurs américains sauraient y mettre un coup d'arrêt, via une administration fédérale qui avait les moyens de défendre leurs intérêts, et par la pression qu'ils sauraient exercer sur les revendeurs et les syndicats. Les spécialistes du marketing des big three avaient prédit avec force que 1959 serait la dernière année d'importation massive des véhicules étrangers. Leurs propos s'appuyaient sur le succès déjà enregistré par les premières voitures de taille moyenne " made in USA ". Des concurrentes made in USA AMC fut le premier à dégainer avec la Rambler en 1958, suivi par Studebaker et sa Lark en 1959. Les trois grands préparaient leurs nouvelles voitures compactes, et les moyens publicitaires qu'ils allaient mettre en oeuvre allaient laisser peu de visibilité aux Européens.
Rambler American. Copyright
Studebaker Lark. Copyright Extrait de l'AJ numéro 195 du 1er avril 1958 :
Les français dans l'illégalité Un autre combat s'ouvrait sur le front légal. Durant le printemps 1958, le Département d'Etat accusait Renault et Peugeot de vendre leurs voitures à un prix moins élevé à l'étranger que sur leur propre marché, en dessous de leur prix de revient, en un mot de faire du dumping. Et il y avait effectivement une part de vérité. L'Aronde était moins coûteuse à l'achat aux Etats-Unis qu'en France, malgré les surcoûts liés au transport et à la mise aux normes US. Renault perdait de l'argent sur chaque Dauphine vendue, et ne pouvait poursuivre ses exportations que grâce aux compensations financières apportées par l'Etat français. Peugeot perdait 30 000 francs en 1958 sur chaque 403 exportée dans le monde. L'administration lui reversait 35 000 francs par véhicule. Mais il fallait rester discret ... Pour leur défense, les constructeurs français indiquèrent que les modèles qu'ils vendaient aux Etats-Unis étaient différents des versions européennes. Mais l'argument manquait de consistance. D'autres sources de non-conformité à la loi apparurent. Les Français pratiquaient outre-Atlantique la vente sélective et exclusive, ainsi que la fixation des prix de vente. Si cela était pratique courante en France, aux Etats-Unis, il s'agissait d'une violation des intérêts du consommateur. Chez Renault, on tenta de contourner la réglementation en prenant soin de ne jamais formaliser par écrit ces pratiques. Mais l'administration américaine n'était pas dupe. Renault fut assigné en justice. Au final, le conflit fut réglé entre le Ministère des Affaires étrangères et l'Ambassade des Etats-Unis en France. En juin 1959, les autorités renoncèrent à leurs poursuites, l'affaire se solda par un rappel à la loi, mais la Régie fut tout de même contrainte de renoncer à ses pratiques. L'intendance ne suivait pas Les carences de l'après-vente Renault condamnèrent les petites françaises. Souvent en panne, les voitures étaient immobilisées des mois en attente des pièces de rechange. L'effet était dévastateur sur le plan commercial, entraînant notamment la Régie dans une spirale infernale. La réputation de la Dauphine était celle d'une voiture frivole, par opposition à la Volkswagen qui bénéficiait d'une image inattaquable de solidité, de résistance et de sérieux. Cette image de frivolité à la française pouvait convenir à une marque de parfum, pas à une automobile. La communication, arme de destruction massive La grande revue américaine " Automotives News " diffusait fin 1958 une page de publicité rédigée par une organisation qui se prétendait indépendante, dévouée à la sécurité publique, et qui se nommait " Motor vehicle research of New Hampshire ". Le libellé du texte était édifiant. Photographies à l'appui, cet organisme attirait l'attention des professionnels de l'automobile sur l'immense danger représenté par les petites voitures européennes lors des collisions avec les voitures américaines plus lourdes. La menace était claire, d'autant plus que l'on rendait en quelque sorte les vendeurs de voitures européennes responsables des accidents qui pouvaient survenir. Cette homélie était accompagnée de photographies montrant une Volkswagen et une Dauphine en piteux Etat. Cet organisme omettait de préciser que les faibles dimensions d'une Dauphine et sa vivacité de réaction constituaient des éléments de sécurité aussi importants que le poids ... Il ne précisait pas non plus que le freinage des américaines à la fin des années 50 était notoirement insuffisant au regard des masses à arrêter. Fin 1959 et début 1960, en quelques mois, les ventes des quatre constructeurs français s'effondrèrent brutalement sous les coups de butoir. La deuxième vague de compactes C'est en 1960 et 1961 que la General Motors, les groupes Ford et Chrysler présentèrent leurs nouvelles voitures compactes : Chevrolet Corvair, Buick Special, Ford Falcon, Plymouth Valiant, Dodge Lancer ... Les Américains aiment les nouveautés. Les compactes étaient nouvelles, et répondaient plus aux goûts de 1961 que les petites voitures françaises qui commençaient à dater. Pour enfoncer un peu plus le clou, la GM et Ford aidèrent leurs filiales européennes à exporter vers les Etats-Unis leurs Ford Taunus, Opel Rekord et Vauxhall Victor.
Ford Falcon, 26 % des acheteurs de Falcon demandaient la reprise d'une Européenne. Copyright Déstabiliser les dealers Les pressions étaient importantes envers les dealers (appellation américaine des distributeurs) des marques françaises, souvent multimarques. Les big three menaçaient de leur retirer la concession de leurs voitures s'ils s'obstinaient à vendre des françaises. En parallèle, ils donnaient à leurs distributeurs les moyens d'accorder de substantiels rabais aux clients hésitants, rendant de fait les européennes invendables. Dès les premières bourrasques, les défections de concessionnaires affluèrent. Le nombre des représentants Renault passait ainsi de 800 en 1959 à moins de 600 en 1961. Des chiffres Alors que le nombre total de voitures françaises vendues aux Etats-Unis étaient de 186 000 voitures en 1959, il chutait à 42 000 unités en 1961. C'est pour Renault que la dégringolade fut la plus cruelle, avec 28 760 ventes en 1961 contre 118 051 en 1959. Pour Peugeot, c'était 5 765 voitures en 1961 contre 17 500 deux ans plus tôt. Nos constructeurs nationaux peu habitués à ce type de renversement - la clientèle européenne était moins versatile - mirent un certain temps à analyser cette situation. Mais cette crise n'existait pas pour les firmes qui luttaient et qui disposaient d'un réseau fiable. Ainsi, de 1958 à 1962, Triumph passait de 13 100 à 15 700 voitures, Volvo de 11 600 à 13 000, Mercedes de 7 100 à 11 000, Austin Healey de 4 200 à 10 000. Quand à Volkswagen, il caracolait très loin de tous ses rivaux et dominait totalement le marché, continuant à progresser alors que toutes les marques françaises reculaient. Savoir en tirer les conséquences L'échec fut formateur pour les entreprises françaises. Il leur a permis de se rendre compte à quel point l'approche d'un marché devait se travailler en amont. Les constructeurs perçurent aussi dans quelle mesure les moyens à mettre en oeuvre sur le plan logistique ne pouvaient souffrir de la moindre insuffisance. Un réseau se construit pas à pas. Les Français eurent tendance à accepter n'importe quel revendeur, dans la mesure où celui-ci s'engageait effectivement à vendre des voitures. Le réseau routier américain ne ressemblait pas à nos nationales bien entretenues. Dans l'Hexagone, pays tempéré, on n'était pas soumis de la même manière aux chaleurs caniculaires et aux tempêtes de neige. Seul Peugeot avec des voitures qui n'étaient pas produites à l'économie était parvenu à ne pas écorner son image de marque. A la Régie, Pierre Dreyfus délégua son émissaire Maurice Bosquet pour tenter d'y voir plus clair. Celui-ci évalua très vite la gravité de la situation. Les centaines de dealers recrutés avaient perdu confiance. Les dernières règles imposaient que ceux-ci s'engagent à acheter immédiatement 30 à 40 voitures, ce qui gonflait les commandes à l'usine, mais aussi les stocks de voitures devenues invendables chez eux. Et c'était sans compter sur les milliers de voitures qui s'entassaient sur les docks.
Les milliers de voitures qui s'entassent sur les docks. Copyright Retour vers une normalisation En 1961, les constructeurs français reprenaient quelques couleurs. Renault tentait de contenir l'hémorragie. Peugeot faisait montre d'une régularité relative. La 404 trouvait sa clientèle, tandis que la 403 démodée était devenue difficile à vendre. Simca, qui avait plongé, s'efforçait de redresser la situation. Le constructeur de Poissy n'avait pas su tirer parti du réseau Chrysler dont il pouvait disposer. Les Citroën, si elles attiraient les foules au Salon de New York, ne faisaient pas pour autant se remplir les carnets de commandes. Leurs ventes étaient confidentielles. Les constructeurs français adoptèrent un profil bas à partir des années 60, sans pour autant abandonner le marché. Les voitures importées avaient perdu de leur intérêt économique sur le sol américain face aux compactes US. Mais stratégiquement, même si cela avait un coût, maintenir une tête de pont aux Etats-Unis semblait indispensable.
Une 403 beige et une Caravelle rouge chez un marchand de voitures européennes en 1962 - Source : AJ numéro 289 du 11 janvier 1962). Copyright Des normes de plus en plus contraignantes A partir de 1967, l'application de nouvelles normes de pollution et de sécurité passive contribua à élargir le fossé entre ce que nous produisions et ce qu'exigeait le marché américain. Progressivement, les constructeurs français comprenaient que leur avenir à l'exportation devait se jouer ailleurs qu'aux Etats-Unis. Le Marché Commun, en cours de développement, allait s'avérer un territoire bien plus accueillant.
Un dealer Citroën dans les années 60. Copyright Les chocs pétrolier de 1973 et 1979 Les constructeurs américains qui avaient prouvé vers 1960 leur souplesse industrielle avec la naissance des voitures compactes ne réagirent pourtant pas aussi rapidement après le premier choc pétrolier de 1973. A Detroit, on continuait de fabriquer des V8 de 5 litres dont les Américains étaient jusqu'à il y a peu de temps si friands. Le marché des petites cylindrées restait marginal. Les Japonais perçurent rapidement l'opportunité qui s'offrait à eux. Au cours de la seule année 1975, la pénétration de Honda doublait, passant de près de 50 000 voitures à 100 000, grâce à l'introduction de la petite Civic.
La Honda Civic fit un carton aux States. Copyright Mais c'est le deuxième choc pétrolier qui devait véritablement faire office de révélateur. En 1978, le gallon d'essence (3,78 litres) valait 0,65 $. Deux ans plus tard, il coûtait 1,21 $. L'augmentation du prix du carburant incita enfin les Yankees à ne plus considérer l'essence comme de l'eau. Le choc psychologique fut plus violent qu'en Europe, où nous étions habitués à de fortes hausses, mais mieux étalées dans le temps. Désormais, les constructeurs nationaux et les importateurs étaient tenus d'afficher des consommations normalisées. En parallèle se développait une vigoureuse campagne d'économie d'énergie. Les petites cylindrées bénéficiaient de nouveau d'un réel engouement. En quelques mois, les Japonais voyaient leur part de marché progresser de 15,8 à 21 %. Un boulevard semblait aussi s'ouvrir pour Renault et Peugeot encore présents en Amérique du Nord. Mais ce n'était pas aussi simple que cela pouvait en avoir l'air. L'acheteur américain était conservateur. S'il était disposé à acquérir une voiture économique, il ne fallait pas que celle-ci rompe brutalement avec ses habitudes. Elle devait être spacieuse et ne pas faire passer son acheteur pour un looser auprès de ses voisins. A ce titre, la voiture étrangère se devait de conserver un bon niveau de représentativité, quitte à l'américaniser à coup de décorations et d'options diverses. Les Japonais étaient très habiles dans ce domaine. Ils surent mieux que quiconque s'adapter aux différents types d'acheteurs mais aussi aux multiples réglementations concernant la sécurité et le respect de l'environnement. C'est dans ce contexte que la Régie et le constructeur de Sochaux tentèrent de tirer leur épingle du jeu, avec des fortunes diverses. Dans les quatre chapitres à venir, nous allons évoquer, constructeur par constructeur, puis modèle par modèle, les aventures américaines de nos " small four ", depuis les débuts souvent timides, jusqu'à la chute parfois brutale. Sommaire - France / USA - Citroën - Peugeot - Renault - Simca - Conclusion Citroën Préambule Durant les années 20 et 30, le constructeur de Javel tenta de vendre ses automobiles en Amérique du Nord, par le biais de l'importateur Foreign Motors Corporation de New York. Quelques rares publicités de presse et brochures en noir et blanc témoignent de cette époque. En dehors de cette tentative, avant-guerre, quelques indépendants importèrent au compte-gouttes des Citroën " Front Wheel Drive " depuis la France. " The Challenger Motor Car Co. " à Los Angeles et le garage " Campbell Motors " de South Pasadena en Californie étaient de ces francs-tireurs. Les quelques brochures diffusées étaient directement inspirées par celles émises par la filiale britannique de Citroën. Au début des années 50, le service Grande Exportation de Citroën laissa partir vers les USA une vingtaine de Traction, des 11 et des 15 Six. Mais l'absence de structure sur place fit que l'affaire tourna au vinaigre, et que la plupart des voitures finirent leur carrière abandonnées sur une aire de stockage portuaire.
Avant que le constructeur de Javel ne s'implante lui même aux USA, des importateurs indépendants prirent en charge l'importation de quelques voitures. Copyright Durant cette même décennie, de nombreux français expatriés aux Etats-Unis revenaient régulièrement dans l'Hexagone pour y passer leurs vacances. Aux Etats-Unis, l'automobile était devenu en quelques années un objet de consommation courante, dont il n'était plus question de se passer, même lorsque l'on regagnait la France pour quelque temps. Pour cette clientèle disposant de ressources financières conséquentes et pour les touristes américains que cela pouvait intéresser, Michelin, propriétaire de Citroën, créa en 1952 une société baptisée " Citroën Car Corporation ". Cette structure vendait à ces visiteurs occasionnels la voiture dont ils avaient besoin pour leurs déplacements dans l'Hexagone. Après réception de la commande, qui prévoyait contractuellement une garantie de rachat, la voiture était livrée à leur arrivée sur le territoire national, avec une immatriculation en plaques TT, qui leur permettait ainsi de circuler librement en Europe. Lorsqu'ils repartaient vers les Etats-Unis, Citroën pouvait prendre en charge l'exportation de la voiture s'ils voulaient la conserver, ou plus simplement la racheter. L'affaire était économiquement intéressante dans ce dernier cas, car jusqu'au milieu des années 50, la demande d'automobiles en France était telle qu'une occasion récente disponible immédiatement se vendait plus cher qu'une voiture neuve. C'est à partir de 1954 que la maison mère publia chaque année une brochure destinée à ces potentiels acheteurs.
Extrait de la brochure Citroën de 1955 destinée aux touristes américains en France, vantant les mérites du " Citroën Overseas Delivery Plan ". Copyright Charles Buchet rentrait chez Citroën en 1952. En 1954, en s'appuyant sur la structure de " Citroën Car Corporation ", il allait préparer l'arrivée officielle de la marque aux Etats-Unis qui allait se concrétiser avec la présentation de la DS au Salon de New York en 1956. Dans un premier temps, afin de subvenir aux besoins de " Citroën Car Corporation " désormais implanté aux USA, il perfectionnait et développait le système des ventes sous plaques TT. Outre le DS qui prenait doucement son envol commercial, et pour développer un peu son offre produit, à partir de 1957 Charles Buchet décidait d'importer quelques centaines de Panhard. Cela devait permettre aux dealers Citroën d'augmenter leurs volumes de ventes et de mettre un peu de beurre dans les épinards. Mais la Panhard s'avéra trop fragile aux yeux de la clientèle américaine. L'expérience ne fut pas prolongée, faute de réussite commerciale.
La Panhard accompagna durant quelques mois la DS sur le sol américain, sans succès. Copyright Pour des raisons évidentes de rentabilité, les revendeurs Citroën représentaient toujours plusieurs marques européennes ou américaines. L'étroitesse de l'offre du constructeur de Javel ne permettait pas à ceux-ci d'assurer un équilibre économique satisfaisant et durable. Citroën DS En France, la présentation de la DS au Salon de Paris en octobre 1955 eut un retentissement international. Elle arrivait aux Etats-Unis au cours de l'été 1956, avec une première exposition à l'International Automotive Show de New York. Le public fut étonné par l'esthétique de la voiture et par ses particularités techniques. Dans un pays par tradition conservateur et nationaliste, la présence d'une voiture sans calandre, qui monte et qui descend, laissait perplexe. Cependant, on n'atteignait pas le même degré de fanatisme qu'en France. La DS à la mode américaine ne différait que très peu de la version française. On notait l'adoption de phares blancs, de feux arrière circulaires indépendants et de feux clignotants spécifiques. Au tout début, ces modifications étaient réalisées à l'arrivée des voitures aux Etats-Unis, mais bientôt c'est directement l'usine de Javel qui s'en chargeait sur la chaîne de montage.
Extraits du catalogue Citroën DS 19, marché américain, 1956. Ce document est quasiment identique à celui diffusé par Citroën Cars Ltd en Angleterre. Copyright Les publicités décrivaient la voiture comme " typiquement française ... donc incontestablement Citroën ... combinant les performances de la voiture de sport avec le luxe de la limousine ". Le dossier de presse évoquait " la voiture de rêve de demain, sur la route aujourd'hui ". Citroën tentait d'attirer l'attention d'éventuels revendeurs en proclamant que " la DS 19 était la voiture pouvant générer plus de vente que n'importe quelle autre voiture importée connue ". Pour les revendeurs, il n'était pas évident de confier le volant d'une DS à un éventuel client. La manière de changer les vitesses n'avait rien à voir avec ce qui se pratiquait aux Etats-Unis. Le conducteur avait par ailleurs de quoi s'inquiéter en observant le petit champignon qui faisait office de pédale de frein. Cette pédale n'avait rien à voir avec celle d'une voiture américaine classique, plus proche des dimensions d'une raquette de tennis. Citroën installait son siège américain et un show-room sur Park Avenue à New York à la fin de l'année 1956. Si les ventes de DS peinaient à décoller dans les petites villes de province, il en était tout autrement à New York. Cela tenait essentiellement à la présence d'une clientèle d'avocats, de médecins, d'artistes, d'intellectuels ... qui d'un point de vue socio-économique était largement au-dessus de la moyenne. Ce public était disposé à rouler différemment, quitte à en assumer tous les inconvénients.
L'actrice Jayne Mansfield assiste à l'inauguration du show-room Citroën à New York. Copyright L'ID, modèle plus économique, venait compléter la gamme en 1957. Cette année-là, une ID valait 2600 $ et une DS 3500 $. Ce tarif plaçait l'ID au niveau d'une américaine de gamme moyenne (Ford, Chevrolet ...), tandis que la DS rejoignait le plus haut de gamme (Buick, Chrysler, Mercury ...), sans atteindre le prix des Cadillac et autres Lincoln. L'administration américaine ne fit aucun cadeau à la DS. Des bâtons lui furent mis dans les roues en refusant d'homologuer l'huile de son système hydraulique ! Peut-être pouvait-on y voir une forme de protectionnisme ? Elle imposait à la place un produit américain similaire. Mais celui-ci ne présentait pas les caractéristiques chimiques requises, et rongeait les joints d'étanchéité, mettant régulièrement la DS en panne ! Près des ateliers New-yorkais de Citroën, les DS en panne d'hydraulique s'entassaient dans la rue. Ce problème d'huile était catastrophique pour le constructeur de Javel, qui se mit en quête d'une huile produite aux Etats-Unis, qui permette d'éviter les ruptures de joints et les fuites. Mais l'huile qui semblait adaptée se liquéfiait à San Francisco et se figeait à Boston, bloquant la boîte de vitesses. Les ingénieurs de Javel délégués sur place découvrirent d'autres faiblesses sur la DS : les faisceaux électriques prenaient l'eau, les peintures ternissaient, les plastiques craquelaient, les aciers rouillaient ... La monte des pneumatiques était une autre source de tracas. Un seul type de pneus convenait aux DS, il s'agissait d'un modèle bien précis de la maison Michelin ... bien entendu. Le contrat de vente stipulait que la garantie ne pouvait être maintenue qu'à la condition de rouler chaussé de pneus Michelin. La seule difficulté consistait en l'approvisionnement de ces fameux pneus sur le sol US. Cela n'avait visiblement pas été anticipé.
Extraits du catalogue Citroën DS 19, marché américain, 1957 - Ce document est quasiment identique à celui diffusé par Citroën en France. Copyright Citroën avait de grandes ambitions aux Etats-Unis, mais à Javel on n'avait pas pris le temps d'analyser les modes de consommation des Américains, ni d'observer leur manière de conduire. Ceux-ci étaient assez peu soucieux du suivi de leur auto, ce qui pour une automobile aussi sophistiquée que la DS, ne pouvait conduire qu'au désastre. Pour palllier aux premiers problèmes rencontrés par la DS, une équipe de mécaniciens volants fut constituée à la hâte. Quelques mécanos étaient prêts en permanence à répondre à toutes les demandes des clients en panne. A bord de voitures ateliers, ils n'hésitaient pas à parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour remettre en état de fonctionnement les DS. A l'usage, il s'avéra que les dealers sélectionnés n'avaient pas vraiment été formés ni à l'entretien ni à la réparation de la DS. Les tâches à effectuer n'avaient rien à voir avec les travaux réalisés sur une Chevrolet ou une Ford. Trop souvent, les DS restaient de nombreux mois sur les parkings des revendeurs, en attendant de pouvoir être réparées avec des pièces détachées qui peinaient par ailleurs à arriver de France.
Les égards des dockers havrais ne manquent pas pour les Citroën DS qui sont amenées en chemin de fer jusqu'au quai de chargement - Source Auto Journal numéro 223 du 1er juin 1959. Copyright Les Français, habitués depuis la fin de la guerre à faire avec ce que les constructeurs nationaux acceptaient de leur vendre, se montraient indulgents. L'état d'esprit était tout autre aux States. La clientèle américaine se montrait extrêmement exigeante. Après plusieurs mois d'attentisme, les voitures à destination des USA firent l'objet de plus de soins lors de leur assemblage en France. Heureusement, pas à pas, le réseau Citroën allait se structurer. Les pièces détachées arrivaient par avion, et étaient entreposées dans deux entrepôts, l'un à New York, l'autre à Los Angeles. Des techniciens continuaient à se déplacer d'agence en agence pour assister les mécaniciens dans la réparation des véhicules. Une école de formation interne fut même créée, où durant une semaine, et aux frais de Citroën, les mécaniciens étaient formés aux subtilités de la technique française.
Recto d'un feuillet publicitaire, 1958. Copyright Le correspondant de l'Auto Journal aux Etats-Unis, Bob Mitchell, décrivait ainsi le positionnement de Citroën sur le marché américain dans le numéro 190 du 15 janvier 1958 :
Citroën Car Corporation utilisait abondamment des " tiré à part " des magazines automobiles pour vanter les mérites de l'ID et de la DS. C'était au moins la preuve que le constructeur ne craignait pas les jugements des journalistes spécialisés ... à condition de reproduire intégralement ces articles. Les vrais catalogues publicitaires, à la manière des Delpire européens, étaient plutôt rares. Les supports papier se limitaient le plus souvent à quelques feuillets ou dépliants d'aspect pas toujours très flatteur. Cette pratique contrastait avec le luxe des brochures publiées par les constructeurs américains. Quelques extraits de ces " tiré à part " :
Publicité au verso d'un " tiré à part " de 1960. Copyright A partir de 1961, la DS Décapotable, un must du luxe à la française assemblé chez Chapron, arrivait sur un marché américain friand de ce type de produit exotique. Malgré son prix nettement supérieur à celui d'une Cadillac, elle rencontra un certain succès sur la côte Ouest, notamment en Californie. Environ 120 DS Cabriolet de 7 ID Cabriolet furent exportées vers les Etats-Unis jusqu'en 1971.
Citroën DS Cabriolet, en version US. Copyright L'arrivée de la seconde génération de DS en 1968 obligea Citroën à s'adapter aux plus récentes normes américaines. Ce qui retenait le regard, c'était les phares fixes insérés dans un bloc d'aluminium, sans vitre de protection.
Brochure publicitaire Citroën, 1972. Copyright La diffusion des DS en Amérique cessa officiellement à l'issue du millésime 1972. Quelques DS 23 furent encore importées ultérieurement, mais à titre individuel.
Notez les énormes pare-chocs sur ce break DS version US. Copyright Citroën 2CV La 2 CV était en total décalage avec le rêve américain qui privilégiait à la fin des années 50 les grosses voitures aux lignes délirantes et aux moteurs surdimensionnés. Aux Etats-Unis, le problème de la consommation de carburant n'était pas encore à l'ordre du jour. En 1955, la 2 CV était affichée aux environs de 1200 $, à comparer aux 1600 $ requis pour un modèle d'entrée de gamme de Chevrolet ou de Ford. Citroën diffusa aux Etats-Unis trois versions de la 2 CV, la berline classique, un break vitré et un break tôlé. L'administration américaine trouva un moyen simple d'interdire la poursuite de sa commercialisation aux Etats-Unis, en relevant la vitesse minimale sur ses highways. En pleine charge, la 2 CV était incapable d'atteindre le seuil fixé.
La " 2 CV Passenger car convertible 4-Doord, 4-Seater telle que présentée dans une brochure américaine. Copyright Durant les années 60, quelques 2 CV furent encore importées à titre individuel grâce au " Citroën Overseas Delivery Plan ". Mais il s'agissait de voitures en configuration européenne. Au cours des années 80, quelques fanatiques diffusèrent des 2 CV aux Etats-Unis, en contournant les sévères normes d'homologation. Ainsi des 2 CV Charleston furent importées par Michel Fournet, puis démontées et entièrement remontées sur d'anciens châssis qui bénéficiaient d'une homologation. Une autre société, Target, importa la 2 CV pour la vendre sous forme de voiture en kit, ce qui permettait de détourner certaines règles d'homologation. Citroën Ami 6
La Citroën Ami 6 dans sa version américaine. Copyright La berline Ami 6 fut diffusée sur le marché américain entre 1963 et 1968. La version break complétait l'offre à partir de 1966. Les ventes de l'Ami 6 furent très confidentielles, à peine quelques dizaines d'unités. L'Ami 6 américaine se différenciait notamment par des optiques avant jumelés, des feux clignotants différents, des pare-chocs avant et arrière équipés de tubes de protection, et un compteur de vitesse en miles. Comme le précisait Charles Buchet : " il suffit d'imaginer quatre Américains, solidement gavés de Big Mac et de Coca, installés tant bien que mal dans une petite berline propulsée par un moteur de 2 CV pour se rendre compte qu'elle ne correspond pas vraiment aux réalités du marché américain ". On estime à environ 800 le nombre de 2 CV et d'Ami 6 vendues par Citroën aux Etats-Unis. Encore une fois, la littérature publicitaire était réduite à sa plus simple expression. On notait tout de même une version US du célèbre catalogue " Pour vous Madame " édité en 1963 par Delpire en charge des publicités Citroën. Le catalogue " For you Madame " reprenait certaines photos de l'édition française, mais d'autres prises de vues étaient totalement originales.
Ce simple feuillet recto verso ne pesait pas lourd face aux brochures couleurs des autres importateurs européens, et encore moins face aux prestigieux catalogues des big three. Copyright
Dans cette publicité, Citroën insiste sur la qualité de son service après-vente. Copyright Citroën Mehari Citroën introduisait la Mehari (sans accent) sur le sol américain en 1970. Elle y était présentée comme une concurrente des buggies à mécanique Volkswagen. Réglementation oblige, son apparence avait été modifiée par rapport à la version européenne. Des phares avant de plus grande taille étaient montés, modifiant de manière significative son regard. Le capot avait été transformé pour les accueillir. Les clignotants et les catadioptres étaient également différents. L'emplacement de la plaque d'immatriculation arrière était spécifique. Pour des raisons de sécurité, il fut nécessaire d'adopter un entourage de pare-brise en tôle. Les portières laissaient leur place à une simple cordelette.
Extrait d'un dépliant publicitaire pour le marché américain, janvier 1970. Copyright Ce véhicule présenté en France en mai 68 n'a pas rencontré le succès escompté de l'autre côté de l'Atlantique. Il semblait pourtant particulièrement adapté aux usagers des plages californiennes, ou à ceux qui souhaitaient disposer d'un véhicule de loisirs à moindre coût. Le loueur Budget en commanda une centaine pour enrichir son parc sur l'île d'Hawaï. Mais si sa carrosserie plastique ne craignait pas la corrosion, elle n'avait pas été conçue pour supporter les hautes températures constantes que l'on pouvait rencontrer sur les côtes américaines. Les panneaux de carrosseries se fissuraient, et les teintes du plastique perdaient leur aspect des débuts. Face à la Mehari, la Volkswagen VW 181 qui possédait quatre portes, une carrosserie tout acier et une puissance plus élevée disposait de plus d'atouts. La Mehari fut disponible au catalogue de Citroën USA en 1969 et 1970. Son constructeur préféra renoncer face aux exigences réglementaires de plus en plus sévères. Mettre l'auto en conformité avec la législation aurait été trop coûteux au regard de son potentiel commercial. Elle fut vendue à environ 1000 exemplaires, essentiellement en Floride et en Californie.
Extrait d'un feuillet publicitaire pour le marché américain, avril 1969 - La photo est identique à celle utilisée pour un dépliant destiné au marché français. Copyright Citroën SM La SM fut commercialisée aux Etats-Unis durant les millésimes 1972 et 1973. Après l'abandon des ID, DS, Ami 6 et Mehari, il s'agissait de la dernière représentante de la marque aux chevrons sur le sol américain. Pour répondre aux réglementations de plus en plus rigoureuses en matière de sécurité, les SM destinées au marché US se distinguaient par une face avant munie de quatre phares ronds, fixes et sans plexiglas de protection. L'ensemble n'apparaissait pas franchement intégré aux lignes déjà controversées de la voiture. Deux motorisations étaient disponibles : V6 de 2670 cm3 et 180 ch SAE en boîte manuelle à 5 rapports, et V6 de 2965 cm3 et 190 ch SAE pour les modèles équipés de la transmission automatique. Le magazine Motor Trend décerna en 1972 à la SM le titre très convoité de " Car of the Year " dans la catégorie " Luxury ". Elle y devançait la Mercedes Classe S, la Jaguar XJ6 et un cortège d'américaines (Lincoln Mk IV, Cadillac Eldorado, Buick Riviera ...). Cela prouvait au moins l'intérêt que les journalistes américains portaient à notre GT nationale ! En quelques mois, la SM se couvrit de gloire aux Etats-Unis en remportant trophées et récompenses dans des joutes organisées par les magazines spécialisés.
Citroën SM, version américaine. Copyright Extrait de Car and Driver :
Extrait du Petersen's '71 Import Car Buyer's Guide :
Extrait de Magazine Road Test, Avril 1972 :
Mais après les louanges initiales, les choses allaient vite changer pour la SM. Les clients déchantèrent rapidement. Totalement désorientés par cette technique quasi spatiale, les amateurs découvraient aussi que cette voiture qui requérait des soins réguliers tombait en panne au bout de quelques mois d'utilisation. Qui plus est, il était difficile pour Citroën de proposer un service après-vente à la hauteur de la sophistication de la voiture, dans un pays aussi immense que les Etats-Unis. Le constructeur de Javel préféra jeter l'éponge deux ans avant l'arrêt définitif de la production en France. La SM fut la dernière Citroën diffusée officiellement vers les Etats-Unis jusqu'à nos jours. 2 037 exemplaires trouvèrent preneur durant les deux années de commercialisation, sur un total de 12 920 voitures produites, une belle performance en soi. La SM ne disparaissait pas pour autant du paysage automobile américain, et l'intérêt des passionnés demeurait vivace outre-Atlantique. Au début des années 90, 75 % des SM produites y étaient encore en état de rouler. Citroën retirait toute représentation officielle aux Etats-Unis le 31 décembre 1977. Le nouveau propriétaire, Peugeot, décidait en effet de supprimer tous les dossiers Citroën non rentables. La survie en Europe de la marque aux chevrons était à ce prix.
Extraits de la brochure Citroën SM, marché américain, 1973 - Il s'agit sans doute du plus beau catalogue jamais imprimé pour promouvoir un modèle Citroën aux USA. Il existe en deux versions, couverture blanche (présentée ici) et couverture noire avec " Citroën " en relief. Copyright Citroën GS Citroën envisagea un temps de compléter sa gamme US avec la GS. Quelques exemplaires furent importés, et diffusés aux principaux distributeurs qui les exposèrent dans leur hall d'exposition. Des commandes furent enregistrées avant que Citroën ne renonce définitivement à son idée d'introduire la voiture, face aux difficultés et au coût de mise aux normes US. Les commandes furent donc annulées, et les quelques modèles importés vendus au personnel des distributeurs locaux. Citroën CX
Extrait d'un dépliant CX Auto - Source http://www.citroenet.org.uk La CX n'a jamais été importée officiellement aux Etats-Unis par Citroën, même si le sujet fut initialement évoqué en interne. Les normes d'homologation devenues draconiennes rendaient en effet la tâche extrêmement difficile. Mais surtout l'absorption de Citroën par Peugeot en décembre 1974 modifiait la donne, le constructeur sochalien projetant de commercialiser aux Etats-Unis la 604, une concurrente directe. Deux sociétés au moins, Trend Imports et Yareb Hydraulics, importèrent en dehors de tout accord officiel avec Citroën quelques CX Diesel entre 1978 et 1982. Les voitures étaient modifiées pour répondre aux normes locales : barres de renfort dans les portes, pare-chocs plus importants, feux et clignotants, etc ... Mais la démarche qui marqua le plus les esprits fut celle de CX Automotive. Deux hommes étaient à l'origine de la création de cette société. Le premier, Malcom Langman, était un citroëniste américain convaincu. Il avait bien gagné sa vie dans la vente de matériel médical. Quand la firme de Javel se retira des Etats-Unis, il tenta de convaincre la maison mère que la CX avait sa place outre-Atlantique, mais en vain. L'autre homme de cette aventure s'appelait André Pol. Ce spécialiste Citroën implanté aux Pays-Bas disposait de la logistique nécessaire pour exporter des voitures vers l'étranger. C'était avant la naissance de CX Automotive l'une de ses activités. Malcom Langman s'appuya sur la législation européenne qui permettait d'acheter des voitures françaises ailleurs qu'en France, pour les revendre ensuite où on le désirait. André Pol se chargeait de trouver des CX neuves en Europe, pour les céder ensuite à Langman. Il restait ensuite à les mettre aux normes US. Les premières CX, des versions diesel, furent acquises en Suisse, où elles étaient déjà équipées des systèmes de dépollution imposés aux USA. La mise en conformité des diesels s'avérait être plus simple que celle des motorisations essence. La CX était évidemment vendue sans aucun soutien de Citroën, et ne pouvait prétendre ni au nom de Citroën, ni à l'utilisation du double chevron. Tout logo Citroën était donc proscrit sur la carrosserie. Toutefois, sur l'un des dépliants publicitaires, on pouvait lire " The CX comes from the production lines of Citroën " (La CX provient des lignes de production de Citroën). Disposer des voitures était une chose, les vendre en était une autre. Nos deux aventuriers se mirent en quête de distributeurs en passant des annonces dans la presse. Quelques garagistes enthousiastes, déjà représentants de marques européennes, se manifestèrent. L'importation débutait officiellement en 1979, et se prolongea jusqu'en 1991. En 1981, la mise en commun des participations de Malcom Langman et d'André Pol donnait naissance à CX Automobiles Europe SA, société dirigée par André Pol, qui prenait en charge l'importation de versions à essence. Une structure baptisée Green Automotive installée aux-Pays Bas préparait les voitures à destination des Etats-Unis. Ce travail d'adaptation nécessitait environ 180 heures de travail. La structure et les portes de la voiture était renforcés, une nouvelle peinture était appliquée, la partie électrique était revue, une climatisation était installée, de même qu'une sellerie cuir, un toit ouvrant, de nouvelles garnitures, etc ... A leur arrivée aux Etats-Unis, les voitures étaient de nouveau contrôlées avant d'être distribuées à la vingtaine de dealers (leur nombre en 1988) qui avaient accepté de suivre Langman et Pol dans leur projet. Les objectifs ambitieux étaient de diffuser entre 1300 et 1500 voitures par an. La réalité fut plus rude. C'est moins d'une centaine de CX qui furent vendues annuellement, avec une pointe à près de 250 unités la meilleure année. Chez Citroën, on finit par s'émouvoir de ce marché parallèle. Mais le qualificatif de parallèle n'était pas adapté, puisque justement Citroën n'importait plus de voitures vers le Nouveau Continent. Qui plus est, avec la somme des modifications apportées à la CX, Langman finit par obtenir des autorités américaines le statut de constructeur à part entière. En 1985, CX Automobiles Europe SA était remplacé par CXA International SA, basé dans le New Jersey. Langman et Pol étaient toujours aux commandes, l'un en tant que président, l'autre en tant que directeur. Désormais, les CX vendues aux Etats-Unis disposaient d'un numéro de série frappé par CXA et non plus par Citroën. Cela ne pouvait qu'agacer encore un peu plus le constructeur de Javel qui demeurait bien démuni sur le plan légal pour faire cesser cette activité. Les faibles quantités importées, le coût de mise aux normes US et l'absence totale de soutien d'un grand constructeur conduisaient à un prix de vente relativement élevé. Outre le break, les voitures étaient vendues dans des versions haut de gamme : GTi, Turbo, Prestige ...
Extrait d'un dépliant CX Auto. Copyright Citroën XM La XM remplaçait la CX à partir de 1989 en Europe. Au Salon de New York de 1991, CXA exposait deux XM modifiées qui répondaient aux normes américaines. Pour contrer CXA, Citroën présentait lui aussi la XM sur un stand installé dans ce même salon, et signifiait ainsi son intention de revenir officiellement aux Etats-Unis. On sait aujourd'hui qu'il n'en fut rien, mais on ignore s'il s'agit d'un projet avorté, ou plus simplement d'une volonté de mettre des bâtons dans les roues de cet encombrant franc-tireur. La XM de CXA était disponible à partir de septembre 1991, en version Vitesse motorisée par le V6 3 litres et Pallas par le 4 cylindres 2 litres. La XM n'était plus préparée aux Pays-Bas, mais directement aux Etats-Unis par une société du nom de Automotive Reserch and Design, dont Langman était actionnaire. L'un des objectifs de cette société qui pouvait travailler pour d'autres constructeurs était de faciliter l'adaptation des voitures étrangères aux normes américaines.
European Car of the Year 1990, XM Vitesse, by CX Auto. Copyright Evidemment, comme pour la CX, Citroën retirait toute garantie sur ces véhicules. C'est CXA et son réseau - qui atteignait désormais une soixantaine de centres de maintenance - qui assurait le suivi de ces automobiles. La diffusion de ces XM fut encore plus confidentielle que celle de la CX. Son prix largement supérieur à celui de sa devancière avait de quoi décourager les éventuels acheteurs. Au final, le combat de Citroën pour faire cesser ces ventes n'avait plus de raison d'être. De nouvelles normes encore plus sévères enlevaient toute possibilité à CXA de poursuivre dans des conditions acceptables la diffusion de la XM aux Etats-Unis.
Peugeot Préambule Dès le milieu des années 50, l'état-major de Peugeot intensifiait ses efforts en direction des marchés étrangers, devenant même le constructeur français exportant dans le plus grand nombre de pays, 90 en 1955, 130 en 1960. Jusqu'en 1958, l'importation aux Etats-Unis était assurée par des structures indépendantes du constructeur sochalien.
L'Auto Journal dressait la situation de Peugeot aux
Etats-Unis
dans son édition du 15 janvier 1958 :
Peugeot annonçait son implantation officielle aux Etats-Unis lors de l'International Automobile Show de New York en avril 1958, et installait sa filiale à Long Island à New York, en charge de la publicité et de l'après-vente. 8000 voitures devaient être importées la première année. Les pouvoirs publics conseillèrent à Peugeot de prendre appui sur le savoir-faire de Renault en matière d'importation aux Etats-Unis. C'est dans ce contexte que Maurice Jordan, à la tête de Peugeot, rentra en contact avec Pierre Dreyfus, PDG de Renault, afin d'unir leurs forces en partageant les coûts de dédouanement et de distribution, mais pas celui du transport vers les Etats-Unis. Peugeot préférait en effet faire appel à une compagnie qu'il jugeait plus compétitive que celle de Renault. Les deux marques allaient s'appuyer initialement sur le réseau commercial déjà installé par Renault, afin de proposer sur place une gamme étagée comportant la 4 CV, la Dauphine et la 403. Il n'était pas question d'exporter la 203, qui aurait risqué de cannibaliser la Dauphine. De la même manière, Renault renonçait à diffuser la Frégate qui se serait alors heurtée à la 403.
Extrait de l'Auto Journal numéro 195 du 1er avril
1958 :
Le 20 mars 1958, le cargo Saint-Nazaire embarquait à Brest 225 Peugeot à destination de New York - Source : Auto Journal numéro 195 du 1er avril 1958. Copyright François de Peyrecave qui dirigeait la filiale de Peugeot aux Etats-Unis était le fils de l'un des anciens proches collaborateurs de Louis Renault, René de Peyrecave, directeur général de la SA des Usines Renault. Cette situation était de nature à faciliter les contacts avec la Régie.
Un article à la une de l'AJ numéro 194 du 15 mars
1958 évoquait ce réveil soudain de Peugeot :
Contrairement à Renault qui avait mal maîtrisé ses volumes d'exportation, Peugeot s'engagea avec plus de prudence, pour y remporter un certain nombre de succès, modestes, mais plus durables que son partenaire. Néanmoins, le constructeur sochalien subissait aussi en 1960 une baisse significative de ses ventes, et fut également contraint de rapatrier en France des voitures invendues, notamment des 403 démodées après l'arrivée de la 404. Pour le reste, les voitures expédiées trouvaient toujours preneur. Alors que Renault croulait sous les difficultés, plutôt que de se laisser entraîner dans le tourbillon infernal, Peugeot préféra prendre ses distances vis-à-vis de son partenaire. Pour marquer les esprits, la marque proposait une garantie d'un an ou 12 000 miles sur ses voitures neuves, l'usage partout ailleurs étant limité à une protection de six mois. Peugeot entreprenait aussi la constitution d'un réseau indépendant, en concentrant d'abord ses efforts sur l'Est des Etats-Unis. Peugeot aux Etats-Unis prenait le nom de " Peugeot Inc ". Cette structure adoptait le statut de filiale, et installait son siège dans le très chic quartier de Forest Hills, toujours à New York. Entre 1963 et 1967, le constructeur écoulait environ 3000 voitures par an, et demeurait bénéficiaire. La 403 poursuivait modestement son bonhomme de chemin jusqu'en 1966, tandis que la 404 cédait sa place à la 504 à partir de 1969. Renault ne fut pas le seul constructeur français à s'intéresser à AMC. Des contacts furent établis entre Peugeot et AMC dès 1977. Mais à Sochaux, on ne souhaitait pas s'engager financièrement dans l'entreprise américaine. Il s'agissait plutôt d'un échange de bons procédés. Peugeot aurait apporté à AMC une petite voiture dont le constructeur pensait avoir besoin, une voiture qui aurait été produite dans son usine de Kenosha (Etat du Wisconsin) en utilisant des éléments importés de France. En échange, AMC aurait cédé à Peugeot la diffusion de la Jeep à travers le monde. Jeep était intégré à AMC depuis 1970, après avoir été racheté à Kaiser Frazer. Les négociations avec Peugeot n'aboutirent pas. Face au constructeur de Sochaux, Renault avait aussi ses négociateurs sur place, mais surtout la Régie proposait à AMC un apport en capital dont le quatrième constructeur américain avait vraiment besoin. La suite de l'histoire se joua donc chez Renault. Peugeot se rattrapa en mettant la main sur Chrysler Europe, allant ainsi au-devant de difficultés considérables, culminant avec la disparition de Talbot. De 1977 à 1983, Peugeot vendait aux Etats-Unis des 504 et 604. En 1984, la 505 remplaçait la 504, et tenait compagnie à la 604. De 1985 à 1988, seule la 505 occupait le marché, avant d'être rejointe de 1989 à 1991 par la 405. Les statistiques font état de 10 295 ventes pour le constructeur en 1977, puis 9 061 en 1978. Les chiffres sont inconnus pour 1979, mais s'établissent à 12 930 en 1980, 16 725 en 1981, 14 323 en 1982, 15 241 en 1983. L'année 1984 fut la meilleure année de Peugeot aux Etats-Unis. Le constructeur français y vendait 20 007 voitures. Ensuite, ce fut une lente dégringolade, avec 15 636 voitures en 1985, 14 296 en 1986, 9 422 en 1987, 6 713 en 1988, 6 095 en 1989, 4 292 en 1990, et seulement 2 223 en 1991. Peugeot avait renoncé à commercialiser sa 605 aux Etats-Unis, en raison notamment de la concurrence naissante mais réelle des nouvelles marques japonaises Lexus et Infiniti. La 405, dernière Peugeot à être exportée de manière régulière, eut bien du mal à maintenir ses positions. Le constructeur sochalien décidait sagement de se retirer définitivement à la date du 1er décembre 1991, quatre ans après Renault. La filiale du constructeur, Peugeot Motors of America, restait opérationnelle pour la fourniture de pièces et l'après-vente. Les ventes de Peugeot représentaient une goutte d'eau sur un marché d'environ 7 millions de véhicules vendus par an. Peugeot, tout comme Renault, ne souhaitait plus s'épuiser dans une région du monde où il manquait d'image et de réseau de distribution, et où le marché était saturé. Le constructeur français avait pourtant compris que pour séduire les Américains, il ne suffisait pas d'adapter les produits aux normes locales, mais qu'il fallait en plus concevoir dès l'origine des voitures répondant aux goûts de ce marché très particulier. Les constructeurs japonais surent intégrer cette notion avec plus de talent. Ceux-ci avaient envahi avec une vraie réussite le territoire, passant de 9 % de parts de marché en 1970 à 30 % en 1990, sans tenir compte des modèles nippons vendus sous des marques américaines.
Un lecteur de l'Automobile Magazine, ex-concessionnaire Peugeot dans le Massachusetts, s'exprimait ainsi dans le
courrier des lecteurs du numéro 550 d'avril 1992 :
Peugeot 403
L'une des dernières 403 exportées vers les Etats-Unis en 1966. Copyright Seulement quelques rares voitures atteignirent le sol américain avant que ne débute officiellement la commercialisation des Peugeot aux Etats-Unis. Quelques exemplaires de la 403 avaient été diffusés dès 1956 par Vaughn Imported Cars à New York, par John L. Green Junior à Los Angeles et surtout par Eastern Auto Distributors à Norfolk en Virginie. Une poignée de 203 avait également été vendue à la même époque. Peugeot ne reconnaissait pas officiellement ces tentatives, et n'appliquait pas sa garantie aux voitures ainsi vendues. Les données changeaient en 1958 lorsque le constructeur décidait de se doter d'une véritable structure d'importation pilotée par ses soins. L'atout de Peugeot, c'était la 403, un modèle récent apparu au Salon de Paris en octobre 1955, et qui bénéficiait de lignes agréables dessinées chez Pinin Farina, d'une mécanique parfaitement au point et d'une qualité de construction indiscutable.
Publicité presse, Peugeot 403. Copyright A Sochaux, on s'activait pour mettre au point la version américaine de la 403. Quelques exemplaires subirent avec succès les crash-tests réglementaires. La 403 USA était équipée de phares " sealed beams " et d'un petit rétroviseur extérieur. Pour le reste, les premiers modèles ne se distinguaient en rien de ceux qui étaient vendus en France. Seule la berline était au programme initial. En mai 1959, elle était épaulée par le break appelé " Station Wagon " qui recevait la finition soignée de la berline. Le cabriolet, que l'inspecteur Columbo popularisa chez nous, n'était disponible que sur commande spéciale. L'accord de distribution conclu avec Renault permettait de proposer dans un premier temps la 403 en dessous de 2200 $, alors que sans cette collaboration, il aurait été impossible de la vendre à moins de 2500 $. La française n'aurait alors pas été compétitive face à l'Opel Rekord vendue 1988 $ ou à l'Austin A55 Cambridge disponible contre 2199 $. Aucune option n'était disponible sur les 403, Peugeot préférant livrer des voitures complètes. Toutes les berlines 403 étaient dotées d'un toit ouvrant. La voiture plaisait aux Américains. A la fin de l'année 1959, il s'avéra que ce marché avait tout de même représenté 8,6 % de la production de Peugeot, ce qui avait permis d'accroître les volumes de production dans les mêmes proportions. Mais du côté de Sochaux, on préférait ne pas s'emballer, et on se méfiait d'un potentiel retournement de situation. La presse spécialisée accueillit favorablement ces voitures bien construites, confortables, sobres, et dont les lignes restaient suffisamment classiques pour plaire à des Américains qui aimaient par snobisme se distinguer de leurs voisins en achetant - si nécessaire à crédit - une voiture européenne neuve plutôt qu'une banale Ford ou une Chevrolet. Peugeot n'hésita pas dans ses publicités à qualifier la 403 comme étant l'une des sept meilleures voitures fabriquées dans le Monde, une affirmation qu'il attribuait au magazine Road & Track. Les autres constructeurs étaient Rolls-Royce, Mercedes, Lancia, Porsche, Lincoln Continental, Rover ! Excusez du peu.
One of the 7 best made cars in the world. Copyright Malgré une diffusion satisfaisante, vendre des 403 aux Etats-Unis n'était à coup sur pas un moyen efficace pour faire rentrer de l'argent rapidement dans les caisses de Peugeot. Le constructeur, réaliste dans son approche, ne s'attendait pas à une rentabilité immédiate. Il s'agissait surtout pour lui d'affirmer une présence. Il devait aussi être en mesure de consentir d'importantes remises à telle ou telle compagnie de taxis qui souhaitait s'équiper en Peugeot. De nombreuses ventes à particuliers étaient réalisées à l'aide d'un crédit. Les banques ne se montraient guère pressées de transférer au constructeur les sommes qui lui étaient dus. Enfin, la constitution de stocks de pièces était coûteuse. Encore fallait-il savoir vers quelles pièces la demande s'orienterait. Heureusement, la 403 était une voiture solide. Pour couvrir ses créances à l'exportation, Peugeot fut contraint d'emprunter de l'argent aux organismes financiers en 1958 et 1959.
Dans cette publicité presse, Peugeot démontre qu'aucune 403 n'est à vendre sur la marché de l'occasion, elle est si appréciée de ses propriétaires ... Copyright Au total, ce sont 6 867 berlines Peugeot 403 qui trouvèrent preneur en 1958, puis 15 787 l'année suivante. Si l'objectif de 8000 voitures fut effleuré la première année, il fut presque doublé en 1959. Les données sont inconnues pour 1960, mais les statistiques font état de 577 ventes de 403 en 1961, 1709 en 1962, 648 en 1963, 632 en 1964, 635 en 1965 et 665 en 1966. Les équipes de marketing de Peugeot commirent une bourde qui compliqua la fin de carrière de la voiture. Alors que la 404 arrivait aux Etats-Unis, la 403 était maintenue au catalogue. Pour vanter les 72 ans d'excellence des automobiles Peugeot, les publicitaires affirmèrent que si la Peugeot des années 40 était la 203, celle des années 50 la 403, le dernier témoignage (the latest expression) de cette qualité était désormais la 404. Dans ce cadre, tout acquéreur d'une 403 en 1961 passait pour un " has been ". Même si le constructeur précisait que l'une ne remplaçait pas l'autre, la coexistence de ces deux modèles, qui aux yeux des Américains appartenaient plus ou moins à la même catégorie, devenait difficile.
Feuillet publicitaire Peugeot 403, 1964. Copyright C'est ainsi que 1225 Peugeot 403 du millésime 1960 encore non vendues en 1961 furent rapatriées en France, et écoulées comme voitures d'occasion " zéro kilomètre, type exportation " dans le réseau Peugeot. Des cargos norvégiens, allemands et anglais déchargeaient à Dunkerque ces voitures. On peut s'interroger sur le coût de cette promenade : voyage de l'usine au port, embarquement et débarquement à deux reprises, retour à l'usine. Toutes les voitures étaient revues et remises si besoin en état sur le site Peugeot de Courbevoie. Le client n'avait pas la possibilité de choisir la couleur et encore moins de voir la voiture avant sa livraison. Il risquait de se faire livrer une voiture ayant souffert dans ce long voyage : chromes piqués par l'air marin, petits défauts de carrosserie ... autant de détails non garantis par la firme. Seule la mécanique était couverte comme pour une voiture neuve. Ironie de l'histoire, la Régie fut contrainte en vertu d'accords signés en 1957 de supporter 40 % des frais de rapatriement et de remise en état de ces véhicules.
Les 403 débarquent à Dunkerque après un séjour aux Etats-Unis, et deux traversées de l'Atlantique -Source AJ N° 282 du 5 octobre 1961. Copyright
Extraits de la brochure Peugeot Station Wagon, marché américain, 1959. Copyright
Publicité presse, Peugeot 403. Copyright
Publicité presse, Peugeot 403. Copyright Peugeot 404 La 404 était disponible aux Etats-Unis à partir de février 1961. A l'échelle du marché américain, elle demeurait une voiture compacte, avec son 4 cylindres de 1618 cm3 et 72 ch SAE. Peugeot étudia pour la 404 un V8 qui en aurait fait une voiture de haut de gamme. Mais le projet ne fut pas mené à son terme.
Les 403 et 404 menèrent une carrière parallèle aux Etats-Unis jusqu'en 1966 - Source : AJ numéro 289 du 11 janvier 1962. Copyright Telle que présentée, la 404 séduisit sans tarder les consommateurs américains. La structure de la voiture, étudiée pour recevoir le fameux V8, était largement dimensionnée. Il en résultait des coûts de garantie de 2/3 inférieurs à ceux de Renault. L'équipement était complet, avec un toit ouvrant, des pneus Michelin X, des flancs blancs ... mais parfois jugé insuffisant au regard de ce que proposaient les premières voitures japonaises diffusées aux Etats-Unis. Peugeot a trop longtemps négligé de proposer la 404 en boîte automatique, dans un pays où une large proportion des automobilistes ne savait pas utiliser une boîte manuelle. Cette situation malencontreuse fut corrigée tardivement en 1968 avec l'adoption d'une transmission de marque ZF. Peugeot ne proposait pas de climatisation même en option, pourtant si nécessaire sur les routes désertiques du Nevada ou de l'Arizona. En dehors de ces tares, la 404 bénéficiait d'une réputation de robustesse, sur laquelle la marque ne se privait pas de communiquer abondamment. Pour le millésime 1965, Peugeot, attiré par le succès rencontré par la VW Karmann Ghia ou la Fiat 124 Spider, décidait d'importer le cabriolet 404. Mais cette automobile de luxe était facturée en conséquent.
Dans cette publicité presse de 1962, Peugeot laisse entendre que la 404 propose une ligne aussi séduisante que celle de la Lancia (sans doute la Flaminia), mais pour un prix bien moindre. Copyright
Il y a 5174 raisons d'acheter une Peugeot. Copyright Les statistiques concernant la 404 font état de 2 652 ventes en 1961, 3 011 en 1962, 1 798 en 1963, 2 060 en 1964, 1 916 en 1965, 2 689 en 1966, 3 593 en 1967, 4 684 en 1968, 2 681 en 1969, 1 051 en 1970, 2 153 en 1971, 709 en 1972. Les données sont inconnues pour 1960 et 1973.
Extrait de la brochure Peugeot 404/403, marché américain, 1966. Copyright
Extrait de la brochure Peugeot 404, marché américain, 1969. Notez les rappels de feux latéraux. Copyright Peugeot 504 Un an après sa présentation en France en septembre 1968, la berline 504 foulait le sol américain. La version US se reconnaissait notamment à ses doubles optiques et à ses répétiteurs de feux latéraux. Peu performante, mais rassurante, la paisible berline sochalienne se vendit mieux que son aînée la 404. Il est vrai que dans les années 70, un plus vaste public était rodé aux importations européennes des marques BMW, Mercedes, Volkswagen, Volvo, Saab ... Alors pourquoi pas une Peugeot. La 504 qui disposait aussi d'une motorisation diesel intéressait une nouvelle clientèle soucieuse de ses deniers, en particulier après le premier choc pétrolier.
Peugeot 504/604, marché américain, 1979. Copyright La voiture était disponible en de nombreuses versions jusqu'en 1976 : deux niveaux de finition pour la berline (GL ou SL), deux carrosseries (berline et break), motorisation essence ou diesel, boîte mécanique ou automatique. La finition GL disparaissait en 1977, et seul le break demeurait disponible à partir de 1980, jusqu'à ce que le break 505 ne prenne le relais après le millésime 1983. La carrière de la 504 s'échelonna sur quinze ans, une performance aux Etats-Unis. Les statistiques de vente pour la 504 font état de 752 voitures en 1969, 4 738 en 1970, 3 158 en 1971, 3 884 en 1972, 2 690 en 1973, 7 948 en 1974, 11 850 en 1975, 9 497 en 1976. L'année 1975 marqua un sommet pour Peugeot. Plus jamais la marque sochalienne n'allait vendre autant de voitures en une seule année aux Etats-Unis.
Peugeot Diesel Wagon, marché américain, 1980. Copyright En 1980, Peugeot of America présentait la 505 qui allait progressivement prendre le relais de la 504.
Peugeot 504, marché américain. Copyright Peugeot 304 Ni la 204 ni la 104 ne furent importées aux Etats-Unis. Par contre quelques 304 berline et break franchirent l'Atlantique à partir de 1970, avec un succès mitigé, qui entraîna leur retrait du catalogue à l'issue du millésime 1972. Il s'en est vendu 1 407 exemplaires en 1970, 2 153 en 1971 et 709 en 1972.
Peugeot 304, marché américain. Copyright Peugeot 604 Dès sa conception, les ingénieurs de Peugeot envisagèrent d'exporter la 604 vers les Etats-Unis. Etudiée pour être une voiture six cylindres abordable, elle pouvait espérer séduire à la fois une clientèle haut de gamme en Europe, mais aussi le public américain à la recherche d'une automobile sortant de l'ordinaire. Sa commercialisation débuta en février 1977. Elle coûtait alors 10 900 $, à comparer aux 7 360 $ d'une 504.
Peugeot 604, marché américain, 1979. Copyright Une des principales modifications sur la 604 concernait les pare-chocs. Des absorbeurs de chocs furent intégrés dans le plancher du coffre. On retrouvait les inévitables répétiteurs de clignotants latéraux avant et arrière. La calandre était dotée de quatre phares rectangulaires identiques en taille. Disponible en versionq manuelle et automatique, la 604 était livrée de série avec la direction assistée, quatre vitres électriques et la climatisation. Sa bonne tenue de route, le confort de ses suspensions, la présence de freins à disques classaient la 604 au-dessus des meilleures compactes américaines. Par contre, elle demeurait une voiture un peu étriquée, du fait de l'utilisation du soubassement et de la structure de la 504. Au niveau de gamme qu'elle visait, elle apparaissait mal finie et insuffisamment motorisée. L'adaptation aux normes US nuisait à la pureté du dessin original. En juin 1979, les importations étaient provisoirement suspendues, faute de vente. Peugeot proposait à partir d'octobre d'importants rabais, jusqu'à 1000 $, pour écouler les stocks du millésime 1979 avant d'introduire les voitures de 1980. Début 1980, dans la foulée des accords signés avec Chrysler qui permettaient à Peugeot de bénéficier de l'immense réseau de ce dernier, la 604 revenait en force, mais cette fois dans une version turbodiesel, qui lui permettait d'afficher une puissance de 80 ch Din, et d'atteindre 160 km/h, le Nirvana ! Mais ces efforts furent vains. Après un changement de calandre en 1981, la voiture poursuivit sa timide carrière sur le sol américain jusqu'en 1984 dans l'ombre de la 505. La 604 eut des difficultés à s'exporter non seulement aux Etats-Unis, mais aussi à travers le monde. En 1983, les 306 voitures vendues sur le marché nord-américain représentaient 21,27 % des exportations de la 604 ! Heureusement, la voiture connut une plus honorable carrière dans l'Hexagone.
Peugeot 604 USA, avant et après le lifting de 1981. Copyright Peugeot 505 Dès le millésime 1980, la nouvelle berline sochalienne était disponible aux Etats-Unis en versions 2 litres essence ou 2,3 litres diesel, des mécaniques déjà éprouvées. L'injection était adaptée au moteur essence qui gagnait quelques chevaux au passage. La 505 remplaçait sans transition la vénérable 504 Sedan, et allait asseoir pour quelques années encore les positions acquises par son aînée. Par rapport à la 504, tant les lignes que l'aménagement intérieur avaient fait l'objet d'une profonde refonte.
Couverture du catalogue publicitaire Peugeot 505, 1985. Copyright Une série spéciale Silver Edition marqua les 25 ans de présence de Peugeot aux Etats-Unis en 1982. Elle disposait d'une peinture métallisée, d'un intérieur cuir, de jantes alliage et de pneus Michelin TRX. Le break dit Station Wagon était disponible à partir de 1984. Il prenait ainsi le relais de la 504 du même type. La 505 eut rapidement le vent en poupe. 12 390 Peugeot étaient vendues aux Etats-Unis en 1980, puis 16 725 en 1981 et jusqu'à 20 007 en 1984, essentiellement des 505, et quelques centaines de 604.
Couverture du dépliant publicitaire Peugeot 505, 1985. Copyright La Peugeot était bien visible durant les années 80 sur les artères de Los Angeles et de New York. Le constructeur français fut en effet sélectionné par ces deux municipalités suite à un appel d'offre pour équiper leurs flottes de taxis.
Un taxi 505 dans les rues de New York. Copyright De 1985 à 1988, au grand regret des dealers, la gamme Peugeot USA ne comprenait plus que la 505. Plusieurs d'entre eux estimaient qu'ils pourraient vendre des 104 ou des 305, à condition de les proposer en boîte automatique. Le cabriolet 504 aurait aussi très bien pu se vendre. Mais pour porter ces voitures, outre une mise aux normes contraignante, il aurait été nécessaire de mener des campagnes de publicité au ton jeune et dynamique, à l'image de ce faisaient les Japonais et ... Renault ! Non, Peugeot avançait pas à pas, sans bousculer qui que ce soit. Aucune participation en compétition automobile n'était au programme. Tout juste Peugeot sponsorisait-il de manière discrète le tennisman Gerulaïtis. Les ventes demeuraient tout à fait honorables en 1986 avec 14 296 voitures. Mais bientôt Peugeot allait de nouveau être à la peine. Les diesels étaient montrés du doigt en raison de la pollution qu'ils provoquaient. La 505 ne répondait plus aux plus récentes normes de sécurité. Même l'introduction du V6 PRV ne sauva pas la 505 d'une longue mais régulière dégringolade. Les prix des carburants qui se stabilisaient n'offraient plus le même attrait pour les moteurs fonctionnant au gas-oil. D'ailleurs, les dernières 505 exportées vers les USA étaient des voitures essence. La clientèle de la 505 était un peu à l'image de celle que l'on connaissait en France. Elle était fidèle, sérieuse, et un peu plus âgée que la moyenne. Elle disposait de revenus légèrement supérieurs à la moyenne. Mais à la fin des années 90, ce modèle était passé de mode. 9 422 Peugeot 505 furent vendues en 1987, puis 6 713 en 1988, 6 095 en 1989 et 4 092 en 1990. Mais Peugeot ne s'avouait pas vaincu pour autant. En réaction à la présentation de l'Eagle Medallion, version US de la Renault 21 qui fit par ailleurs un bide retentissant aux Etats-Unis, le constructeur de Sochaux présentait la 405 à partir de l'automne 1988. 405 et 505 allaient constituer les deux piliers de l'offre Peugeot de 1989 à 1992.
Peugeot 505 Turbo, version américaine. Copyright Peugeot envisagea la fabrication d'un coupé 505 à destination des Etats-Unis. La voiture devait être produite par une société du nom de Car and Concepts basée à Brighton dans le Michigan. Dès 1983, des négociations furent menées dans ce sens, afin d'en produire 4000 par an. Ce projet ne fut hélas pas mené à son terme.
Peugeot 505 Coupe, USA - photos Christian Schütt Peugeot 405 Avec la 405, il n'était plus question pour Peugeot de proposer aux Américains une fidèle servante telle que le furent les 504 et 505, mais plutôt une compacte sportive de classe, apte à lutter à armes égales contre les Audi, BMW et Mercedes. Les multiples normes américaines et les exigences de ce marché en matière d'équipements, notamment la présence obligatoire de la climatisation, avaient une fois de plus pour conséquence de faire perdre de la puissance au moteur, mais aussi du couple. Parallèlement, le poids de l'auto avec ses multiples équipements et les différents renforts augmentait de près de 140 kg par rapport à la version européenne. C'est le " gros " 1905 cm3 au sommet de la gamme en Europe qui fut affecté à la 405 américaine. Il était disponible en version 110 ou 150 ch. La 405 d'outre-Atlantique ressemblait à notre 405 Mi 16. En 1990, un break " Sport Wagon ", épaulait la berline.
Publicité Peugeot 405 USA. Copyright Peugeot fut incapable de mettre en avant les qualités de son modèle, malgré d'importants efforts, tant au niveau des équipements que des tarifs. Sa commercialisation qui avait débuté fin 1988 fut arrêtée courant 1991. Peugeot renonçait cette fois pour de bon au marché américain.
Renault Les années 50' Renault disposait dès 1906 d'une présence commerciale aux Etats-Unis par le biais de la Renault Selling Branch, avec des bureaux à New York et Chicago. A l'époque, il n'était pas encore question d'envahir ce large territoire avec des milliers d'automobiles. Non, l'ambition se limitait à vendre quelques exemplaires des Renault les plus luxueuses. La marque bénéficiait alors d'une certaine renommée mondiale, acquise grâce à plusieurs succès dans des courses d'endurance, y compris en Amérique du Nord. A l'issue de la seconde guerre, alors que Renault était transformé en Régie Renault, tout ce dispositif fut remis à plat. Après le conflit, les premières exportations à destination des Etats-Unis débutèrent en 1948, avec une 4 CV que les Français ne pouvaient même pas s'offrir, faute de disponibilité. Par l'intermédiaire d'un revendeur local, John Green, la 4 CV était vendue dans les Etats du Sud. Le contrat de l'importateur était basé sur 300 ventes par mois. La première année, John Green en écoula 960, pour grimper à 1 551 en 1950, avant de chuteur à 374 en 1952. Hélas, notre homme se contentait de diffuser la puce de Billancourt au fil de l'eau, sans véritable stratégie, et surtout sans avoir prévu une structure d'après- vente. Les pièces étaient introuvables et très chères.
Extrait d'un dépliant publicitaire de 1949 édité par l'importateur John L. Green installé à New York. Copyright Cette première tentative avortée aurait dû permettre de tirer quelques leçons. Elle avait bien démontré qu'en plus d'un réseau de vente, tout constructeur sérieux devait investir dans un stock de pièces détachées et dans des outillages adaptés. En effet, aux Etats-Unis, le moindre boulon à desserrer constituait un frein monumental à la réparation, le pas métrique y étant inconnu. Plus surprenant, la plupart des Américains ne savaient pas utiliser une boîte mécanique. Cette étrange gymnastique qui obligeait à appuyer du pied gauche sur une pédale tout en actionnant une tige au plancher leur était étrangère. A ce rythme, les embrayages de la 4 CV cassaient les uns après les autres. Au début des années 50, une structure dénommée " Renault of France " permit de mieux organiser la distribution, sous la houlette de Bob Lamaison, responsable des ventes à New York. Elle fut ensuite remplacée par " Renault Incorporated " à la fin de la décennie. Les incitations des pouvoirs publics français et l'arrivée de la Dauphine sur le marché US permirent aux ventes de Renault d'exploser à la fin des années 50.
La 4 CV, première Renault régulièrement diffusée aux Etats-Unis. Copyright Alors que la plupart des indicateurs étaient au vert au sein de la Régie, et que l'entreprise s'apprêtait à vivre son âge d'or, Pierre Lefaucheux se tuait au volant d'une Frégate en se rendant à Strasbourg le 11 février 1955, à seulement 56 ans. Sur le seul mois de mars 1959, Renault devenait le deuxième importateur sur le sol américain, avec 6 401 ventes, derrière Volkswagen avec 8 739 voitures, mais devant les 3 986 de Ford UK, 3 681 de Simca, 3 293 d'Opel, 3 050 de Fiat, 2 489 d'Hillman, 1 951 de Triumph et 1 731 de Vauxhall. En septembre 1959, la Régie prenait la première place, juste devant Volkswagen, avec 9 439 voitures vendues contre 8 654 pour son rival. Jamais plus une telle performance n'allait être réalisée. Renault complétait son offre avec la nouvelle Caravelle, appellation américaine de notre Floride. On projetait aussi d'importer le nouveau véhicule utilitaire léger de la Régie, la fameuse Estafette.
L'aventure commençe par un voyage aérien. Les voitures sont transportées du quai jusqu'au navire. Ces trois dauphines séparées par des cadres feront toute la traversée sans se quitter. A droite, le bâtiment est prêt à prendre la mer. On devine la présence de nombreuses 4 CV. Copyright Les années 60'/70' Mais Renault semblait avoir vu trop grand. Soudainement, les ventes s'effondrèrent. Le marché américain connaissait au début des années 60 un retournement de situation. La demande globale chutait, et Renault n'échappait pas au désastre. En 1960, la Dauphine était attaquée de toute part. La voiture rencontrait des problèmes de fiabilité. Le maigre réseau ne parvenait pas à assurer correctement l'après-vente. Les constructeurs américains proposaient désormais leurs propres modèles compacts. Les invendus s'accumulaient en concession et sur les ports. Renault suspendait toute idée de développement commercial avec de nouveaux produits. La confiance dans la marque était mise à mal, et cette situation touchait autant les clients que les distributeurs. Le turn-over de ces derniers prenait des proportions ingérables pour Renault. Le constructeur français dans cette tempête perdait complètement sa réputation auprès des banques capables de le soutenir dans ces moments difficiles. Pierre Dreyfus découvrait tardivement que près de 45 000 voitures, des Dauphine pour l'essentiel, rouillaient sur les parkings des docks car elles étaient soumises aux vents marins, quand elles n'étaient pas envahies par la végétation. Plusieurs voitures avaient plus de trois ans d'âge. Certaines même avaient été déshabillées pour servir de stock de pièces détachées. Pour pallier cette crise, plusieurs Dauphine complètes furent vendues sur place avec d'importants rabais, mais elles furent pour l'essentiel rapatriées en Europe. Les seules voitures " neuves " bradées avaient déjà fait chuter le prix des Dauphine d'occasion. Les distributeurs avaient de quoi être écoeuré, et préféraient abandonner le panonceau Renault pour filer à la concurrence. Les répercussions sociales dans les usines françaises furent énormes. Les horaires de travail furent ramenés de 48 à 45 heures par semaine. Plus de 3000 personnes furent licenciées, et les contrats saisonniers non renouvelés. Les pertes financières étaient lourdes pour la Régie. Il s'en fallut de peu pour que ce retournement de situation en Amérique ne mette la Régie entière en péril. Des mouvements de grève virent le jour ici et là. Le pouvoir politique en place s'interrogea sur l'opportunité de remplacer Pierre Dreyfus. Mais il n'était pas simple de limoger un haut fonctionnaire qui avait obtenu la Légion d'honneur deux ans plus tôt pour l'exemplarité de la Régie en matière d'exportation.Mais les hommes de Renault n'étaient pas disposés à abandonner la bataille aussi facilement.
Extrait d'une interview accordé par Pierre Dreyfus à
l'Auto Journal du 5 avril 1962 :
A partir de 1962, la nouvelle direction de Renault aux USA avait compris qu'un coup de barre était nécessaire. Les publicités étaient désormais mieux orientées pour atteindre leurs cibles. Pour rendre confiance au public, Renault offrait un contrôle général de leur voiture à tous les propriétaires de Dauphine. La Régie faisait preuve de sens pratique, il était temps. Dès lors, Renault Inc. se contenta de vivoter en distribuant quelques centaines d'exemplaires par an de la Caravelle, puis de Renault 8 et Renault 10. La Régie signait en 1961 un accord avec AMC. Celui-ci ne prévoyait pas pour l'instant de prise de participation ni d'une part ni de l'autre. Cette association allait durer jusqu'en 1967. L'intérêt pour Renault était double. Il permettait à la Régie d'une part de disposer du réseau de distribution AMC, et d'autre part de vendre en Europe à moindres frais la Rambler, petite voiture aux yeux des Américains, mais berline de luxe aux yeux des Européens. L'assemblage final de la Rambler était réalisé dans l'usine belge de Vilvorde. Cette expérience commerciale ne fut pas une réussite. Seulement 6 342 Rambler quittèrent l'usine belge entre septembre 1962 et juillet 1967.
Renault Rambler. Copyright Durant les années 60, l'offre Renault était ainsi constituée : 1960/61 : 4 CV, Dauphine et Caravelle ; 1962 : Dauphine, Caravelle et R 8 ; 1963 à 1966 : Dauphine et R 8 ; 1967 et 1968 : R 10 uniquement ; 1969 : R 10 et R 16. Renault vendait 91 073 voitures aux USA en 1959, puis 62 772 en 1960, 44 122 en 1961, 29 763 en 1962, 22 621 en 1963, 18 432 en 1964, 12 697 en 1965 et 12 106 en 1966. Les ventes repartaient à la hausse en 1967 avec 21 219 voitures, et se stabilisaient à 21 662 en 1968 et 20 419 en 1969. A la fin de la décennie, l'avenir s'assombrissait de nouveau. Le marché américain se refermait progressivement sur lui-même, en imposant des règles de sécurité et d'antipollution que les constructeurs européens avaient bien du mal à assimiler.
Gamme 1967 : Renault Dauphine, R10 et Caravelle. Copyright
Gamme 1974 : Renault 12, 15 et 16. Copyright Au cours des années 70, la filiale de Renault changeait de raison sociale et devenait Renault USA. Elle renouait avec AMC en signant un accord commercial le 31 mars 1978, avant de prendre une participation de 5 % dans son capital le 10 janvier 1979. Cette participation fut portée à 46,4 % en septembre 1980. AMC connaissait alors de sérieuses difficultés financières, et l'apport en capitaux de Renault lui permettait de passer sans trop de casse cette période difficile.
Gerald Myers, PDG d'AMC, et Bernard Hanon, PDG de Renault, le 10 janvier 1979. Copyright L'intérêt pour Renault était de bénéficier de nouveau de l'important réseau de distribution du plus grand des petits constructeurs américains. AMC devenait son distributeur exclusif. Implanter un réseau solide aux Etats-Unis aurait été une tâche coûteuse et de longue haleine. Renault disposait ainsi de 1100 concessionnaires AMC Renault, dont 200 étaient de la vieille garde, de ceux qui avaient connu l'épisode de la Dauphine. Dans l'autre sens, la Régie prenait en charge la diffusion de la gamme Jeep en Europe. La structure de la gamme Renault était la suivante durant les seventies : 1970 : R 10 et R 16 ; 1971 : R 10, R 12 et R 16 (arrivée de la R 12) ; 1972/73 : R 12, R 16 et R 15/R 17 (arrivée des coupés R 15/R 17) ; 1974/75 : R 12 et R 15/R 17 (disparition de la R 16) ; 1976 : R 5, R 12 et R 15 / R 17 (arrivée de la R 5) ; 1977 : R 5, R 12 et R 17 (disparition de la R 15) ; 1978/79 : R 5 et R 17 (disparition de la R 12). Les ventes s'établissaient à 23 373 unités en 1970, 18 601 en 1971, 14 465 en 1972, 9 284 en 1973, 8 756 en 1974, 5 780 en 1975, avant de rebondir à 6 819 en 1976, 13 198 en 1977, 15 739 en 1978 et 18 862 en 1979, grâce à l'effet Renault 5. A titre de comparaison, pour 1979, ces chiffres étaient de 507 816 Toyota, 472 252 Datsun, 252 291 Honda, 295 213 Volkswagen, 165 536 Mazda, 128 871 Subaru, 60 576 Fiat, 56 602 Volvo. A l'époque, Renault, tout comme Peugeot d'ailleurs, étaient considérés comme un constructeur de l'envergure de Saab en France par exemple, discret par sa présence, mais avec une offre différente. Ces chiffres étaient assez cruels pour les Français. Les Américains ne connaissaient la France qu'au travers de grandes sociétés qui avaient implanté des usines sur leur sol. Michelin par exemple faisait là-bas un malheur. Ou alors, il fallait que les produits commercialisés se démarquent en donnant une image chic ou originale, comme Perrier ou Yoplait par exemple. Les années 80' Renault vendait 25 365 Le Car en 1980, seul modèle de ce millésime. Durant cette décennie, deux autres Renault produites en France firent une petite carrière aux Etats-Unis : à partir du millésime 1981, la Renault 18 i était adjointe à la Le Car, puis ce fut au tour de la Fuego à partir de 1982. 31 077 voitures furent vendues en 1981, pour l'essentiel des Le Car. C'était la sixième année consécutive où les ventes progressaient doucement mais sûrement. Renault vendait 37 702 voitures en 1982, des Le Car, des 18 i et des Fuego. Désormais, AMC Renault allaient concentrer tous ses efforts sur la version US de la Renault 9, appelée ici Alliance, disponible à partir de 1983 et produite dans l'usine AMC de Kenosha. L'Alliance était déclinée en version deux volumes à partir de 1984, sous l'appellation Encore, qui correspondait à notre Renault 11. En dehors de l'Alliance et de l'Encore, il fut également importé 33 229 Renault en 1983 (Le Car, 18 i et Fuego), 12 243 en 1984 (18 i et Fuego), 7 205 en 1985 (18 i et Fuego) et 4 152 en 1986 (18 i). En 1983 et 1984, les ventes de Renault Alliance et Encore dépassaient toutes les prévisions. Durant ces deux années, il s'immatriculait plus de Renault que d'AMC et de Jeep réunit. Mais le groupe AMC Renault continuait de perdre de l'argent. Les maigres bénéfices réalisés en 1984 ne constituaient qu'un intermède entre deux plongeons. A partir de 1985, rien n'allait plus pour AMC Renault aux States. Le groupe n'écoulait plus que 118 000 Renault, soit un tiers de moins que l'année précédente. Le constructeur vendait de moins en moins de voitures sur un marché qui se portait pourtant de mieux en mieux. Les tarifs des carburants à la baisse incitaient de nouveau les Américains à rouler dans leurs mastodontes. Fait aggravant, les constructeurs japonais libérés de tout contingentement se ruèrent sur le créneau occupé par les Alliance et Encore, avec des produits très attrayants. Comme à la fin des années 50, les centaines de concessionnaires qui distribuaient les Renault commencèrent à s'inquiéter.
De 1982 à 1985, Fuego, Renault 18i, Alliance et Encore constituaient l'offre de Renault aux USA. Copyright En 1986, AMC Renault touchait le fond avec 70 000 immatriculations seulement. Par chance, l'entreprise fut sauvée du bouillon par le renouvellement de sa gamme Jeep. Cette marque avait vu ses ventes passer en Amérique du Nord de 66 000 voitures en 1982 à plus de 222 000 en 1986. Par contre, la diffusion de son modèle Eagle, complètement dépassé, était devenue totalement confidentielle. Ces évènements méritent tout de même d'être analysés avec un peu de recul. De 1978 à 1982 environ, Renault avait paré au plus urgent pour régler au pied levé les détails de son association avec AMC. Il s'agissait essentiellement de lancer les programmes Alliance et Encore pour bien marquer sa présence sur le terrain et conforter un réseau demandeur de nouveaux produits. Ce n'est qu'à partir de 1982 que la Régie commença à restructurer plus en profondeur AMC Renault pour un faire un constructeur automobile capable de construire et de vendre des produits dans le segment des " compactes " et des " intermédiaires ". Le constructeur français se tint à ce plan contre vents et marées, pour livrer dans les temps deux nouvelles berlines qui correspondaient à ces segments, la Medallion et la Premier. Avec une Alliance et une Encore en fin de vie, la survie de Renault aux Etats-Unis ne pouvait passer que par le succès de ces deux modèles prévus à l'horizon 1987. Ca passe ou ça casse aurait-on pu écrire. La Medallion était une R21 américanisée, la Premier une voiture ambitieuse de haut de gamme conçue exclusivement pour le marché US, et produite sur place. AMC Renault espérait vendre 200 000 voitures par an, réparties entre environ 160 000 Premier et 40 000 Medallion. Un coupé Premier était même à l'étude.
Eagle Premier, Medallion et Summit (d'origine Mitsubishi), extrait du catalogue Eagle 1989. Copyright Mais nous n'en sommes pas encore là. Début 1985, Bernard Hanon, PDG de Renault depuis 1981, était poussé à la démission. L'homme de la Régie le plus lié aux accords avec AMC sortait par la petite porte et était aussitôt remplacé par Georges Besse. Dès ses débuts, celui-ci fut très discret sur la politique de redressement financier qu'il envisageait pour AMC Renault. Le nouveau PDG rassura néanmoins les ouvriers américains en leur indiquant clairement qu'il n'était pas question de laisser tomber la prise de participation de Renault dans le capital d'AMC. La marque au losange se portait une nouvelle fois au secours du blessé alors qu'elle perdait elle-même la santé. Cession en vue Néanmoins, quelques mois plus tard, en 1986, dans le plus grand secret, Georges Besse amorçait des négociations avec Lee Iacocca, le PDG de Chrysler : la première fois en mars à New York, la seconde en juin à bord de le Release, la péniche salon de Renault installée à Boulogne Billancourt. Début novembre, Besse acceptait d'engager des discussions plus avancées, avant de tomber sous les balles d'Action Directe le 17 novembre 1986.
Lee Iacocca. Copyright Début février lors du Salon de Chicago, Raymond Levy, nouveau PDG de Renault depuis le 17 décembre 1986, rencontrait à son tour le PDG de Chrysler. Les deux parties ne parvenaient pas à s'accorder sur un prix. Lee Iacocca s'intéressait essentiellement à la marque Jeep, et ne portait que peu d'intérêt pour les produits AMC et Renault. Le nouveau Cherokee cartonnait, et permettait à Jeep de sortir de son image de constructeur de 4 x 4 pour les campagnes. Ce nouveau modèle était devenu le " must have " des yuppies, à forts revenus. Par ailleurs, beaucoup d'Américains souffraient de voir la Jeep, véhicule légendaire, aux mains d'une entreprise française. Et surtout, cette marque rapportait depuis toujours beaucoup d'argent à son propriétaire. Le 9 mars 1987 Raymond Lévy surprenait tous les acteurs de l'industrie automobile en décidant d'arrêter l'aventure américaine de Renault. Après d'ultimes négociations, une lettre d'intention précisait les contours de la cession de l'ensemble AMC Renault à Chrysler. La présence récente de Lévy au sein de Renault lui permettait d'arrêter ce choix sans trop d'états d'âme. Le coup fut rude à encaisser pour ceux qui chez AMC avait porté à bout de bras les récents projets Medallion et Premier. Maigre consolation, Chrysler s'engageait à poursuivre la commercialisation des Renault aux Etats-Unis. En 1987, la situation financière globale de Renault était catastrophique. Si l'entreprise n'avait pas bénéficié du statut spécial de Régie, elle aurait été en faillite depuis deux ans. Pour financer un plan de développement destiné à relancer la machine, Renault devait trouver de nouvelles ressources. L'une des dernières solutions était de vendre les bijoux de famille, et de renoncer à des engagements que l'on n'avait plus les moyens de tenir. En effet, il fallait déjà songer à une succession pour les Médallion et Premier dont la carrière débutait. Toute la question était de savoir si vendre à ce moment était un choix pertinent, alors que Renault AMC semblait entrevoir le bout du tunnel, avec des résultats au vert durant le dernier trimestre 1986, grâce notamment à de nouveaux modèles Jeep qui cartonnaient. L'arrivée des Medallion et Premier, et l'implantation d'une usine flambant neuve à Bramalea au Canada étaient aussi des signaux positifs. Mais c'était précisément selon Raymond Levy le meilleur moment pour conclure un accord acceptable, quand la mariée était encore belle. La marque AMC en elle-même n'avait plus grande valeur. En 1986, elle ne représentait plus que 7 735 ventes d'Eagle, un modèle à bout de souffle. Renault écoulait encore 82 431 voitures et Jeep 222 716 véhicules tout-terrain.
AMC Eagle, 1985. Copyright L'importation des Renault 21 baptisées Medallion étaient arrêtée à la mi-juillet 1987, pour cause de mévente aux Etats-Unis. Chrysler lançait une campagne de promotion avec un crédit gratuit pour écouler le stock de 6000 voitures invendues. La fabrication des Alliance et Encore était définitivement arrêtée le 5 août dans l'usine de Kenosha. Seule la Premier allait poursuivre une modeste carrière sous les marques Eagle et Dodge jusqu'en 1992. En fin d'année 1987, les marques AMC et Renault aux Etats-Unis étaient carrément enterrées. AMC Renault était transformé en Jeep Eagle, une division du groupe Chrysler. Le Renault Medallion devenait le temps de liquider les stocks une Eagle Medallion et l'AMC Premier devenait Eagle Premier. A partir de mars 1998, Chrysler reprenait à Renault la distribution des véhicules Jeep en Europe, avec l'espoir d'animer un réseau Chrysler qui manquait de produits capables de séduire une large clientèle. Parallèlement, Chrysler USA annonçait son intention de mettre un terme au projet de coupé Allure dessiné par Ital Design sur la base de la Premier. Renault 4 CV La 4 CV fut la première Renault régulièrement importée aux Etats-Unis. Son actualité outre-Atlantique fit l'objet de plusieurs articles dans la presse spécialisée française. Le bimensuel L'Auto Journal, qui avait son correspondant sur place, Bob Mitchel, était particulièrement disert. Dans son numéro 58 du 15 juillet 1952, dans un article intitulé " La 4 CV Renault vue par les Américains ", L' Auto Journal retranscrivait un essai de " l'un des essayeurs les plus connus aux Etats-Unis ", Mc Cahill, paru dans la revue américaine Mechanix Illustrated. Extraits :
Les 4 CV étaient décharges dans des conditions assez rocambolesques. Notez les phares démontés pour le transport. Copyright
Bob Mitchel évoquait " le paradis perdu de la 4 CV Renault " dans un article du numéro 66 du
15 novembre 1952.
A 4 CV in New York. Copyright
Dans le même numéro, Bob Mitchel reproduisait
l'interview d'un concessionnaire des faubourgs de New York :
Puis il rendait visite à un autre
représentant Renault à Los Angeles :
En 1954, la couverture d'un dépliant destiné au marché français mettait en scène une 4 CV vendue aux Etats-Unis. Ainsi, Renault pouvait il sur place tabler sur le prestige de la France aux Etats-Unis, et chez nous sur la fascination qu'exerçait les Etats-Unis sur les Français. Copyright
Dans l'Auto Journal n° 102 du 15 mai 1954, le correspondant de
New York, l'indéboulonnable Bob Mitchel, narrait la visite de Pierre Lefaucheux à ses homologues américains, dans un article intitulé " La 4 CV ne
sera plus un fantôme à vendre " :
La 4 CV sait jouer de ses charmes. Copyright
Dans le même article, on pouvait s'étonner du
changement de point de vue concernant la disponibilité des pièces, par rapport
au discours des distributeurs en novembre 1952 :
L'Auto Journal dans son numéro 103 du 1er juin 1954 reportait le courrier d'un lecteur New Yorkais :
Renault 4 CV, 1960. Copyright
L'Auto Journal dans son numéro 165 du 1er janvier
1957 présentait les nouvelles ambitions de Renault :
Le bimensuel poursuivait sur la même lancée dans son numéro 190 du 15 janvier 1958 :
Renault Dauphine Le 22 mai 1957, la Renault Dauphine était présentée officiellement aux Etats-Unis, en présence de Pierre Dreyfus, dans le show-room de la marque, sur Park Avenue, à New York. Renault avait très mal préparé l'arrivée massive de la Dauphine sur le nouveau continent avec les conséquences que nous avons déjà évoquées. En 1958, l'Etat de Pennsylvanie fit remarquer que les phares de l'auto n'étaient pas en conformité avec les lois américaines. Il imposa le montage d'optiques au diamètre plus important sur toutes les voitures en circulation dans l'état. Pour anticiper les réactions des autres états, la modification fut étendue en usine à tous les modèles destinés aux USA. Les pare-chocs n'étaient pas non plus conformes. On réalisa en toute hâte des " sur pare-chocs " tubulaires pour l'avant et l'arrière.
Les Dauphine pour les USA bénéficient d'accessoires spécifiques montés sur la chaîne de Flins. Copyright
Les Dauphines sont équipées de pneumatiques à flancs blancs très prisés au Etats-unis. Copyright
Les Dauphine devant les entrepôts de l'United States Line au Havre attendent l'embarquement. Copyright
Les Dauphine lors de leur débarquement aux Etats-Unis, en couverture d'un dépliant publicitaire. Copyright
Renault Dauphine for the USA. Copyright
Revers de la médaille, dans sa hâte à exporter, la Régie se montra parfois peu exigeante sur le choix des bateaux et sur la qualité de l'arrimage. Cette photo montre deux d'entre elles sur les quais de Rouen, après une brève rencontre avec leurs soeurs dans les cales d'un cargo. Source AJ N° 173 du 1er mai 1957. Copyright
John Green fut le premier à vendre des 4 CV aux Etats Unis. Copyright Au départ la Dauphine plaisait grâce à son prix serré et son image sympathique de petite française. Mais la clientèle commença à se plaindre d'un réseau peu structuré, pas assez étendu et insuffisamment professionnel. La fourniture de pièces de rechange, l'entretien et les réparations posaient des problèmes aux acheteurs de Dauphine, surtout en dehors des grands centres.
L'acheminement des Dauphine et des 4 CV vers les dealers. Copyright
La Dauphine, présentée à la manière des brochures américaines des années 50. Copyright Dès l'hiver 1957, des rapports alarmants arrivaient à Billancourt, faisant état de nombreuses et incompréhensibles pannes qui laissaient les Dauphine sur le bord de la route. Les problèmes électriques notamment inquiétaient les ingénieurs et les fournisseurs de la Régie. Après analyse, il s'avéra qu'en fait les Américains ne savaient pas démarrer la Dauphine. Pour mettre en route leur voiture, ils avaient tendance à écraser la pédale d'accélérateur. Cette manière d'opérer était catastrophique pour la petite française. Il était ainsi impossible de repartir, et en insistant, le conducteur vidait les batteries. Mais même en apprenant à démarrer correctement, les difficultés pouvaient persister au petit matin. La Dauphine ne supportait pas les grands froids. Les hivers américains sont plus rudes qu'en France. Mais ce n'est pas tout. A la tombée de la nuit, les véhicules utilisaient les feux de code et non pas les feux de position, et en raison de la vitesse limitée à 25 miles à l'heure en ville, les dynamos ne pouvaient pas fournir assez de courant. Ainsi, de nombreuses voitures tombaient carrément en panne en pleine obscurité. Avec le temps, la couleur de la carrosserie pâlissait. Renault fut contraint de revoir la proportion de laque dans ses peintures, pour se rapprocher des proportions utilisées par Volkswagen et Peugeot.
OK pour le coup de la panne en pleine obscurité avec Donna Lynn. Copyright Chez Renault, on commençait à percevoir le drame qui se préparait en coulisses. Les Français respectaient leurs mécaniques, tandis que les Américains, culturellement, les soumettaient plus brutalement à leurs exigences. La batterie, les freins, l'embrayage étaient mis à rude épreuve. Le réseau, créé à la hâte de bric et de broc n'avait bénéficié d'aucune formation. Et il ne fallait pas compter dans l'immédiat sur la disponibilité d'éventuels manuels de réparation en anglais. Les dealers étaient déjà affiliés à d'autres marques, et ne voyaient en la Dauphine qu'un modèle de plus à vendre. Le plus souvent, ils n'avaient ni la compétence, ni réellement l'envie de s'occuper de la petite Renault;
Carte postale d'Amérique. Copyright Les petits films publicitaires réalisés pour promouvoir la Dauphine furent mal conçus. Ceux-ci mettaient en avant la beauté des lignes, le chic français, et le prestige de Paris. Bref, la Dauphine apparaissait aux yeux du public comme une petite chose charmante et racée, mais bien délicate. Ce fut une erreur de tenter de vendre avec ce type d'argument un modèle populaire, produit à faible coût et vendu à petit prix. Volkswagen l'avait bien compris dès ses débuts en Amérique. Se moquant elle-même de l'esthétique discutable de son " hanneton ", la firme allemande mettait en avant des arguments de solidité, d'économie, de commodité. Les chiffres de vente sur le long terme donnèrent raison à Volkswagen. Tandis que pour Renault, les frais de publicité augmentaient dans de dangereuses proportions, alors que la courbe des ventes déclinait. Un homme soutenait cette percée de la Régie depuis 1956, Robert Lamaison, patron de " Renault Incorporated ". Sa disparition dans un accident d'avion en novembre 1957 fragilisa encore un peu plus les bases de l'édifice. Les directeurs qui allaient lui succéder n'avaient ni son envergure ni sa vision globale. Sur le marché de l'occasion, la Dauphine n'était même plus cotée, tant son image était entachée. Les revendeurs, épuisés eux aussi, préféraient pour nombre d'entre eux rendre les armes et ceci sans le moindre état d'âme, renvoyant les voitures et les stocks de pièces détachées aux frais de Renault USA.
Photosphop des années 50 ! Copyright Le bouche-à-oreille fit le reste. La Dauphine fut vide boudée. Les stocks s'entassaient dans les docks du port de New York. L'air marin attaquait les carrosseries qui commençaient à rouiller. Le stock en piteux état retraversera pour partie l'Atlantique pour être reconditionné dans l'usine Renault de Vilvorde en Belgique. Les voitures non rapatriées furent soit détruites, soit réparées sur place pour être revendues à bas prix. En France, le niveau de production de la Dauphine fut revu à la baisse. Nos usines crachaient jusqu'à 2175 voitures par jour, alors qu'il ne s'en vendait dans le monde entier que 1 645 en moyenne. La déconfiture aux Etats-Unis fut lourde de conséquences sur le plan social chez Renault en France et en Belgique. La Régie fut contrainte de se séparer de 3 030 salariés. Le climat social étaient tendu, des grèves se déclenchaient sur les différents sites. Renault allait sortir de cette crise épuisé, un genou à terre.
Cette publicité de 1967 démontre, que malgré tout, la Dauphine traversa les tempêtes. Copyright Renault Caravelle La Floride portait outre-Atlantique le nom de Caravelle. On imaginait mal en effet Renault vendre une Floride en ... Floride. Cette petite voiture d'allure sportive fut présentée aux Etats-Unis lors du Salon de New York en janvier 1959. La Régie avait fait les choses en grand. La voiture trônait sous un éclairage vert au milieu d'un bassin. Le public pouvait admirer le nouveau modèle sous divers plans, grâce à une passerelle serpentant tout autour de la pièce d'eau. Pour faire couleur locale, deux jeunes femmes portaient les costumes régionaux de l'Alsace et du Languedoc. Esthétiquement, la Caravelle se distinguait de sa soeur française par l'adoption d'épaisses bananes de pare-chocs, afin de répondre à la législation américaine. Selon la Régie, plusieurs milliers de commandes affluèrent à l'issue de cette présentation, mais cette euphorie allait s'avérer passagère. L'élégante Renault subissait rapidement le même sort que sa soeur la Dauphine.
Renault Caravelle, 1961. Copyright
Renault Caravelle, 1967, notez les grosses bananes de pare-chocs. Copyright Renault 8 Nous l'avons vu, Renault avait eu tout faux avec la Dauphine, alors que parallèlement Volkswagen avait démontré qu'en prenant soin de ses clients, en leur offrant un après- vente de qualité, un service de pièces détachées performant et un réseau de distribution stable, il était possible de réussir aux Etats-Unis. A la Régie, on souhaitait vivement que la Renault 8 puisse faire oublier l'échec de la Dauphine, qu'elle secondait à partir de 1962. Il s'agissait vraiment d'une nouvelle opportunité. Mais la R 8 était trop chère par rapport aux prestations offertes, et sa finition n'était pas en rapport avec son prix. Sa diffusion fut des plus confidentielles.
Renault 8, marché américain. Copyright Renault 10 La Renault 10, qui reprenait la cellule centrale et la mécanique de la R 8, débarquait sur le sol américain durant l'été 1966. Elle était disponible en boîte manuelle ou automatique. L'argumentation publicitaire était basique. Il s'agissait selon Renault " d'une compacte suscitant l'admiration partout où elle passait, qui présentait l'avantage du confort et du luxe d'une grande voiture et de l'économie d'une petite ".
Renault 10, marché américain. Copyright Pour répondre aux normes US en évolution permanente, la Renault 10 dut s'adapter. En 1968, elle recevait toute la panoplie nécessaire : butoirs de pare-chocs en caoutchouc, répétiteurs de clignotants sur les ailes, feux de recul à l'arrière, essuie-glace à deux vitesses, ceinture de sécurité trois points aux places avant et arrière, etc ... Les normes antipollution limitaient sa puissance à 48 ch. Le public ne se laissa pas séduire outre mesure. Pour quelques centaines de dollars de plus, il pouvait s'offrir une belle Ford ou une Chevrolet récente d'occasion.
Renault 10, marché américain. Copyright A la croisée des deux décennies, la Régie Renault conservait une présence très symbolique sur le sol américain. Elle adoptait un profil bas en s'appuyant sur un réseau de seulement 300 revendeurs. En 1970, les ventes de Renault 10 ne dépassèrent pas 2 249 unités. Elle s'effaçait avec discrétion derrière la Renault 16 disponible depuis 1969, puis derrière la Renault 12 commercialisée dès 1971. Cette année 1971 fut justement son dernier millésime outre-Atlantique, alors qu'elle fit de la résistance en France jusqu'en 1973.
Le kit Sierra sur Renault 10 était constitué d'en ensemble d'accessoires au design original, mais toujours fonctionnels, tout au moins aux dires du dépliant imprimé en janvier 1970. Copyright Renault 16 Malgré les échecs, à la fin des années 60, la fascination exercée par les Etats-Unis auprès des décideurs de la Régie ne faiblissait pas. Pourtant, entre 1959, meilleure année pour Renault sur le sol américain, et 1966, les ventes avaient été divisées par plus de 7,5 ! La Renault 10 avait toutefois permis à la marque de se relancer légèrement en 1967 et 1968.
Couverture de brochure publicitaire. Copyright La Renault 10 poursuivait sa carrière jusqu'en 1971, et se voyait adjoindre à partir de 1969 la Renault 16. Avec une offre plus large, Renault pouvait maintenir son niveau de vente annuel au-dessus de 20 000 unités en 1969 et 1971. La désignation R 16 ne fut pas toujours utilisée aux Etats-Unis, la voiture s'appelait aussi plus simplement Sedan Wagon, ce qui ne laissait planer aucun doute quant à ses ambitions et son positionnement. Les breaks étaient déjà très populaires aux Etats-Unis, contrairement à la France où la présence d'un hayon classait dans l'esprit d'un certain public ce modèle comme étant un utilitaire. La Renault 16 fut la première voiture française exportée aux Etats-Unis à s'équiper de quatre phares en remplacement des projecteurs d'origine. Le pare-chocs avant était surmonté d'une barre tubulaire dont on pouvait douter de sa capacité à faire face au moindre choc. Les catadioptres latéraux étaient évidemment de rigueur.
Renault 16, marché américain, 1970. Copyright
Renault 16, marché américain, 1971. Copyright On retiendra quelques particularités de l'aménagement intérieur : planche de bord redessinée, compteur gradué en miles et imposant accoudoir central entre les deux sièges avant. Les teintes étaient les mêmes que celles proposées dans l'Hexagone, mais avec un choix plus limité et des appellations plus locales : St Louis blue, Texas Sand, Hawaii green, Alaska White ... Seule la mécanique 4 cylindres 1565 cm3 de 62 ch était disponible.
Renault 16, marché américain. Copyright Globalement, la presse spécialisée se montra séduite par ce concept berline break. Certains journalistes écrivirent même que " les ingénieurs de Ford ou de Chevrolet auraient tout intérêt à prendre le volant de la voiture, afin de réveiller leurs neurones anesthésiés ". Son dernier millésime fut celui de 1973. Désormais, la Régie s'appuyait plus volontiers sur les Renault 12, 15 et 17 pour maintenir une présence, même discrète, aux Etats-Unis. Renault 12 Pierre Dreyfus, PDG de Renault, restait convaincu que la survie de Renault passait par l'exportation. Mais le marché américain demeurait difficile à conquérir. La Renault 12 disposait objectivement d'assez peu d'arguments face aux modèles populaires de Ford ou de Chevrolet, plus rassurants pour l'acheteur américains. Même les Japonais avaient réussi à s'installer de manière durable en étant très à l'écoute du marché, alors que Renault piétinait lamentablement. Au regard de la surface à couvrir, la faiblesse du réseau partagé avec Peugeot n'était pas non plus de nature à favoriser des volumes extraordinaires. Pour revenir à la Renault 12, celle-ci se vendit essentiellement en version break, en boîte automatique et avec la climatisation.
Extrait du dépliant de gamme 1974. Copyright La presse spécialisée ne fut pas tendre avec la Renault 12. Le magazine Road & Track déplorait son moteur bruyant, une direction lourde sans assistance et une climatisation peu performante. La Régie nous gratifia d'un très beau catalogue publicitaire, spécifique au marché américain. Les photos ci-dessous sont issues de ce document.
Renault 12 après le restyling de l'automne 1975, marché américain. Copyright Renault 15 et 17 Les Renault 15 et 17 furent présentées sur le continent nord-américain lors du Salon de Montréal en mai 1972. Le 1565 cm3 de la Renault 15 développait 68 ch SAE, tandis que sur la R 17, l'injection permettait d'obtenir 104 ch Din. Les deux voitures étaient équipées d'une calandre à quatre phares (seulement deux en Europe sur la R 15). Les pare-chocs étaient identiques à ceux installés chez nous. On retrouvait les habituels répétiteurs de feux latéraux. Pour ce qui est de l'habitacle, les visières des compteurs furent jugées trop agressives par les fonctionnaires américains chargés de l'homologation. Renault les remplaça par une simple casquette en matériaux souples. La climatisation, les vitres teintées, les pneus à flancs blancs, la boîte automatique (sur la R 15) faisaient partie du programme des options. La presse spécialisée louait le confort typiquement français de la Renault 15 et sa tenue de route, mais regrettait le manque de place à l'arrière. Le moteur de la Renault 17 était apprécié pour sa vivacité, même si la voiture était jugée bruyante. Il fallait débourser 3095 $ pour la Renault 15, et 4075 $ pour la Renault 17.
Les Renault 15 et 17 pour le millésime 1972. Copyright Pour le millésime 1974, Renault fut contraint de se soumettre à de nouvelles normes de sécurité. Des pare-chocs particulièrement laids furent montés à l'avant et à l'arrière. Les portes bénéficiaient de nouveaux renforts (invisibles évidemment) afin de limiter les dégâts en cas de choc latéral. A l'avant, l'entourage de calandre qui ne jouait plus son rôle initial de protection contre les chocs était peint de la même couleur que la carrosserie. L'aménagement intérieur fit aussi l'objet d'une multitude de modifications. La R 17 devenait disponible en version à carburateur, tandis que la version à injection adoptait la désignation Gordini. L'utilisation du nom du sorcier français de la mécanique répondait à un besoin strictement marketing, et ne signifiait en rien que le moteur avait fait l'objet d'une quelconque optimisation de ses performances.
Les Renault 15 et 17 pour le millésime 1974, avec les nouveaux pare-chocs. Copyright Pour 1976, Renault 15 et 17 héritaient du même lifting qu'en Europe, à l'exception de la partie frontale qui demeurait identique aux anciennes versions. Au regard des volumes de ventes, il eut été trop coûteux de développer une nouvelle face avant qui puisse répondre aux normes américaines. La 17 restait disponible uniquement dans sa version Gordini, dotée d'un toit découvrable. Les Américains découvraient les charmes des sièges " pétale ". La Renault 15 disparaissait à l'issue du millésime 1976, tandis que la Renault 17 résistait jusqu'en 1979.
Une fin de carrière pathétique pour la Renault 17 américaine. Copyright
Un dealer de Fiat et de Renault à San Francisco. Copyright Renault 5 / Le Car En octobre 1975, Renault présentait à la presse la version américaine de la Renault 5. Le succès éphémère de la Dauphine datait d'il y a quinze ans. Depuis, le constructeur français avait vivoté avec les Renault 10, Renault 16, Renault 12, Renault 15 et 17. Quand la Renault 5 arrivait sur le territoire américain, on y recensait environ 120 000 Renault en circulation alors que Volkswagen affichait près de 4 millions de voitures. Cette petite voiture moderne allait-elle être la bouée de sauvetage tant attendue ? C'est du moins ce que l'on espérait à la Régie, tant cette citadine économique arrivait au bon moment, quand la crise du pétrole bouleversait toutes les données économiques. Les grosses américaines n'étaient plus en odeur de sainteté. Le public américain se jetait sur la nouvelle Rabbit, nom de baptême de la Golf aux Etats-Unis, et sur les nombreuses " imports " japonaises.
Volkswagen Rabbit, version USA, 1979. Copyright A la Régie, on hésita pour attribuer un prénom à la Renault 5. " Liberty " fut évoqué en hommage au bicentenaire de l'indépendance de l'Amérique, puis " Frog " pour grenouille, éliminé car trop connoté frenchy. C'est en effet le surnom que les Anglo-saxons nous attribuent, en raison de notre appétit pour les cuisses de grenouilles. On décida de l'appeler simplement Renault 5 (Five en anglais). La presse US lui réserva un accueil plutôt favorable. Elle appréciait sa petite mécanique de 1289 cm3 et 58 ch, idéale pour les zones urbaines. Extérieurement, la 5 se pliait aux exigences américaines, et les modifications étaient nombreuses : optiques circulaires, calandre spécifique, pare-chocs renforcés, répétiteurs de feux, nouvel emplacement pour la plaque de police ... La voiture s'en trouvait substantiellement relookée, et perdait évidemment une part du charme du dessin original. Les premières Renault 5 américaines furent livrées en février 1976. Elles étaient produites en France à Flins. Cette année-là, Renault vendit 6 819 voitures aux Etats-Unis, essentiellement des Renault 5, mais aussi quelques 12, 15 et 17 encore au catalogue. On ne peut pas dire que le succès commercial fut franchement au rendez-vous. Le client de la Renault 5 était assez souvent une femme qui disposait de revenus légèrement supérieurs à la moyenne. Il s'agissait presque toujours du deuxième véhicule. Renault gratifia le public américain d'un charmant catalogue pour le millésime 1976. La petite française y était présentée dans de multiples scènes de la vie quotidienne. Extraits :
Extraits du catalogue Renault 5, marché américain, 1976. Copyright Pour tenter de remédier à un démarrage commercial jugé trop lent, les stratèges en marketing de Renault planchèrent sur une nouvelle appellation. Ainsi, la Renault 5 allait devenir la " Le Car by Renault " dès 1977. Parée de couleurs vives, d'enjoliveurs ton caisse et de bandes assorties, elle se voulait plus " jeune ". De nouveaux pare-chocs noirs teintés dans la masse remplaçaient les gris qui se salissaient très vite. La " Le Car " fut engagée dans différentes courses avec un certain succès, remportant plusieurs places sur le podium dans le championnat SCCA (Sport Car Club of America). L'effet sur sa notoriété fut immédiat, et les ventes de Renault bondirent à 13 198 voitures en 1977, incluant encore quelques Renault 15 et 17.
La Le Car est une voiture de sport, et devance même sur cette publicité une VW Rabbit ! Copyright
La police de LaConner dans l'état de Washington s'équipa de trois Le Car, une voiture plus en phase avec son budget que les automobiles " standard size " américaines. Copyright L'accord commercial signé en mars 1978 avec AMC prévoyait la diffusion de la Renault Le Car à travers le réseau AMC à partir du deuxième trimestre 1978. Cette même année, une boîte automatique était proposée en option, ce qui constituait un plus incontestable sur un marché où la clientèle a toujours répugné à manier un levier de vitesses. La progression des ventes était constante depuis 1976, avec 15 739 unités en 1978, dont 14 400 Le Car. Les nouvelles générations n'avaient jamais entendu parler des péripéties de la Dauphine. Le nom de Renault était inconnu aux Etats-Unis pour le grand public. Renault F1 Team n'en était qu'à ses débuts. Une victoire d'une F1 Renault aux States relevait encore d'une hypothèse hautement improbable. La Le Car poursuivait son bonhomme de chemin, et signait en 1979 sa meilleure année. Durant ce millésime, Renault vendit 18 862 voitures, quasi exclusivement des Le Car, même si la R 17 était présente pour sa dernière année au catalogue. En 1980, la Le Car échangeait ses optiques circulaires pour des phares rectangulaires comme en Europe, mais ils étaient ici montés en retrait dans un cadre chromé. Le 1289 cm3 était remplacé par le 1397 cm3 de la Renault 5 Alpine, sérieusement dégonflé puisqu'il ne disposait plus que de 51 ch. Renault était dans l'obligation de se soumettre à de nouvelles normes antipollution de plus en plus draconiennes. L'embellie des ventes se confirmait pour 1980, avec 25 647 voitures, uniquement des Renault Le Car, seul modèle diffusé durant ce millésime.
La Renault Le Car avec ses nouveaux optiques avant, à partir de 1980. Copyright L'importation de la Renault Le Car était arrêtée en 1983 aux Etats-Unis, mais poursuivie un temps au Canada.
Chez un distributeur exclusif AMC Renault en 1981 - Source : l'Automobile N° 415 Renault 18 De l'autre côté de l'Atlantique, la Renault 18 était proposée dès 1981 avec le 4 cylindres 1647 cm3 (celui des TS et GTS en France) doté d'une injection Bosh. Le client pouvait choisir une boîte manuelle ou automatique. On distinguait la 18 i du modèle français notamment grâce ses énormes pare-chocs, ses répétiteurs latéraux et ses feux avant montés en retrait. Avec la 18 i, Renault tentait de concurrencer les Honda et les petites BMW.
Renault 18 i, marché américain. Copyright A 7845 $ contre 7135 $, La Renault 18 i était un peu plus chère que la Volkswagen Rabbit, les japonaises étaient moins onéreuses encore. Pour tenter de compenser cette faiblesse, Renault USA mettait l'accent sur le haut niveau de technologie de ses véhicules. Et pour en administrer la preuve, le constructeur engageait sa petite Le Car dans diverses compétitions.
Renault 18 i, marché américain. Copyright Le client type de la Renault 18 i était un homme généralement intéressé plus ou moins par la technique. Il s'agissait de plus souvent de la première voiture du ménage. Si une voiture américaine s'achetait sur catalogue en fixant la liste des options souhaitées, une Renault faisait en général l'objet d'un essai préalable. Les dealers reprenaient contre la Renault 18 i des Mustang, des Rabbit et pas mal de japonaises. Dernière Renault importée (les Alliance et Encore étaient produites sur place), elle fut commercialisée jusqu'en 1986.
Renault 18 i, marché américain. Copyright Concernant l'éventuelle importation aux Etats-Unis des hauts de gamme Renault, au début des années 80, Pierre André Gazarian, alors Vice-président de Renault USA, précisait : " Vendre une voiture française à un fermier du Nebraska équivaut à lui proposer du parfum made in Germany ". Il n'était pas question de proposer les R 20 et R 30 sur le marché américain. La cinquième porte acceptée sur les petits modèles ne l'aurait jamais été sur une plus grosse voiture. Voir aussi : http://boitierrouge.com Renault Alpine GTA Une version dérivée de la V6 Turbo fut conçue et finalisée pour répondre aux normes américaines. Elle se distinguait par ses feux avant escamotables, ses pare-chocs plus imposants, ses feux latéraux, une nouvelle grille d'aération sous la face avant et un troisième feu stop à l'arrière. Le pauvre V6 PRV limité par les normes antipollution n'offrait que 180 ch. Cette puissance moindre conjuguée à un excédent de poids d'environ 200 kg ne faisait pas de l'Alpine GTA américaine un foudre de guerre. L'ambition était d'écouler 2500 GTA par an aux Etats-Unis. Mais début 1987, le retrait de Renault du marché US mettait un coup d'arrêt à ce projet. 21 exemplaires furent produits. Aucun ne fut vendu aux Etats-Unis. 12 auraient été écoulés à quelques amateurs triés sur le volet, uniquement en Europe. Les autres furent soit conservés par le constructeur de Dieppe, soit utilisés en tant que mulet pour mettre au point l'A 610.
Alpine GTA US. Copyright Renault Alliance et Encore En juin 1982 (millésime 1983), Renault lançait l'Alliance en Amérique du Nord. C'était une Renault 9 adaptée aux goûts américains : couleurs et chromes clinquants, doubles phares, pare-chocs plus robustes ton caisse, finition très soignée et nouveaux coloris. Le style intérieur avait été revu par les équipes de Richard Teague, patron du style d'AMC. L'Alliance n'avait plus grand-chose à voir avec notre " macadam star ", bien que l'étude des deux versions fût menée parallèlement.
Renault Alliance et Renault 9, une même base, mais deux aspects bien différents. Copyright Son nom évocateur symbolisait la deuxième tentative de la Régie de s'implanter sur le marché américain avec force, après l'amateurisme qui avait présidé à la fin des années 50. L'Alliance était fabriquée en versions deux et quatre portes dans l'usine de Kenosha, et diffusée à travers le réseau American Motors, au côté des AMC Spirit, Concord, Eagle et Jeep. L'ensemble motopropulseur et la boîte de vitesses provenaient de France. L'alliance fut nommée " Car of the year 1983 " par le magazine Motor Trend, après que la Renault 9 ait remporté en 1982 le titre envié de " Voiture de l'année " en Europe.
Les jours heureux de la Régie aux USA. Copyright Aux Etats-Unis, le succès fut immédiat, et l'objectif initial de 100 000 ventes annuelles était atteint avec trois mois d'avance. Le marché américain subissait de nouveau au début des années 80 une profonde mutation. Le glissement vers le bas de gamme plaçait les constructeurs européens et japonais en bonne position. AMC qui était déficitaire lors de l'arrivée de Renault redevenait bénéficiaire lors du dernier trimestre 1983, et confirmait cette position à l'issue du premier trimestre 1984.
Renault Alliance et Encore, les deux modèles d'un renouveau provisoire pour la Régie aux Etats-Unis. Copyright De 1983 à 1987, l'Alliance fut produite à 623 573 exemplaires, dont 142 205 en 1983, 121 015 en 1984, 91 664 en 1985, 67 110 en 1986 et 36 336 en 1987, soit 31 % du total la première année, puis successivement 26 %, 20%, 15 % et 8 %. L'Alliance était disponible en version cabriolet à partir du millésime 1985. Elle rencontra un succès d'estime avec 10 600 exemplaires fabriqués environ, dont 7 300 la première année.
Le cabriolet Alliance disponible en 10 600 exemplaires à partir de 1985. Copyright En septembre 1983, l'Encore complétait l'offre d'AMC Renault. Il s'agissait d'une adaptation américaine de la Renault 11. De 1984 à 1987, elle fut produite à 165 243 exemplaires, dont 87 609 en 1984, 58 525 en 1985 et 19 109 en 1986, soit 53 % du total la première année, puis successivement 35 % et 12 %. Au total, l'Alliance a représenté 73,5 % de la production de ces deux modèles, et par voie de conséquence l'Encore 26,5 %. Deux motorisations figuraient au programme pour ces deux voitures : 1397 cm3 de 61 ch et 1721 cm3 de 78 ch à partir de 1986. L'Alliance GTA disponible pour le millésime 1987 bénéficiait d'un moteur deux litres de 96 ch. Elle présentait un aspect spécifique, rappelant la Renault 11 modifiée par Zender proposée en Europe. Disponible en berline deux portes et en cabriolet, la GTA fut assemblée à environ 3500 exemplaires.
La version GTA de l'Alliance présentée au Salon de Chicago en 1987. Copyright Les compactes étaient encore bien aimées du public américain qui se remettait doucement du second choc pétrolier de 1979. Cette embellie fut hélas de courte durée. L'année 1984 marquait le début de la fin de l'hégémonie des berlines économiques. L'acheteur américain renouait pour son plus grand plaisir avec les grandes berlines. Or, à ce niveau de gamme, AMC et Renault n'avaient rien à proposer. En mai 1985, AMC Renault annonçait la fermeture de ses usines produisant l'Alliance et l'Encore si les syndicats n'acceptaient pas l'ouverture de négociations permettant aux unités de fabrication de redevenir compétitives face à celles des concurrents. En effet, les ouvriers travaillant sur ces deux modèles bénéficiaient d'un nombre élevé de délégués et des temps libres plus importants que dans les usines des autres constructeurs. De toute part, AMC Renault rognait sur ses coûts. Il était nécessaire de réduire tant que possible les pertes en attendant des jours meilleurs. Le retournement de marché était intervenu plus vite que prévu. Alors que c'est la demande de véhicules compacts qui avait permis la mise sur rails de la nouvelle Alliance, c'est ce même choix de véhicule qui allait piéger Renault quelques années plus tard. En parallèle de cette chute vertigineuse des ventes, il commençait à circuler un courant de critiques visant la fiabilité des Alliance et Encore. Une enquête menée en 1986 par le magazine Consumer Reports classait ces deux modèles en bien mauvaise posture, contribuant ainsi encore un peu plus à la chute des ventes. Renault, pour alimenter les chaînes de l'usine de Kenosha, signait un accord avec Chrysler, qui prévoyait la fabrication de modèles du troisième constructeur américain dans son usine. La décision de Raymond Lévy, nommé PDG de Renault, de céder à Chrysler ses parts dans AMC marquait la conclusion d'une longue aventure, celle de Renault aux Etats-Unis. Chrysler arrêtait la production des Alliance et Encore le 5 août 1987, même si un modèle 1988 avait été prévu. Voir aussi : http://boitierrouge.com Renault Fuego La Fuego fut commercialisée aux Etats-Unis à partir du millésime 1982. Son adaptation aux exigences réglementaires se traduisit par l'adoption de pare-chocs plus imposants capables de résister à des chocs jusqu'à 8 km/h, par l'apposition de catadioptres sur les ailes et par le montage d'un pot catalytique gourmand en chevaux-vapeur.
Renaut Fuego, marché américain. Copyright La décoration, les jantes et les teintes de carrosserie étaient propres au marché américain. La planche de bord était identique à la version européenne, à l'exception des coloris, eux aussi très américains. La climatisation était livrée de série. Contrairement à l'Alliance et à l'Encore produites aux Etats-Unis, la Fuego américaine était assemblée sur les chaînes françaises de Maubeuge.
Ce prototype unique basé sur une Fuego américaine fut réalisé par Heuliez en 1982 à la demande de Renault, pour en savoir plus. Copyright AMC et Renault ne furent pas avares en efforts pour promouvoir la Fuego. Ce coupé assura notamment le rôle de pace-car lors du GP de Formule 1 de Détroit le 5 juin 1983. Elle fut par ailleurs engagée en version Turbo dans des courses du championnat local SCCA.
Publicité presse, Renaut Fuego, marché américain, 1982. Copyright Comme à l'époque de la Dauphine, le réseau eut fort à faire en après-vente avec la Fuego, qui avait tendance à lâcher de partout : turbo fragile, système électrique ... même la carrosserie supportait mal l'abondance de sel déposé sur les routes d'Amérique du Nord durant l'hiver. De ce fait, l'expérience fut de courte durée, et stoppée en fin d'année 1985. De 1982 à 1985, 19 352 Fuego furent vendues aux Etats-Unis et au Canada, soit environ 10 % des Fuego produites.
Renaut Fuego, marché américain. Copyright Renault Medallion Il fallut attendre le Salon de Chicago en février 1987 pour que se concrétise la nouvelle offensive de Renault. Le constructeur français y présentait la Medallion et la Premier. Cette dernière était un modèle spécifiquement américain dérivée de la Renault 25, tandis que la Medallion était une Renault 21 modifiée pour s'adapter aux normes américaines. Elle était fabriquée à Maubeuge en France. Lors de l'établissement du cahier des charges de la Medallion, l'accent avait été tout particulièrement porté sur la qualité et la fiabilité, là où Renault avait échoué une nouvelle fois avec les R 18 et Fuego importées. La face avant de la Medallion avait été complètement redessinée. Au cours du premier semestre 1987, une version " wagon " venait soutenir la berline.
Renault Medallion. Copyright Le début de carrière de la Medallion fut difficile. Destinée à affronter les Honda Accord, Mazda 626 et autres Ford Tempo pour le compte d'AMC, elle se trouva prise dans la tourmente qui suivit l'annonce du retrait de la Régie des Etats-Unis. L'usine de Maubeuge arrêtait sa fabrication au cours de l'été 1987. Les ultimes voitures encore en stock furent commercialisées au titre du millésime 1988 sous la marque Eagle, par un réseau Chrysler qui ne manifestait aucun enthousiasme pour vendre un pur produit Renault. Renault Premier Tout comme la Medallion, la Premier fut présentée en grande pompe au Salon de Chicago en février 1987, en présence de Raymond Levy, PDG de Renault. La décision d'étudier cette berline spécifique au marché US fut prise face à l'impossibilité d'américaniser la Renault 25. Le style de ce haut de gamme français ne pouvait en effet pas répondre aux goûts de la clientèle américaine, en particulier en raison de sa forme bicorps à hayon, qui aurait parue incongrue aux Etats-Unis. L'AMC Renault Premier, équipée du V6 PRV, résultait d'un travail de collaboration entre les équipes américaines et françaises du groupe, et d'Ital Design qui fut sollicité pour le style.
Eagle Premier. Copyright
Raymond Levy lors de la présentation de la Renault Premier au Salon de Chicago en 1987 - Source : AJ N° 4 du 1er mars 1987. Copyright Contrairement à la Medallion, la Premier était fabriquée par AMC, dans la très moderne usine de Bramelea au Canada édifiée pour la circonstance, fruit de lourds investissements, et capable d'assembler jusqu'à 150 000 voitures par an. La Premier s'insérait dans la catégorie américaine des " intermediates " , qui couvrait environ un quart du marché US. Cette six places de 4,90 mètres affrontait des modèles bien connus comme la Ford Taurus ou l'Oldsmobile Cutlass.
Ford Taurus et Oldsmobile Cutlass, modernisme pour Ford, classicisme pour Oldsmobile. Copyright Mais il a suffi de quelques lignes de télex, le 9 mars 1987, pour que le rêve soit terni. Conformément aux accords signés avec Chrysler, celui-ci reprenait à son compte la production de la Premier. Le projet d'un coupé baptisé Allure également dessiné par Ital Design, et susceptible de concurrencer la Ford Thunderbird, était abandonné quelques semaines plus tard, au grand dam de Billancourt.
Renault Allure par Ital Design. Copyright La Premier, tout comme la Medallion, fut intégrée dès le millésime 1988 sous la marque Eagle, créée de toutes pièces par Chrysler. Seulement 200 Premier avaient reçu le logo Renault en 1987. Mais le public américain ne se passionna jamais pour cette auto, quelle que soit la marque qui la commercialise. Les ventes se stabilisaient à 45 346 unités en 1988 et 41 349 en 1989, quatre fois moins que les objectifs initiaux. A partir de 1990, la voiture était produite conjointement par Eagle et Dodge. La marque sportive et jeune du groupe Chrysler la para de quelques attributs sportifs, et la baptisa Monaco, un nom déjà utilisé par ce constructeur entre 1965 et 1978. De 1990 à 1992, il fut produit respectivement 14 243, 11 634 et 4 730 Eagle Premier, puis 7 153, 12 436 et 1 960 Dodge Monaco. Avec la Monaco, Dodge remplaçait à moindres frais un modèle vieillissant, l'aussi peu séduisante Lancer présentée en 1985. Mais la Monaco permettait aussi et surtout à Chrysler de conserver un volume d'activité honorable dans son usine ultra-moderne de Bramelea, dramatiquement sous-utilisée. Les stocks de Premier et de Monaco s'accumulaient, jusqu'à représenter 292 jours de vente. L'usine de Bramalea fut temporairement mise en chômage technique. L'Eagle et la Monaco firent de la résistance jusqu'en 1992, avant d'être remplacées par un nouveau modèle issu du programme LH qui n'avait plus rien à voir avec Renault. Ainsi s'achevaient plus de 40 années de présence de Renault aux Etats-Unis ...
Simca Simca 5, Simca 6, Simca 8 Le constructeur de Nanterre, devenu celui de Poissy après le rachat de la filiale française de Ford en 1954, a longtemps vécu sous le signe des alliances industrielles avec l'étranger : Fiat à ses débuts, Ford en 1954, et enfin Chrysler à partir de 1958. C'est avec ce dernier partenaire que Simca allait tenter l'aventure américaine, en s'appuyant sur le puissant réseau de distribution du troisième constructeur américain. Simca n'avait pas attendu l'alliance avec Chrysler pour mettre pied aux Etats-Unis. Dès 1948, il y exportait au compte-gouttes sa Simca 5, en visant les familles à la recherche d'une seconde voiture. Certaines sources font état de 331 voitures vendues cette année-là. L'année suivante, la Simca 5 conçue avant-guerre était remplacée par la Simca 6. Celle-ci coûtait alors 1040 $, une valeur très proche des 1035 $ demandés pour une 4 CV Renault. Mais seulement 45 Simca trouvèrent preneur en 1949. Ce nombre incluait quelques rares Simca 8. Pour se distinguer de la masse, Simca décidait de viser le marché plus restreint des voitures de luxe. La Simca Sport dessinée par Pinin Farina arrivait au bon moment. Présentée au Salon de Paris en octobre 1948, elle ne fut disponible à la vente qu'un an plus tard. La clientèle de la côte Est des Etats-Unis était très friande de ce type de joli roadster. Un journaliste du magazine Motor Trend n'hésita pas à la comparer à ce qu'aurait pu être une " petite Bugatti ", une bien flatteuse comparaison. Annoncée à 2495 $ en 1949, son prix bondissait de près de 1000 $ l'année suivante. Chez Simca, on savait que le luxe n'a pas de prix, et on entendait bien en profiter. Le roadster fut rapidement épaulé par un coupé vendu au même prix. L'image de chic parisien permettait de séduire une clientèle un peu snob, éprise de parfums et de vins français. Malgré leurs atouts, la présence des Simca demeurait extrêmement marginale sur le sol américain, avec 50 ventes en 1951, 46 en 1952, 27 en 1953. Simca s'appuyait sur des importateurs indépendants. International Motor Inc. installé à Los Angeles se montrait très actif sur la côte Ouest. A l'Est, Simca était représenté à partir de New York par la société dirigée par Max Hoffman, importateur par ailleurs des marques Aston Martin, Austin Healey, Jupiter, Alfa Romeo, Fiat, Mercedes, BMW, Porsche et VW. A la fin de la décennie, ceux-ci furent remplacés par Witkin-Wolf Co. à Los Angeles, et par Paris-Auto Inc. à New York. Simca Aronde et Vedette L'Aronde était exportée à dose homéopathique à partir de 1952, mais pour le même prix de 1995 $, l'acheteur d'une voiture européenne pouvait s'offrir une Opel Olympia plus valorisante. Une Hillmann Minx, un modèle équivalent à l'Aronde, ne coûtait que 1645 $. Ce n'est qu'à partir du milieu des années 50 que Simca gagna du terrain, grâce à une Aronde qui savait se faire de plus en plus séduisante. La version Grand Large en particulier correspondait parfaitement aux goûts américains.
Quoi de plus américain qu'une Aronde Grand Large façon " hard top ". L'échelle n'est toutefois pas la même comparée à cette Buick de la même année. Copyright En France, les Simca s'étaient américanisées (teintes bicolores, nombreuses options ...), il n'y avait aucune raison que cela ne plaise pas chez l'Oncle Sam. Face aux Aronde pétillantes, les vendeurs d'austères Peugeot 403 faisaient la grimace ! En parallèle, Simca n'hésitait pas à se faire remarquer par une politique tarifaire agressive pour ses versions les plus populaires. Il s'agissait surtout de gagner des parts de marché, la rentabilité devait suivre ! Lors du rachat de l'usine Ford de Poissy en 1954, Simca avait trouvé dans la corbeille la Vedette, une voiture étudiée par Ford à Détroit, pour le marché français, par un constructeur désireux de s'implanter en France. Cette voiture aurait pu permettre à Simca de renforcer ses positions américaines. Mais Ford qui détenait depuis la vente de l'usine de Poissy 15 % du capital de Simca ne l'entendait pas ainsi. En effet, pourquoi diffuser aux Etats-Unis une voiture qui ne se serait de toute façon pas appelée Ford, alors que le constructeur américain estimait disposer d'une offre suffisante dans sa propre gamme US. A la fin de la décennie, pour répondre à une modification de la demande vers des modèles plus économiques, Ford fit comme Chrysler et la General Motors, et importa des modèles fabriqués en Angleterre, mais qui eux sortaient d'usine avec un vrai badge Ford. De 1955 à 1958, Ford refusa donc d'aider son " partenaire " Français. Simca ne pouvait dès lors compter que sur ses propres forces pour créer un réseau de distribution digne de ce nom. Le constructeur de Poissy tenta de négocier un rapprochement avec d'autres sociétés américaines. Studebaker, constructeur indépendant, fut sollicité. Mais il n'offrait que des conditions médiocres, et d'autres constructeurs frappaient déjà à sa porte, Renault, Mercedes et Volvo notamment. Quoi qu'il en soit, Simca disposait tout de même d'environ 600 distributeurs dès 1957. Il ne s'agissait quasiment jamais de dealers exclusifs. Ceux-ci travaillaient le plus souvent pour d'autres marques européennes. La pérennité de la collaboration avec Simca n'avait rien d'acquise, ces distributeurs pouvant changer de marque selon les évènements et leur intérêt. L'Auto Journal dans son N° 180 du 15 août 1957 dressait un portrait de la situation des constructeurs français aux Etats-Unis, en particulier de Simca . Extrait :
Un autre article paru dans le numéro 190 du 15 janvier 1958 précisait :
Brochure Simca Super DeLuxe, marché américain, 1958. Copyright Tom Mc Cahill, journaliste automobile respecté qui travaillait pour la revue américaine Mechanix Illustrated, qui s'était déjà exprimé au sujet de la Renault 4 CV, donnait cette fois son avis au sujet de l'Aronde, en lui attribuant le titre de " best import car buy of the year ". Dans un article élogieux pour la voiture française, il indiquait que celle-ci, malgré son prix supérieur, valait bien mieux que la Volkswagen. Il apportait toutefois une réserve majeure, l'absence d'un vrai réseau de distribution et d'après-vente. Les services commerciaux de Simca en reprenant son article de presse, grâce à un " tiré à part ", une pratique courante aux Etats-Unis, lui répondait " Relax, M. Mc Cahill ", en lui précisant que le réseau Simca n'était pas qu'une ébauche, et que la disponibilité des pièces Simca était bien réelle, grâce à un réseau de garagistes et d'agents bien formés disséminés sur tout le territoire américain.
Notez la reprise du titre " best import car buy of the year " sur les murs de ce distributeur Simca. Copyright Chrysler était depuis de nombreuses années à la recherche d'un partenaire européen. Alors que la General Motors avait décidé de vendre aux Etats-Unis des Vauxhall Victor et des Opel Rekord, Ford s'engageait dans l'importation massive de voitures en provenance de ses filiales britanniques et allemandes. Face à ses deux principaux concurrents, Chrysler était dans une situation inconfortable, car il ne possédait pas de division européenne. Entreprendre l'étude et la construction d'une petite voiture aux Etats-Unis était hors de prix. La main-d'oeuvre y coûtait 2,43 $ de l'heure, contre moins de 1 $ en Europe. La différence de prix entre une grosse et une petite voiture aurait été insignifiante, et n'aurait ramené qu'un très petit nombre de clients. Il aurait donc été nécessaire de la vendre en très grosse quantité pour espérer gagner un peu d'argent. Face au retournement du marché à la fin de la décennie, la crainte pour Chrysler était de voir ses agents s'engager dans des directions différentes et prendre la représentation de marques européennes, fragilisant ainsi son réseau. Chrysler négocia avec plusieurs constructeurs européens, avant de porter son choix sur Simca qui produisait l'Aronde. Un protocole d'accord commercial était signé entre les deux partenaires en juin 1958. Il prévoyait la commercialisation par Chrysler des Simca aux Etats-Unis, et inversement la diffusion par Simca de certains modèles du groupe Chrysler en Europe. Chaque marque devenait le revendeur exclusif de l'autre. Pour sceller l'affaire, Chrysler rachetait à Ford les 15% du capital de Simca qu'il détenait. Ce premier protocole en cachait un second, négocié en juillet. Celui-ci montrait un engagement plus important de Chrysler, qui décidait d'acquérir 10 % en plus dans le capital de Simca, portant ainsi sa participation à 25 %. En contrepartie, Chrysler obtenait deux fauteuils d'administrateurs. Les vendeurs étaient des banques suisses, qui représentaient une part des intérêts de Fiat. Chrysler devait mettre à disposition du Français son réseau de 9000 distributeurs à travers les Etats-Unis, sur la base de 60 000 voitures distribuées annuellement, et devait aider Simca à conquérir 15 % du marché des voitures importées. L'engagement était énorme, même si par prudence, Chrysler le limitait dans un premier temps à six mois. Immédiatement, les ventes d'Aronde bondirent sur le sol américain, passant de 11 989 voitures en 1957 à 27 476 en 1958, puis à près de 42 000 en 1959 (données variables selon les sources). Une politique tarifaire agressive permettait à Simca de prendre des parts de marché. Curieusement, le constructeur parvenait malgré le coût d'acheminement de la France vers les USA à vendre sa voiture 7 % moins chère sur le sol américain. L'explication tenait aux subventions du gouvernement français versées à Simca pour favoriser les exportations, et qui permettaient à celui-ci de gagner un peu d'argent sur chaque voiture. Simca exportait aux Etats-Unis, mais développait aussi sa présence sur d'autres marchés porteurs à travers le monde, grâce au partenariat avec Chrysler. Sans cette coopération, Simca n'aurait jamais eu les moyens d'un tel développement. Alors que 18 % de sa production partait pour l'étranger en 1955, cette proportion passait à 43 % en 1959.
Extraits de la brochure Simca pour le marché américain, décembre 1958. Copyright Chrysler assumait avec sérieux son rôle dans ce nouveau partenariat. Un service commercial spécifique prenait en charge la diffusion des Simca aux Etats-Unis. Il s'appuyait sur ses meilleurs agents ainsi que sur 25 dépôts régionaux de pièces de rechange. Un shows itinérant fut monté de toutes pièces à partir de mai 1959 avec une troupe de cascadeurs, les Parisian Hell Drivers. Ceux-ci utilisaient la brave Aronde, qui était amenée à sauter d'un tremplin à un autre en passant sur d'autres voitures Simca. Le concept car Fulgur dessiné par Robert Opron qui avait été présenté au Salon de Genève en 1959 accompagnait les cascadeurs dans leurs pérégrinations. Cette voiture de l'an 2000 était supposée adopter de nouvelles techniques pas encore au point : moteur atomique, contrôle vocal, guidage radar, retrait des roues avant à partir de 150 km/h grâce à des gyroscopes ... Ce show car à la française devait bien faire sourire les Américains, déjà habitués depuis de nombreuses années à découvrir les réalisations autrement plus réalistes et plus impressionnantes des big three.
La frêle Simca Fulgur dans la circulation parisienne. Copyright
Les Américains savaient se montrer plus convaincants avec leurs voitures du futur. Copyright Chrysler vendait l'Aronde entre 1698 et 1798 $. Elle restait un peu plus chère que la Volkswagen et que la Dauphine, proposées respectivement à 1545 et 1645 $. Le terme Aronde, ancien nom de l'oiseau Hirondelle, s'il pouvait avoir un sens pour les Français dotéS d'une certaine culture, n'avait aucune signification pour les Américains. C'est ainsi que les Aronde de l'époque Chrysler s'appelaient simplement Deluxe et Super Deluxe. Les Océane et Plein Ciel poursuivaient une carrière discrète, et leurs tarifs les assimilaient à des objets de luxe.
Les Océane et Plein Ciel poursuivaient une carrière discrète. Copyright La clientèle américain était définitivement tombée sous le charme de l'Aronde. Il s'en vendit autant durant le premier semestre 1959 que durant toute l'année 1958. Simca était devenu le quatrième importateur aux Etats-Unis, après Volkswagen, Renault et Ford UK. Mais Simca n'allait pas résister à la contre-attaque des constructeurs américains. Il subissait à peu près pour les mêmes raisons les mêmes déboires que Renault, Peugeot et Citroën. Le constructeur de Poissy tentait de contrer le désastre en ajoutant la nouvelle Aronde P60 à son offre à partir de mai 1959. Cette réaction un peu tardive - la voiture était disponible en France depuis plusieurs mois - permettait tout juste de ralentir la chute des ventes.
Extrait de la brochure Simca pour le marché américain, 05/1959. Simca entend bien rappeler ses origines françaises, voir parisiennes. Copyright
La nouvelle P60 complète la gamme Simca aux Etats-Unis. Les voitures importées ne sont pas encore défigurées par des pare-chocs renforcés et autres feux de gabarit. Copyright Malgré les efforts entrepris, à l'issue de l'année 1960, le bilan était catastrophique pour l'état-major de Simca. Entre 1959 et 1960, les ventes avaient été divisées par près de six, chutant à 7 000 unités. Les stratèges de Poissy eurent la sagesse de ne pas exporter plus qu'ils ne pouvaient vendre. Contrairement à leurs concurrents Renault ou Peugeot, ils n'eurent pas à subir l'affront et le coût d'un rapatriement en France des invendus.
Ce concessionnaire de Los Angeles solde ses Simca, une illustration des difficultés que rencontrent la plupart des marques européennes aux Etats-Unis en 1960 - Source AJ N° 253 du 25 août 1960. Copyright A partir d'octobre 1960, l'offre de Simca fut considérablement réduite. Il en était fini des versions chics de l'Aronde. Elles faisaient place nette à partir du millésime 1961 à la très économique Etoile, qui devenait le seul modèle disponible outre-Atlantique. Dans cette conjoncture difficile, Simca préférait concentrer ses efforts publicitaires sur un modèle unique, et continuer grâce à cette offre simplifiée à se battre avec des prix bas. Simca affirmait sa présence avec un nouveau slogan que l'on retrouvait sur l'ensemble des documents publicitaires : " We love Simca ". Ceux-ci recensaient les raisons pour lesquelles il était opportun de choisir la petite berline française. Elle convenait à la famille avec peu d'enfants qui y trouvait tout l'espace nécessaire, à la jeune fille active qui ne pouvait qu'apprécier son élégance et son côté pratique, au jeune couple qui y voyait un moyen raffiné et économique de démarrer dans la vie, etc ...
" We love Simca ". Copyright Simca usa de la publicité comparative autorisée aux Etats-Unis, et n'hésita pas à confronter son Etoile à ses concurrentes tant européennes (Dauphine et Volkswagen) qu'américaines (les fameuses compactes). Des tableaux de comparaison étaient proposés par les différents constructeurs, sur lesquels leurs voitures figuraient évidemment toujours à leur avantage. Autre moyen promotionnel, le constructeur organisa un " Simca Mileage Marathon ", qui permettait à l'issue d'un trajet effectué par deux voitures entre Los Angeles et New York de mettre en avant la faible consommation en carburant de la Simca en situation réelle. A partir du millésime 1962, l'Etoile devint Simca 5, mais il s'agissait plus d'une simplification de l'appellation, que d'une quelconque volonté de faire référence à la Simca 5 produite de 1936 à 1949. Simca revint avec cette ultime version à un peu plus de luxe dans la présentation, avec de nombreux accessoires en série. L'Aronde était en fin de carrière. Sa remplaçante en Europe, la Simca 1300, ne fut jamais exportée outre-Atlantique. Le constructeur français préférait désormais concentrer ses efforts sur la Simca 1000, tant en version berline que coupé. Simca 1000 Dès sa conception, les responsables de Simca envisagèrent de commercialiser la Simca 1000 aux Etats-Unis. L'exportation de la petite Simca vers les USA débutait en juin 1963, alors qu'elle était disponible en France depuis le second semestre 1961. Ses tarifs étaient très proches de ceux des dernières Simca 5. Visuellement, la Simca 1000 américaine se distinguait essentiellement par sa face avant, redessinée par Bertone pour intégrer des phares de plus grand diamètre aux normes américaines, ce qui entraînait au passage un déplacement des clignotants vers le centre du panneau. Le motif décoratif entre les phares était emprunté au coupé Simca 1000, et remplaçait la fausse calandre des modèles européens. Le compteur était gradué en miles, la radio et les pneus à flancs blancs faisaient partie des options. A cette époque, adapter une voiture française aux normes américaines restait encore relativement simple. La presse spécialisée réserva un accueil plutôt favorable à la petite Simca. Elle lui attribuait les qualificatifs de mignonne, amusante à conduire, bien construite, économique, polyvalente, dotée d'un freinage efficace.
La Simca affiche des ambitions familiales. On imagine mal le chien dans le coffre avant ! Copyright
Cette vue de la face avant de la Simca 1000 française est à comparer avec celle de la version US. Copyright Simca, convaincu de la qualité de sa voiture, qui avait fait l'objet d'une mise au point poussée, mettait en avant la modernité mécanique de sa petite dernière. Autre atout de la 1000, son design sobre, sans mollesse, d'inspiration transalpine. Les quatre portes s'ouvrant largement, les grandes vitres descendantes, l'espace intérieur bien exploité au regard des dimensions extérieures, la mécanique facile d'accès étaient autant d'arguments qui devaient finir de convaincre ceux qui pouvaient douter. Malgré les ambitions de son constructeur, l'intérêt du public fut on ne peut plus relatif. Comme déjà évoqué, les petites européennes, Volkswagen mis à part, n'avaient plus vraiment la côte. Durant le premier millésime complet pour la 1000, c'est-à-dire 1964, il se vendit 12 700 voitures, une performance moyenne, meilleure cependant que celle de 1963 avec 4 600 voitures (Etoile et 1000), mais sans aucun rapport avec les chiffres de 1959. Le moteur arrière, même s'il vivait ses dernières années en Europe, avait encore quelques fervents adaptes aux Etats-Unis. La Coccinelle l'étrennait depuis de nombreuses années et la toute nouvelle Chevrolet Corvair venait d'adopter cette technique. Au sujet de cette dernière, on peut remarquer une certaine similitude de style entre la Corvair et la petite Simca, à une échelle différente évidemment. Simca pouvait de nouveau sourire, et avec à la fois sa berline et son coupé 1000 (voir paragraphe suivant), le constructeur de Poissy voyait ses ventes progresser pour 1965 à 15 353 unités, légèrement mieux que l'année précédente, mais à des années-lumière des performances de Volkswagen qui caracolait en tête avec plus de 350 000 voitures. Néanmoins, chez Simca, on appréciait cette réussite, même s'il convenait de la relativiser. En début d'année, Georges Héreil, nouveau patron de Simca, se rendit en personne aux Etats-Unis pour féliciter un réseau que l'on ne cessait de choyer et de récompenser. En mai 1965, les meilleurs dealers furent invités à Poissy. Le clou du voyage était ailleurs qu'à l'usine. Les deux avions en partance de Chicago et de New York firent escale à Rome où 333 revendeurs Simca furent reçus en audience privée par le pape Paul VI. A Paris, ils furent invités dans les meilleurs hôtels, avant de partir visiter les fleurons de l'économie hexagonale : Sud Aviation et sa Caravelle, l'usine marémotrice de la Rance, l'ORTF, le paquebot France ... Simca prenait un certain plaisir à démontrer aux Américains que la modernité s'était aussi installée en France. Les Américains qui étaient habitués au changement de style de leurs autos tous les deux ou trois ans commençaient à se lasser de la Simca. Le dessin du tableau de bord fut revu pour 1966, et la gamme se déclinait désormais en trois niveaux de finition. Le summum était représenté par la GLS à laquelle rien de manquait : sièges inclinables, cendriers arrière, miroir de courtoisie, enjoliveurs de roues ... La liste des accessoires disponibles s'allongeait : feux de recul, lave glace électrique, poubelle d'intérieur, galerie de toit ... Malgré ces efforts, les ventes se tassaient et n'atteignaient que 10 691 voitures.
Extrait de la brochure Simca DeLuxe pour le marché américain, 1966. Copyright Simca fournissait à ses clients une garantie de 5 ans (contre 2 ans en Europe) ou 50 000 miles sur les organes vitaux (moteur et transmission). Il y avait malgré tout quelques règles d'entretien (resserrage de la culasse, vidange, huile de boîte ... ) à respecter à des échéances bien précises pour bénéficier de ce service, et il ne fallait pas oublier de faire tamponner le carnet adéquat par le dealer. Les autres éléments, notamment la sellerie, la peinture, les accessoires, le circuit électrique ... n'entraient pas dans cette garantie Le public américain qui n'avait pas la même rigueur que la clientèle européenne s'excluait souvent tout seul de cette garantie, faute d'un entretien suivi. Ces contraintes finirent par agacer un public peu habitué à bichonner sa voiture comme on pouvait le faire de ce côté ci de l'Atlantique. Faute de suivre ces préconisations, de nombreuses Simca tombaient en panne, et héritaient encore une fois d'une image de voitures peu fiables. En 1967 et 1968, l'érosion des ventes se poursuivit, avec 6 778 voitures puis seulement 4 532. Ce ne sont pas les quelques améliorations de détail qui permirent de maintenir le niveau souhaité. Depuis les débuts de la 1000 fin 1963, la concurrence avait grandement évolué. La Simca devait faire face aux nouvelles Fiat 124 et Renault 10. Mais ce sont surtout les constructeurs japonais, Datsun et Toyota en tête, qui prenaient de plus en plus de place aux Etats-Unis. En 1968, les nouvelles lois fédérales en matière de sécurité routière imposèrent plusieurs modifications. La Simca 1000 pour les USA disposait notamment d'impressionnantes ceintures de sécurité ventrales. La face avant adoptait une nouvelle physionomie.
Simca 1000 millésime 1968, le public américain demeure accro aux chromes. Copyright En 1969, pour sa dernière année de présence aux Etats-Unis, la Simca 1000 bénéficiait évidemment des mêmes évolutions techniques que le modèle européen. Les trains roulants, traditionnel point faible de la voiture depuis son lancement, étaient revus. Dans la foulée, la direction fut repensée. Une robuste crémaillère remplaçait le précédent système à vis et galet, dont la douceur égalait l'imprécision. Le comportement global de l'auto s'en trouvait grandement amélioré. A l'arrière, de nouveaux feux carrés remplaçaient les précédents qui étaient ronds. La 1000 se faisait désormais appeler 1118 (1118 cm3, 49 ch Din), en version GL ou GLS.
Simca 1118, millésime 1969. Copyright Simca 1000 Coupe En 1965, Simca décidait d'importer le coupé Bertone, dont les caisses en blanc étaient fabriquées à Grugliasco en Italie avant de rejoindre Poissy. Celui-ci n'était pas de première nouveauté, puisqu'il avait été présenté au Salon de Genève en mars 1962. Les publicités pour les Simca Sport du début des années 50 faisaient référence à la collaboration avec Pinin Farina. Celles du coupé Simca précisaient bien que la voiture était " body by Bertone ", autre référence italienne de prestige.
New from Chrysler, Simca 1000 Coupe, body by bertone. Copyright Malgré l'adaptation aux normes US, l'équilibre des lignes féminines de ce coupé fut préservé. Tout juste notait-on le montage de plus gros phares à l'avant et d'un éclairage spécifique de la plaque d'immatriculation à l'arrière. Simca réalisait un exploit en proposant ce coupé à 1653 $, mettant ainsi des bâtons dans les roues de ses concurrents, qu'il s'agisse du coupé Karmann Ghia vendu 2250 $, de la NSU Sport Prinz à 1998 $, et surtout de l'autre française de la catégorie, la Caravelle pour laquelle la régie exigeait de débourser 2 295 $. A titre de comparaison, la berline 1000 était vendue 1536 $ (contre 1595 précédemment). A partir de 1966, Simca dut affronter la concurrence des petites Fiat 850 coupé et spider, également dessinées par Bertone. Les italiennes se situaient dans la même fourchette de prix que le coupé Simca. La commercialisation du coupé Simca 1000 s'arrêtait à partir de 1968. A partir de 1969, la nouvelle Simca 1100 permettait à Simca de maintenir ses positions aux Etats-Unis. La berline à hayon prenait ici la désignation de 1204, en référence à sa cylindrée. Simca, après avoir été leader du tout à l'arrière avec la 1000, revenait sur le devant de la scène avec une tout à l'avant, une implantation qui allait se généraliser durant les années 70.
Simca 1204. Copyright Simca considérait que cette voiture moderne, à peine plus longue que la 1000, mais nettement plus spacieuse et pratique grâce à son hayon, avait toutes ses chances aux Etats-Unis. Elle était disponible en berline trois ou cinq portes et en break trois ou cinq portes. La gamme de prix variait de 1622 $ à 2043 $. La 1204 ne manquait pas d'atouts avec ses garnissages cossus, les nombreuses teintes au choix et la multitude des accessoires disponibles. Pourtant, elle ne parvint pas à s'imposer. Trop raisonnable, trop sérieuse, trop cartésienne, il lui manquait ce chic parisien qui avait fait jusqu'alors le succès des Simca Aronde et 1000.
Ce document de presse met en avant l'économie de carburant et le niveau d'équipement de la 1204. Copyright L'état-major américain de Chrysler semblait lui-même peu convaincu par les chances de réussite de cette voiture. Le PDG, Georges Héreil, avait eu le plus grand mal à faire passer l'étude de ce projet au géant américain. En 1970, après l'abandon de la 1000, seule la 1204 défendait les couleurs de Simca en Amérique du Nord. Les scores furent sans appel avec 6 035 ventes en 1970, puis seulement 2 600 en 1971. Simca se retirait du marché US fin 1971. Le constructeur de Poissy ne fit plus parler de lui jusqu'en 1978. Une nouvelle épopée s'ouvrait alors, avec la version américaine de la Simca Horizon.
La Simca 1204 qui manquait vraiment de glamour ne parvint pas à séduire le public américain. Copyright Dodge Omni, Plymouth Horizon L'origine des Omni et Horizon remonte au début de l'année 1975. A cette époque, les autorités américaines annonçaient que de nouvelles règles en matière de consommation de carburant allaient voir le jour à court terme, afin de faire face aux conséquences du premier choc pétrolier. Une nouvelle loi sur les économies et la conservation de l'énergie imposait aux constructeurs de ne proposer à l'horizon 1980 que des voitures capables de parcourir au moins 20 miles avant un gallon d'essence, ce qui correspondait à une consommation inférieure à 11,76 litres aux 100 km. Pour parvenir aux objectifs fixés, Chrysler initiait une collaboration nouvelle entre les ingénieurs du groupe des deux côtés de l'Atlantique. L'idée était de concevoir une nouvelle voiture pouvant être vendue sur les deux continents. De cette coopération allait naître l'idée que si la ligne générale de la voiture et sa cellule centrale pouvaient être communes, l'intérêt du groupe était de dissocier d'autres aspects, comme celui de la mécanique, de la transmission, de l'aménagement du tableau de bord et de l'habitacle en général (dessin des sièges, tissus ...). Chrysler qui ne pouvait absolument pas se rater s'adressa à Volkswagen pour la fourniture de moteurs fiables déjà adaptés aux réglementations américaines sur la pollution. La version américaine répondait à de nombreuses exigences liées à la sécurité, avec des pare-chocs renforcés, des phares et des vitrages spécifiques, et un aménagement adapté de l'habitacle. En novembre 1977, le nouveau modèle était lancé simultanément en France et aux Etats-Unis. Chez nous, il s'appelait Simca Horizon. Aux Etats-Unis, il était vendu à la fois sous les désignations Dodge Omni et Plymouth Horizon, peu différentes l'une de l'autre. Pour la première fois, une voiture conçue avec les Européens allait mener conjointement une carrière sur l'ancien et le nouveau continent. Les Dodge et Plymouth étaient à juste titre considérées comme des voitures américaines, d'une part en raison de leur production aux Etats-Unis, d'autre part en raison de leurs spécificités techniques, très différentes de celles de notre Simca Horizon. Leur très belle carrière, car ce fut une réussite incontestée, s'acheva à l'issue du millésime 1990.
Dodge Omni 1978. Copyright
Conclusion Nous venons de retracer plus de 40 années de présence des voitures françaises aux Etats-Unis, depuis les premières Simca 5, Traction et 4 CV, jusqu'à la dernière Peugeot 405. Que reste t'il de cette aventure ? Quelques beaux succès avec la Dauphine, l'Aronde, la DS et la SM, la 504, la Le Car ou l'Alliance, mais aussi de nombreux échecs, pour ne pas dire des bides sur lesquels nous n'insisterons pas. Les Allemands et les Japonais, voire plus récemment les Coréens, ont mieux su que les Français s'adapter à ce marché exigeant. Aujourd'hui, seul Renault peut encore prétendre à une certaine présence par le biais de son association avec Nissan. Le cas échéant, il dispose déjà d'un réseau de distribution pour d'éventuelles voitures dotées d'un losange. Durant le premier trimestre 2012, General Motors devenait actionnaire à hauteur de 7 % de PSA, mais il revendait ses parts en décembre 2013. Les autres automobiles françaises présentes aux States s'appellent Smart et Toyota Yaris ! Mais aujourd'hui, le nouvel Eldorado pour nos constructeurs est ailleurs, notamment en Chine. Puissions-nous espérer qu'ils auront retenu les leçons des erreurs du passé pour ne pas retomber sur les mêmes écueils ... |